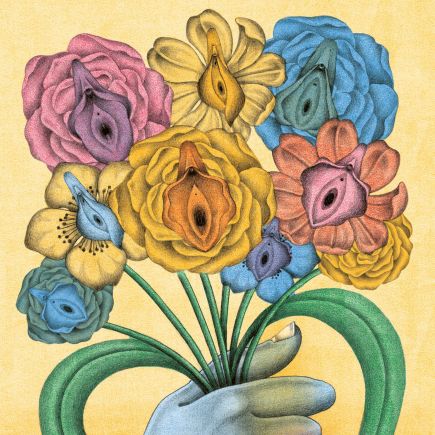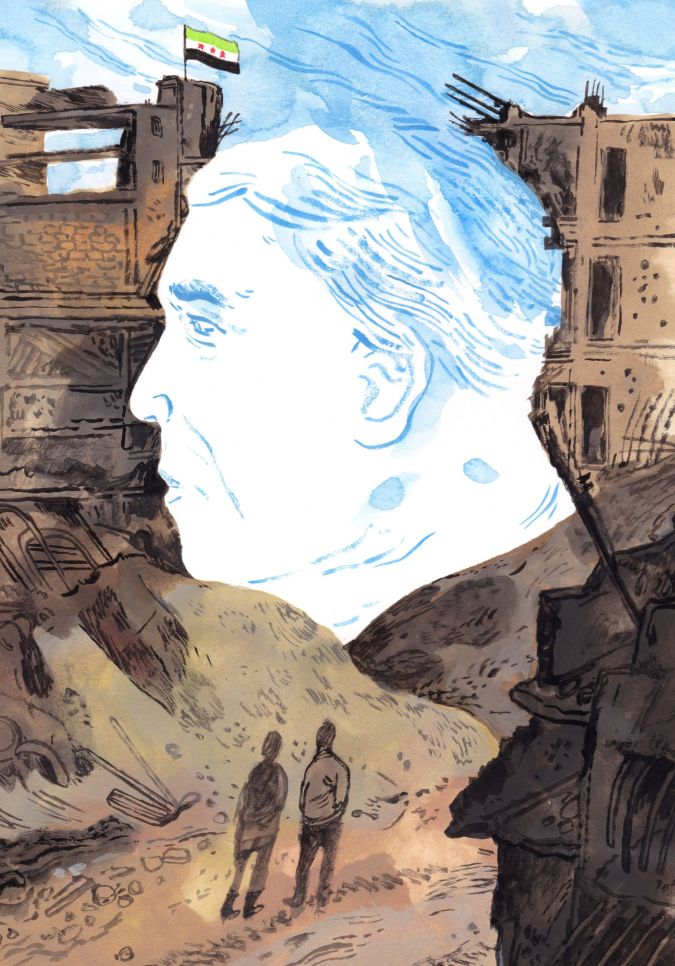C’était en octobre 2003, quelques mois après la canicule historique qui avait frappé la France. J’étais étudiante en restauration et le Musée Fragonard de l’école vétérinaire de Maisons-Alfort m’avait demandé de venir pour une mission très particulière. Je garde de ce moment un souvenir étonnant, bizarre même. Il faut imaginer la configuration. Les salles du musée sont constituées de grandes vitrines en verre, encadrées de fines structures en métal, un peu comme des livres en 3D. J’avançais au fil des « pages » – salle d’anatomie comparée, salle des squelettes, salle dédiée aux maladies contagieuses – quand, soudain, je suis tombée sur les écorchés.
Ils étaient là, à la fin de la visite. Je me suis arrêtée, et je me suis dit : « Mais qu’est-ce que c’est que ça ? » Devant moi, des corps humains et d’animaux dont on avait enlevé la peau. Ils avaient de gros yeux en verre couverts d’un vernis un peu jaune. Leurs membres étaient parcourus de peintures bleu et rouge, pour mettre en évidence leur système vasculaire. Ça donnait quelque chose de très fibreux, un peu comme de grands coraux qui se déploieraient dans un immense aquarium. Je n’avais jamais vu ça.
C’est pour eux que j’étais là. Il avait fait très chaud durant le printemps et l’été, et la matière que les anatomistes avaient injectée dans les veines à la fin du XVIIIe siècle – de la graisse de la résine de mélèze et des pigments – s’était mise à fondre. Il ne s’agissait pas des premières coulures : cela fait deux siècles qu’à chaque pic de température, les écorchés fondent. Mais là, c’était particulièrement visible. Il fallait régler ce problème de conservation. J’avais 23 ans et j’ai eu alors le sentiment d’ouvrir la porte d’un monde complètement inconnu, et à la fois très attirant. J’ai commencé à m’informer sur les écorchés, à comprendre ce que sont réellement ces corps morts mis en scène. Je suis entrée dans un univers infini.
Une Égyptienne de 2 600 ans
Je suis restauratrice de matériaux organiques désormais, c’est-à-dire de tout ce qui a été de près ou de loin vivant à un moment donné et qui ne l’est plus aujourd’hui. Cela peut être des objets (des tambours africains en peau, des coiffes de plumes…), mais aussi des restes humains ou animaux (des momies, des reliques de saints, des ossements inconnus, des mises en scène anatomiques – comme le sont les écorchés). J’aide les musées publics à les conserver. Souvent, ce n’est pas le temps qui les a dégradés mais des interventions passées, très intrusives : par exemple, certaines façons de présenter ou de disséquer les momies qui se pratiquaient encore dans les années 1980.
Il n’existe pas de formation pour mon activité. J’ai étudié l’histoire de l’art et la muséologie à l’école du Louvre, puis la restauration et la conservation du patrimoine. Mon point de départ, c’était les objets 3D, la sculpture, puis je me suis orientée vers l’organique, et y ai rajouté une spécialisation dans les restes humains. Mon métier, je l’ai un peu fabriqué. Nous sommes peu à l’exercer : en France, je suis l’une des rares spécialistes.
Je travaille en indépendante, je fais des devis et je me verse un salaire. Mon métier comprend une partie expertise et des projets de restauration dont le nombre est très aléatoire. Par exemple, il y a des années à momies et d’autres beaucoup moins. Ainsi, 2023 a été une bonne année : j’en ai étudié une petite vingtaine un peu partout en France. 2022 était différente : j’ai fait de la relique – ça change un peu ! –, mais aussi du cheval, du vautour et un chantier universitaire avec des caisses d’ossements.
Les bras n’étaient pas trop mal, mais la tête était désolidarisée du corps et les pieds se trouvaient dans un état dramatique.
Le nombre de pièces sur lesquelles je travaille dépend aussi de la taille du projet. En 2022, au musée de Picardie, à Amiens, cela a été un gros chantier : on était une équipe de neuf ou dix restaurateurs. On était trois à travailler sur une momie – deux collègues pour le textile tandis que je m’occupais des parties organiques. Les autres se concentraient sur le cercueil. Il s’agissait de travailler sur Setjaimengaou, une femme d’une quarantaine d’années qui aurait vécu il y a plus de 2600 ans en Égypte. Elle avait été placée dans un sarcophage moderne avec une vitre, et une mystérieuse poudre blanche recouvrait son corps.
Le premier problème a été d’identifier cette substance. Nous soupçonnions qu’il s’agissait d'insecticides. Cette pièce est arrivée au musée en 1867 et, à l’époque, on les enduisait d’arsenic, de DDT ou d’autres substances dégueulasses pour éviter les contaminations. On s’est donc équipés comme il faut pour sortir le corps du cercueil et réaliser une étude. On a d’abord découvert que la poudre blanche était de la chaux, une matière que l’on appliquait sur les cadavres au XIXe siècle pour les déshydrater. Le procédé avait été plutôt efficace puisqu’il n’y avait pas de traces d’insectes ni de bactéries. Cette première étape a duré une semaine, le temps de sortir Setjaimengaou de sa boîte, de l’observer et de faire des radios. Cela nous a permis d’affiner le diagnostic et de mieux comprendre ses points de fragilité. On a ensuite beaucoup discuté pour définir un protocole d’intervention. Puis, on est passés à la deuxième phase, celle de la restauration.
La momie était assez disloquée. Dans mon souvenir, les bras n’étaient pas trop mal, mais la tête était désolidarisée du corps et les pieds se trouvaient dans un état dramatique. Le problème était cette espèce de vitrine-cercueil. Elle était trop petite et la paroi avait appuyé sur les pieds, les brisant complètement au niveau des chevilles. Il a donc fallu maintenir une partie des orteils, remettre à leur place ceux qui étaient tombés. Une collègue restauratrice en textile est venue retravailler les bandelettes pour maintenir le tout, sans colle ni rien. C’était un challenge car les pieds, c’est plus d’une vingtaine d’os ! On y a passé une dizaine de jours. Pendant toute la durée du traitement, les équipes de France 3 sont souvent venues au labo pour faire de courts reportages diffusés aux infos régionales. Il y avait une vraie attente des Amiénois, comme une sorte de phénomène d’appropriation, autour de Setjaimengaou.
La momie triste
Ce rapport affectueux que les gens ont avec les momies est toujours touchant pour moi. Souvent, quand je travaille sur certaines opérations, on vient me poser des questions. On me parle à cette occasion de proches disparus, ou de la mort en général. Il n'y a pas très longtemps, dans un hôpital, alors que je terminais le scanner de l’un de mes « patients », comme je les appelle, une manipulatrice m’a interpellée. Elle m’a dit : « La momie m’a parlé. » Je lui ai posé quelques questions. Elle m’a alors raconté son histoire personnelle, un passé assez douloureux, qui l’avait amenée à travailler sur les énergies et leur lien avec le domaine spirituel. « J’ai senti une grande tristesse chez cette momie », m’a-t-elle expliqué.
Cette discussion m’a beaucoup troublée : quand j’avais travaillé sur cette momie les jours précédents, moi aussi j’avais ressenti une grande tristesse parce qu’elle était dans un état de dégradation important. Elle avait été extrêmement malmenée dans les musées, elle avait notamment subi une autopsie dans les années 1980, dans le cadre d’une thèse de médecine, au cours de laquelle on lui avait retiré une partie de ses bandelettes, ouvert l’abdomen et fait des prélèvements. Le tout avait été réparé tant bien que mal avec de la mousse d’isolation, ce qui n’est pas du tout approprié, et ça l’avait totalement saccagée. La voir comme ça m’avait fait beaucoup de peine.
À la Renaissance, on a commencé à ôter leurs bandelettes, pour chercher les trésors et les amulettes qui auraient pu s’y cacher.
Il y a quelque chose qui me frappe toujours quand je travaille sur des restes humains, c’est la manière dont les corps sont présentés. Je pense notamment à des momies sud-américaines conservées au Musée de l’homme. Dans le but d’être mises en scène, elles ont littéralement été embrochées sur une tige pour pouvoir tenir debout sur un socle. À cette époque, au XXe siècle, elles étaient considérées comme des objets d’exposition. Cela dit, ce n’était pas nouveau de les maltraiter. Quand les premières momies égyptiennes ont été découvertes au Moyen Âge, on en faisait des médicaments ou de l’engrais ! À partir de la Renaissance, on a commencé à ôter leurs bandelettes, pour chercher les trésors et les amulettes qui auraient pu s’y cacher. Plus tard, on les a exhibées car c’était le chic du chic d’avoir un bout de momie chez soi. Et puis, elles ont été oubliées.

La momie dans un grenier breton
Je me souviens d’une momie à Fougères, en Ille-et-Vilaine. Comme le musée de la ville avait fermé dans les années 1950, on l’avait mise au grenier. Mais la mairie a eu besoin de ce grenier. Le personnel s’est alors dit : « Momie = mort, mettons-la au cimetière. » Pendant vingt ans, elle est restée dans un petit vide sanitaire attenant au local où les cercueils étaient déposés temporairement. Jusqu’à ce qu’un égyptologue local s’intéresse à elle et m’appelle. Mais il n’y avait toujours pas d’endroit pour nous accueillir. Alors je me suis retrouvée dans une pièce du cimetière entre le point d’eau pour les plantes et les arrosoirs. Avec les inhumations en fin de journée et les croque-morts qui passent une tête pour jeter un œil, je me demandais parfois ce que je faisais là. Heureusement, dans les années 2000, le regard sur les restes humains a changé. On a commencé à les considérer davantage comme des individus, on a retrouvé leur dimension humaine. C’est dans ce sillage que je me suis glissée.
Il y a cependant des corps sur lesquels je n’aime pas travailler. Par exemple, ceux d’enfants. Je trouve ça compliqué. À Châlons-en-Champagne, on m’a un jour confié un écorché à restaurer. La préparation anatomique réalisée sur le corps était très belle mais c’était une petite fille de 6 ans. La première fois que je l’ai vue, elle était couverte de poussière, dans une toute petite caisse qui était trop étroite pour elle, oubliée dans un coin depuis bien longtemps. Certains éléments étaient cassés. Quand on voit ça, le premier ressenti, c’est toujours de se dire : « On va la sortir de là. L’état dans lequel elle est n’est pas digne. » Puis, on passe une journée complète sur ce petit corps, et l’émotion arrive. On se dit : « C’est un enfant, de quoi a-t-il pu mourir ? Quelle a pu être sa vie ? » C’est peut-être parce que je suis mère, mais je trouve qu’il y a toujours quelque chose d’injuste dans la mort d’un enfant.
Mon rôle est d’être attentive à ce que je vais pouvoir apporter, d’être dans une posture de soin.
Cette émotion, je la revendique. Elle fait partie de ma démarche. Je pars du principe que, si je ne me laisse pas aller à ce que je ressens, mon travail perd de son sens. Quand on met de la distance, on perd la conscience de la dimension humaine de notre métier. Je ne m’effondre pas à chaque placard que j’ouvre, mais c’est important pour moi de garder en tête que cet individu n’a jamais demandé à être là, qu’il a une histoire très chaotique, qu’on est allé le chercher dans son tombeau, qu’un scientifique s’est approprié son corps… Je pense que personne ne s’imagine finir dans un musée. Mon rôle est d’être toujours attentive à ce que je vais pouvoir apporter, d’être dans une posture de soin. Et, comme en médecine, il faut soigner sans surmédicaliser. Être capable de dire « je suis désolée mais je ne peux plus rien faire ». Accepter ses limites techniques pour ne pas faire plus de dégâts.
Nous, les restaurateurs, on est des passeurs finalement : on s’insère entre le passé et le futur. L’objectif de notre boulot est de mettre les objets en condition pour qu'ils puissent être transmis le plus longtemps possible. C’est pourquoi tout est long en restauration : on réfléchit beaucoup pour prendre la moins mauvaise décision. Quand ça va trop vite, en général, on fait des bêtises. Cela peut parfois durer des années ! Je pense que cette attention induit un rapport différent au temps, une posture de résistant dans un monde qui s’accélère.
Les caveaux normands
Quand je rentre à la maison, mon fils de 8 ans me demande souvent : « Maman, sur quoi tu as travaillé ? » Alors, je lui parle, je lui explique. Je lui montre certaines photos. Ça casse un peu l’imaginaire, qui peut être angoissant et morbide. Je pense qu’il y a une éducation à la mort à transmettre, au même titre qu’il y a une éducation sexuelle ou au consentement. Le musée a un rôle à jouer là-dedans car c’est le seul endroit dans lequel on voit encore des morts et, ceci, sans enjeu affectif : ce ne sont pas nos morts, nous ne les connaissons pas.
En ce sens aussi, mon métier m’a beaucoup apporté. Il m’a permis d’apprendre et de comprendre ce qu’est un corps sans vie. Cela m’a énormément apaisée. Petite, j’avais une image glaciale de la mort. Une fois, j’ai fondu en larmes parce que je ne voulais pas finir à la poubelle mangée par les vers. Ma vision était celle des cimetières de Normandie – ma région d’origine : le froid, la pluie, les caveaux avec de la mousse. J’avais une image dramatique du cadavre, je pensais beaucoup à la décomposition des corps. Mais cette vision fantasmagorique, c’était parce que je n’avais pas d’ancrage concret. J’étais rêveuse, je lisais beaucoup et mes représentations reposaient sur le récit collectif, celui des BD ou des films. Ça me fascinait et, en même temps, je trouvais ça très inquiétant.
Quand j’ai commencé à travailler là-dessus, j’avais 23 ans. J’en ai 43 aujourd’hui, j’ai eu deux enfants entre-temps. Je vieillis, je me vois vieillir et je n’en fais pas une source d’angoisse. En ce moment, je passe même de l’autre côté de la vitrine. Depuis septembre 2023, je suis en résidence à la Villa Médicis, une institution à Rome qui accompagne les artistes, mais aussi les historiens de l’art ou les restaurateurs, pour leur permettre de réfléchir à leur pratique et de créer.
À la fin de ce pensionnat, nous sommes invités à montrer notre production. Dans ce cadre, j’ai décidé de faire le même parcours que mes momies. Comme elles, je vais faire un scanner de mon crâne, ce qui me permettra d’en réaliser une impression 3D. Je la remanierai ensuite pour faire une patine et la présenter dans une vitrine. Qu’est-ce que cela engage que je sois à la fois vivante, restauratrice de restes humains, et moi-même un tas de restes humains en devenir ? Qu’est-ce que cela implique d’être montrée à la vue de tous ces vivants ? Un crâne, ce n’est pas juste un assemblage d'os. C'est aussi une personne. Il faut se laisser aller à cette projection.