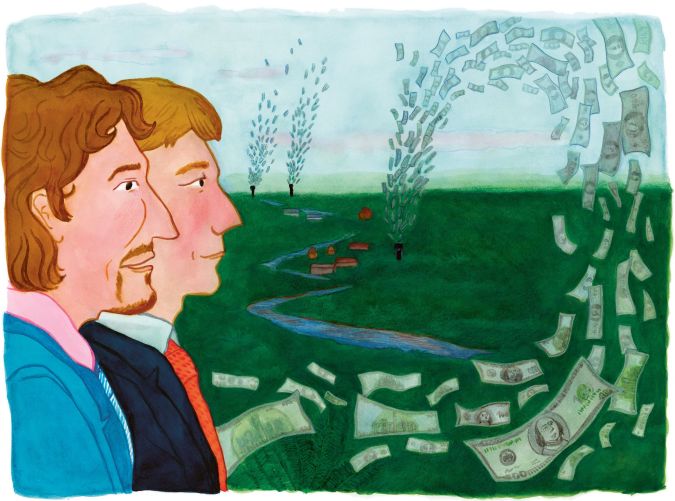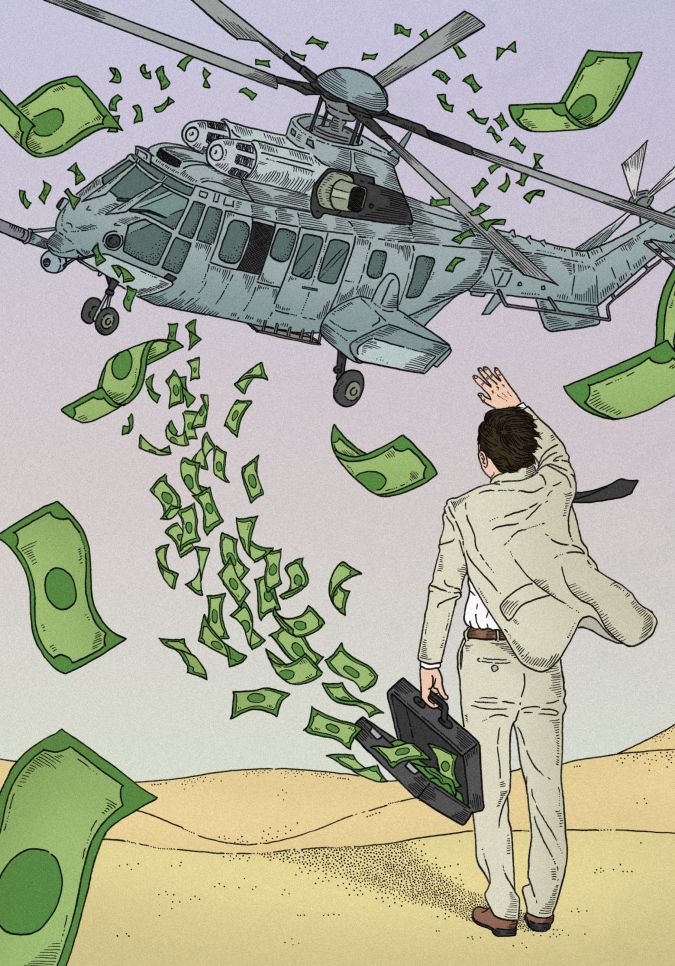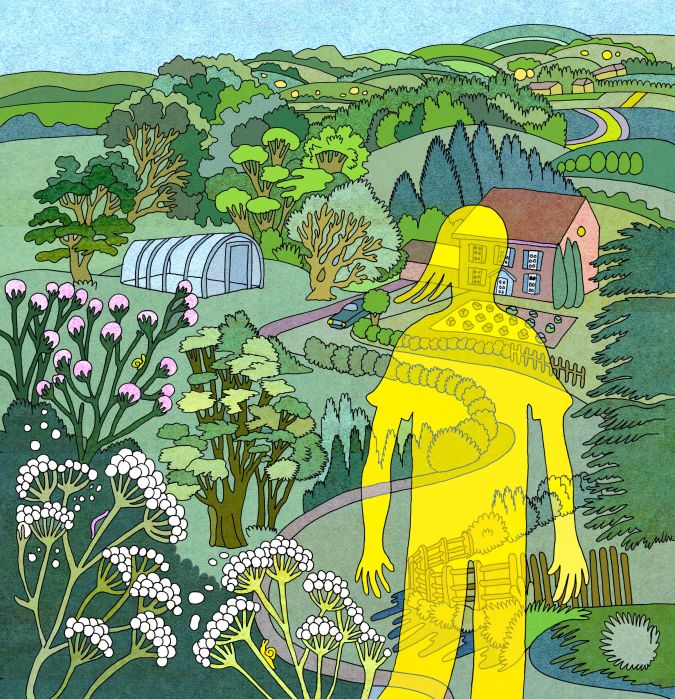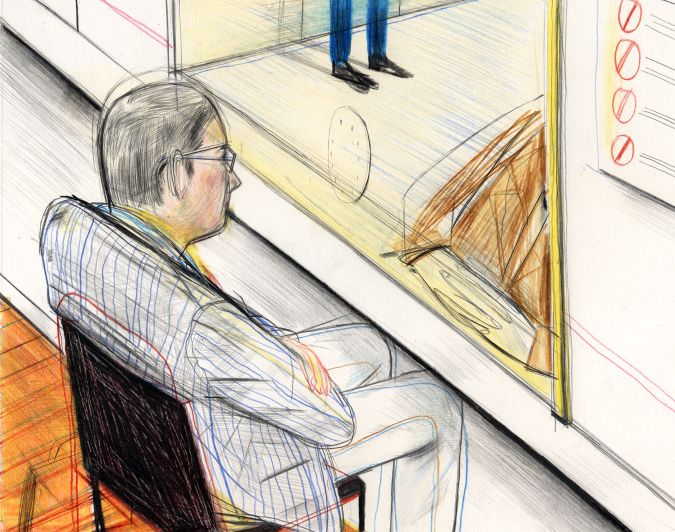La France fait partie des pays où l’accès aux terres agricoles est le plus encadré. En quoi consiste cette régulation ?
Elle repose sur trois socles. Le premier, c’est le statut du fermage, qui permet à un exploitant de louer la terre qu’il travaille à un propriétaire. Le bail qui le relie à sa terre peut être transmis jusqu’à un parent du troisième degré, ce qui est censé faciliter la pérennité des exploitations. Le deuxième socle, c’est la régulation du marché des locations. Un schéma directeur régional, différent selon les territoires, donne des priorités pour la location des terres – qui suppose à chaque fois une autorisation préfectorale.
Enfin, le contrôle du marché des terres par les Safer (sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural) constitue le troisième socle de cet encadrement depuis 1960. Leur mission est double : d’une part s’assurer que les terres agricoles restent aux mains de personnes qui vont faire de l’agriculture, grâce notamment à leur droit de préemption lors d’une vente, et d’autre part maintenir des prix assez bas. Le problème, c’est que ces règles sont couramment contournées.
Est-ce que ces outils de régulation de l’accès au foncier aident le secteur à entamer une transition écologique ?
Cette transition suppose, par exemple, une combinaison élevage-cultures, une résilience économique par la diversification et, en conséquence, des fermes plus petites – la taille moyenne actuelle étant de 69 hectares, la taille moyenne à l’installation, de 35 hectares. Cela nécessite concrètement qu’il y ait plus d’agriculteurs. Or, aujourd’hui plus de la moitié des terres agricoles transmises agrandissent des exploitations existantes au lieu de servir à des installations.
Ce qui limite l’efficacité de la régulation, c’est que 58 % des terres agricoles (en 2022) sont achetées sous la forme de parts sociales d’entreprise, et non par une personne propriétaire, dans des montages financiers parfois complexes. La loi a introduit un contrôle par les Safer des ventes de ces parts de société, mais seulement à partir d’une certaine surface. Les propriétaires qui en ont les moyens ont donc tendance à multiplier les sociétés de surface modérée, qui cumulées constituent des très grandes exploitations échappant au contrôle. Il faudrait démembrer ces montages au moment de leur transmission, ce que personne n’arrive à faire aujourd’hui.
Pourquoi les Safer ont-elles du mal à agir ?
Ce sont d’incroyables outils qu’on nous envie en Europe, mais leur tâche est rendue difficile du fait qu’elles ne reçoivent pas de dotations propres de l’État. En effet, en raison notamment d’une fiscalité importante sur les terres, les Safer n’ont souvent pas assez de moyens, lorsqu’elles préemptent de grandes surfaces, pour prendre le temps de répartir les parcelles entre plusieurs exploitants.
Par ailleurs, elles n’ont pas le même impact selon les territoires, en raison d’une structuration différente du foncier agricole selon les régions. Dans le nord de la France, la transmission de terres se fait essentiellement par le transfert des baux, donc les Safer ne sont pas des acteurs centraux, alors qu’elles le sont dans le sud du Massif central, par exemple.
En outre, le syndicat majoritaire – la FNSEA – est surreprésenté parmi les organisations professionnelles qui gèrent les Safer. C’est donc sa vision de l’agriculture – assez éloignée de l’agroécologie, comme en témoigne son positionnement début 2024 en faveur d’un moratoire sur les interdictions de pesticides – qui a tendance à prendre le pas.