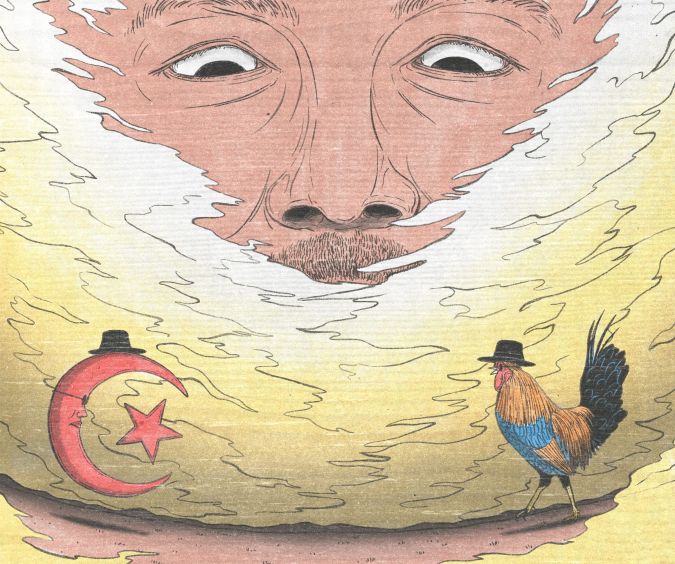Cette fois, c’est le vieux monsieur assis au premier rang qui craque. Il jette violemment une liasse de papiers par terre et quitte sa table d’un pas chancelant. « Mensonges, mensonges, mensonges ! », hurle-t-il dans le couloir avant de jurer de ne plus jamais revenir dans la petite salle de lecture aux fenêtres condamnées. Je le revois à sa place le lendemain. Les bibliothécaires sont habitués à ce genre de scènes. Il n’est pas rare que les personnes venues consulter les archives de la Darjavna Sigurnost (DS), la Sécurité d’État de l’ancienne République populaire de Bulgarie, s’en prennent à eux – confondant les bourreaux d’antan avec ces simples employés préposés à la sauvegarde de la mémoire des crimes du communisme.
La « Comdos » : c’est ainsi que les Bulgares appellent la « commission chargée de la gestion des documents et habilitée à rendre publique l’appartenance de citoyens bulgares à la Sécurité d’État ainsi qu’aux services de renseignement de l’Armée populaire bulgare ». Né en 2007, dix-sept ans après la fin du communisme, cet organisme au nom interminable ne se contente pas de veiller sur les cartons de la police secrète du dictateur Todor Jivkov, il solde aussi les comptes du passé. Lui seul peut déterminer, après examen de ses dossiers, si telle ou telle personnalité publique a collaboré à la redoutable machine de surveillance et de répression de l’ancien régime. Mais, à la différence d’institutions similaires dans d’autres pays d’Europe de l’Est, son avis n’entraîne aucune conséquence. Il est uniquement informatif. Régulièrement, les Bulgares apprennent qu’un certain nombre de directeurs de banques, de diplomates ou d’hommes politiques – y compris un ex-président – sont d’anciens cadres de la DS. Ils en concluent que les choses n’ont pas beaucoup changé.
Un citoyen lambda peut s’adresser à la Comdos pour savoir si lui ou un membre de sa famille a fait l’objet d’une surveillance.
Les données personnelles, le plus souvent soigneusement expurgées, de ces dignitaires sont accessibles à tout le monde. Un citoyen lambda peut aussi s’adresser à la Comdos pour savoir si lui-même ou un membre de sa famille a fait l’objet d’une surveillance. Dans l’affirmative, il a le droit de consulter son propre dossier, ici même, au deuxième étage d’un vieil immeuble d’habitation situé à deux pas de l’opéra. Un lieu exigu et aseptisé où se télescopent la petite et la grande histoire.
Lorsque je prends place moi aussi dans la salle, c’est en ma qualité de correspondant français dans les Balkans. Je ne suis pas un étranger à proprement parler. J’ai vécu de l’âge de 14 à 19 ans en Bulgarie, prisonnier derrière ce qu’on appelait alors le « rideau de fer », avant d’en repartir, de manière définitive, en 1990. Un retour aux sources ? s’étaient enquis mes collègues, surpris par ma décision de quitter mon poste confortable dans un grand hebdomadaire parisien. Pas vraiment : ma famille a toujours considéré ce pays comme une étape accidentelle (et forcée) dans son long exil. Les ancêtres de mon père, des juifs d’Espagne, commerçaient entre Istanbul, Thessalonique et Plovdiv avant de s’arrêter en Bulgarie ; ceux de ma mère, des Russes blancs, s’étaient installés à Varna, au bord de la mer Noire, après avoir fui la révolution, sans jamais vraiment défaire leurs valises.
Moi-même, j’ai grandi ailleurs. Enfant, j’ai suivi mon père qui enseignait les mathématiques dans le cadre de l’Unesco, en France et au Maroc. Mes parents et proches, dispersés aujourd’hui à travers le monde, conservent des sentiments mitigés à l’égard de leur parenthèse bulgare. Ils ont d’ailleurs réagi avec beaucoup d’appréhension quand ils ont appris que je me trouvais de nouveau dans un pays synonyme, pour eux, d’arbitraire, d’injustice et de chaos.
« Souper avec le diable »
Les mois passent et il ne m’arrive rien d’inquiétant. À part que je ne quitte plus les archives de la Comdos. Je me plonge dans les actions les plus retentissantes des services bulgares durant la Guerre froide : la tentative d’assassinat du pape Jean-Paul II, le parapluie dit « bulgare » à la pointe empoisonnée, les trafics d’armes et de stupéfiants à grande échelle... Je déniche des faits moins connus, comme cette rocambolesque infiltration de la communauté monastique du mont Atos en Grèce. Ou encore comment les labos de la Sécurité d’État sont à l’origine du Captagon, cette « drogue du courage », à base d’amphétamine, aujourd’hui très prisée des combattants de tous bords.
Je rêve de sortir une affaire inédite, une de ces histoires d’espionnage compliquées, en lien si possible avec la France, comme ne manquent pas de me rappeler les rédacteurs en chef des différents journaux avec lesquels je collabore à Paris. En 2012, je pense tenir une piste. Je tombe sur deux notes déclassifiées dans lesquelles la DS raconte comment elle a été approchée à plusieurs reprises par son équivalent français, la DGSE, sous le prétexte de la « lutte contre le terrorisme ». Les documents mentionnent deux intermédiaires, un juge parisien et un mystérieux agent double, ainsi qu’un dîner avec la direction de la DGSE à Paris, courant 1987. En pleine Guerre froide, les espions bulgares, souvent décrits en Occident comme les tueurs à gages du KGB, le grand frère russe, auraient ainsi entretenu des relations secrètes avec la France. Dans un des deux rapports, le général Vladimir Todorov, chef de la puissante première direction principale de la DS, chargée des opérations à l’étranger, fait justement part de ses doutes à ses « camarades soviétiques ». Pour lui, la DGSE essaie d’attirer les Bulgares dans un guet-apens. « Nous considérons que l’ennemi tente d’organiser ces rencontres pour les rendre publiques et nous compromettre », conclut-il.
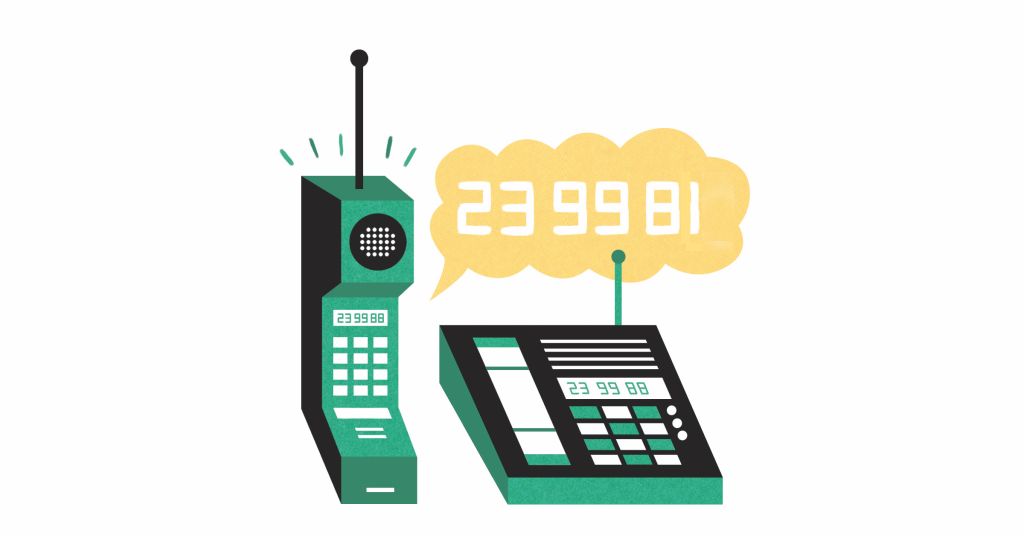
Je ne sais plus combien de fois j’ai pris l’avion entre Sofia et Paris depuis cette découverte. Je parviens à retrouver quelques-uns de ses protagonistes encore en vie : le fameux juge français, l’agent double et des maîtres espions à la retraite plutôt amusés de la résurgence de ce que l’un d’eux qualifie d’une des « pages encore non écrites de la Guerre froide ». Ils me racontent leur version, tentent aussi de m’enfumer. Plus j’avance, plus la réalité semble m’échapper : il s’est bien passé quelque chose entre Paris et Sofia à partir de 1986, mais quoi exactement ?
Un matin, je me retrouve dans la salle de lecture de la commission face à un caddie chargé à ras bord de dossiers : toute la correspondance du poste de la DS à Paris avec le siège à Sofia entre 1984 et 1991. Quelque part, dans ces milliers de pages, est peut-être consignée une opération dont j’imagine déjà le titre : « Souper avec le diable ». En les épluchant, je croise des centaines de destins, pour la plupart totalement inconnus, qui ont pour seul point commun d’être apparus sur les radars de la sécurité d’État. Et puis un jour, en parcourant de vieux papiers, je découvre un nom qui m’est familier. Celui d’un agent du contre-espionnage. L’homme se contente de surgir au détour d’une mission pour aussitôt disparaître. Il ne semble jouer aucun rôle dans la tentative de rapprochement entre Français et Bulgares. Mais il change complètement le cours de mon enquête et me replonge brutalement dans ma propre histoire.
« Je sais tout de toi »
Je n’ai pas le droit de révéler son identité. La Comdos non plus. La loi bulgare protège mieux les anciens agents des services que leurs victimes. L’ex-officier, autrefois tout-puissant, semble être redevenu un citoyen ordinaire. Ses années passées à la DS ne regardent que lui. Appelons-le « Petrov ». Pour moi, il s’agit d’une vieille connaissance.
Pendant l’été 1987, il doit être lieutenant ou jeune capitaine. Je viens d’avoir 18 ans. Tout commence par un coup de fil. Je me souviens de sa voix, à la fois enjouée et autoritaire : il veut me voir pour une « petite formalité ». Il me dit de ne pas m’en faire et surtout de ne pas inquiéter mes parents. Il me fixe rendez-vous pour l’après- midi au siège du ministère de l’Intérieur. Il suffit de donner son nom au policier en faction.
Je me remémore chaque détail de cette rencontre jusqu’aux tennis blanches à scratch que je portais ce jour-là. J’ai plus de mal à décrire l’état d’esprit dans lequel je me trouvais en me rendant à sa convocation. J’avais la trouille, certainement. Je devais être aussi flatté et excité à l’idée de narrer cet épisode à mes copains : la DS, ce pouvoir omniscient, avait besoin de moi.
« Nous avons un gros souci avec un de tes professeurs. Le Français », me dit Petrov.
Je fais le pied de grue devant la guérite du ministère, lorsqu’un jeune homme en polo, pantalon clair et mocassins m’aborde. Il porte des cheveux châtains, bouclés et plutôt longs pour les critères de la maison qui l’emploie. Je le prends pour un passant. C’est Petrov. Il a la démarche vive, un sourire au coin des lèvres. Je le suis à travers un dédale de couloirs, avant de pénétrer dans une petite pièce avec un bureau et deux chaises. Il s’assoit derrière sa table, triture le téléphone. À ce moment-là, il ne sourit plus. « Ne perdons pas de temps en présentations, je sais tout de toi et toi tu ne dois savoir de moi que ce que je te dirai, commence-t-il. Le problème est un peu plus sérieux que ce que je t’ai dit au téléphone : nous avons un gros souci avec un de tes professeurs. Le Français. Il est coopérant, officiellement. Mais avant de venir ici, il a enseigné en Tchécoslovaquie et nos collègues nous ont fait suivre un dossier gros comme ça, poursuit-il en écartant au maximum le pouce et l’index. Nous considérons qu’il représente un danger pour la sécurité nationale. Il faut que tu nous aides. »
Lui et ses collègues m’ont longuement espionné : ils savent que je suis l’un des rares élèves proches du Français qui vit seul et ne connaît pratiquement personne en Bulgarie. Je suis allé chez lui avec une amie. Il nous a prêté des livres. Il a été hospitalisé et j’ai été le seul à lui rendre visite. Ce jour-là, en sortant de sa chambre, je tenais à la main un magazine français dont la couverture portait sur les conséquences de l’explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl, un sujet tabou dans le « camp socialiste ». Petrov me montre négligemment la photo prise par l’équipe de surveillance. Bref, je suis dans de sales draps.
Si j’accepte de leur donner un coup de main, ma carrière est faite : avec ma connaissance de l’Occident et du français, je présente le profil idéal pour rejoindre les « services ». Petrov promet d’appuyer ma candidature. Il m’autorise d’ailleurs à le tutoyer et me donne ses deux numéros de téléphone, celui du bureau et celui de son domicile où je peux l’appeler quand je veux. « Attention, j’ai un jeune fils, il a 4 ans, mais il décroche déjà », me prévient-il, la mine attendrie.
Un sentiment de dégoût
J’ai récemment retrouvé le petit carnet rouge, en cuir du Maroc, où je notais les numéros de mes camarades de lycée. C’est l’une des rares choses que j’ai emportées avec moi lors de mon départ de Bulgarie quelques années plus tard. Le numéro de Petrov est le 239981. Je ne sais plus combien de temps je reste dans ce bureau anonyme. Je me revois, dehors, dans la chaleur étouffante de l’été bulgare, en train de marcher vers la maison. Rien n’a changé : le soleil, les badauds, le vendeur de billets de la loterie nationale, mais ma vie vient de basculer et je suis le seul à le savoir. Un avant-goût du travail d’espion qui m’attend, à en croire mon interlocuteur de la DS.
Malheureusement pour lui, je suis loin d’être grisé. Un violent sentiment de dégoût m’envahit au fur et à mesure que je m’éloigne du siège de la police secrète. Si j’accepte la proposition de Petrov, je dois désormais rapporter les moindres faits et gestes de mon prof préféré, celui qui constitue mon seul lien avec le monde perdu de mon enfance : la France et le français. Si je refuse, cela aura des conséquences pour moi et ma famille. L’officier a lourdement insisté sur ce point avant d’ajouter : « Le mieux, c’est que tu n’en parles pas à tes parents, tu es un grand garçon maintenant, tu peux prendre ton destin en main. »
Une rencontre entre un haut cadre de la DS et les chefs de l’espionnage français a bien eu lieu à la caserne de la DGSE à Paris.
Je fouille les archives de la Comdos, dans l’espoir d’en savoir plus sur ce Petrov, mais la grande histoire me rattrape à nouveau, sous la forme de deux cartons d’invitation enfouis dans une enveloppe kraft. Des invitations à dîner envoyées par le patron du renseignement extérieur français, le général René Imbot, à l’ambassadeur bulgare de l’époque, et à un officier supérieur de la DS, dont le nom n’est pas mentionné. Les deux hommes sont conviés à se rendre le 24 novembre 1987, à 20 heures, au 141, boulevard Mortier. Je détiens, enfin, la preuve du « souper avec le diable ». Ce jour-là, une rencontre entre un haut cadre de la DS et les chefs de l’espionnage français a bien eu lieu à la caserne de la DGSE à Paris, dans la salle à manger particulière du général Imbot. La DS avait tout gardé, jusqu’au menu servi à son homme de l’ombre. Dans le même dossier, on retrouve aussi les doutes des Bulgares, l’insistance des Français, les manœuvres du magistrat (qui n’est autre que le juge antiterroriste Jean-Louis Bruguière) et le double jeu du transfuge de Sofia.
Je prends conscience de la coïncidence entre cette affaire d’État et mes propres péripéties. Les échanges entre les services français et bulgare interviennent au moment où je me débats moi-même dans la toile de la DS. Mais tandis que la première histoire est bien documentée, qu’en est-il de mon propre « dossier » ? A-t-il survécu au grand nettoyage des archives au début des années 1990 et si oui que contient-il ? Un compte rendu de mon « potentiel » de futur espion ou bien le récit de mes tentatives de me dégager de l’emprise de la police secrète ?
La réponse de la Comdos
Il n’y a qu’un seul moyen de le savoir. Je sollicite une fois encore la Comdos. Cette fois-ci, non plus comme journaliste, mais à titre personnel. Je patiente dans un autre bureau, face à une employée que je ne connais pas. Je remplis un questionnaire, j’hésite longuement sur certaines formulations. Je ne sais pas comment expliquer mon cas : étais-je un ancien collaborateur ou une victime de la DS ?
En 1987, les choses ne se sont pas passées comme Petrov l’avait souhaité. Je n’ai suivi aucun de ses conseils, à commencer par celui de ne pas avertir mes parents. À la maison, c’est tout d’abord la panique suivie par un véritable conseil de guerre. Mon père fait appel au père d’un de ses élèves, cadre au ministère de l’Intérieur. En attendant de savoir si cet homme peut nous aider, il me dit de temporiser et d’éviter de braquer la sécurité d’État par un refus brutal.
« Si tu me tournes en bourrique, tu vas le regretter ! », vocifère Pétrov à l’autre bout du fil.
Le rendez-vous suivant se déroule dans un café situé sous les Halles. Petrov se fait plus pressant. Il me détaille le genre d’informations qui l’intéresse : les sujets abordés lors de nos discussions avec le Français, la liste des livres et des magazines qu’il nous recommande, les noms des autres élèves qui lui sont proches. Je lui réponds que je ne suis pas sûr d’être à la hauteur de la tâche. J’ai besoin de temps pour réfléchir. Il fait comme s’il m’avait déjà recruté. Il me demande de lui apporter lors de notre prochaine rencontre un premier rapport, ainsi qu’une « petite bio pour bien amorcer notre coopération ». Il me parle de l’école spéciale de la DS, dans les environs de Sofia, puis d’un stage à Paris. C’est la dernière fois que je le vois. À partir de ce jour, je fais le mort. Je ne décroche plus le téléphone. Lorsque l’appareil sonne, mes parents se regardent longuement puis l’un d’eux prend l’appel pour dire que je suis malade ou absent. Petrov insiste, passe aux menaces et finit par me joindre : « Si tu me tournes en bourrique, tu vas le regretter ! », vocifère-t-il à l’autre bout du fil.
Vingt-sept ans plus tard, je reçois enfin la réponse de la Comdos. Avant d’arriver jusqu’à moi, elle a transité entre plusieurs adresses où je n’habitais plus. L’enveloppe déchirée en deux témoigne de mon impatience de connaître le verdict. La commission n’a trouvé aucun document me concernant dans les archives de la DS. La lettre affirme que les recherches se poursuivent et que si de nouveaux éléments apparaissent, j’en serai averti dans les meilleurs délais. Face à la nouvelle, je ressens un mélange de frustration, de soulagement et de colère. Tout porte à croire que mon dossier a été détruit, avec des milliers d’autres, dans les jours qui ont précédé ou suivi la chute du régime communiste. Trop insignifiant ou, au contraire, trop compromettant – je ne le saurai pas.