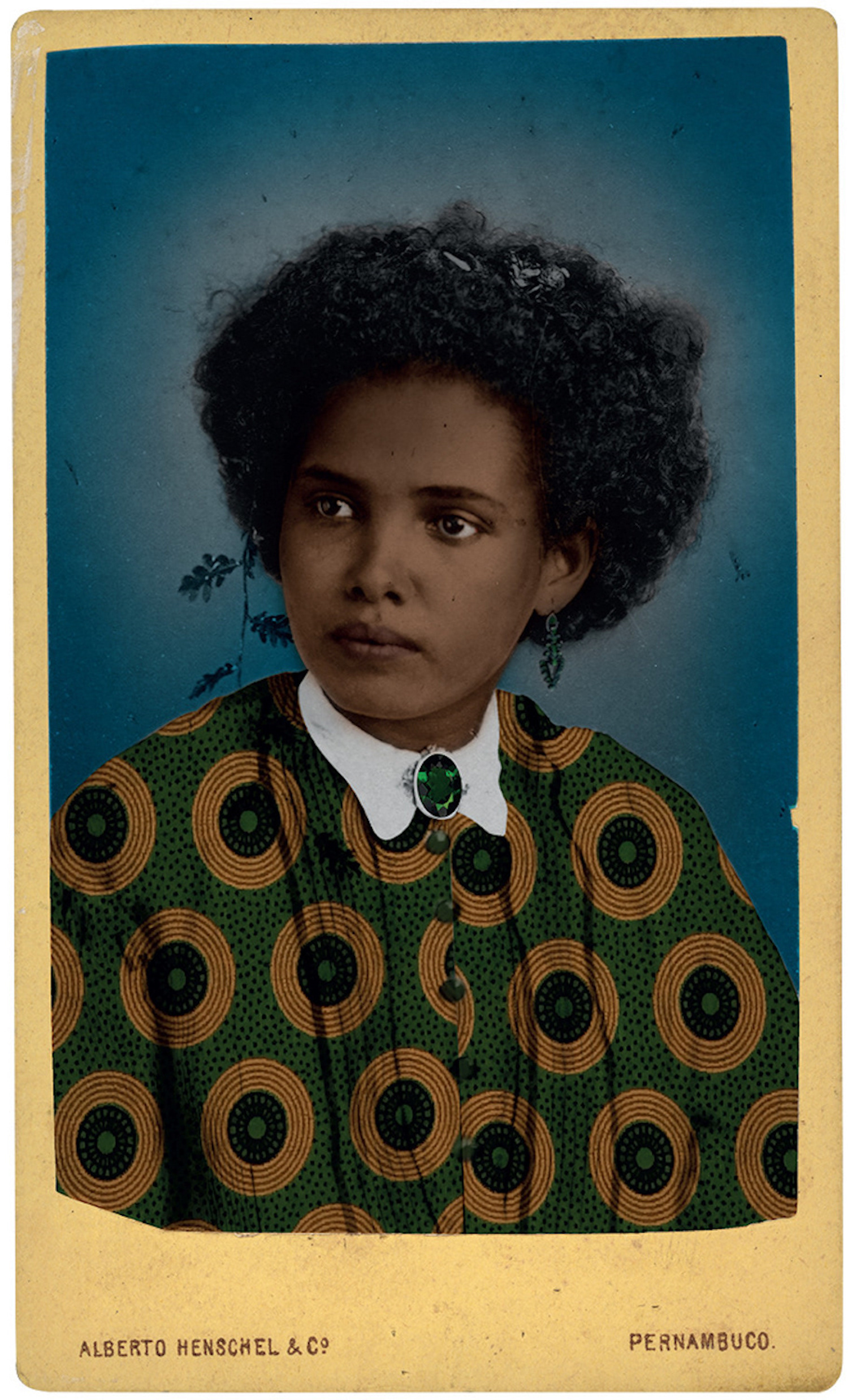Tout le monde l’appelait « Bang », Luiz Bang. Même revêtu de ses habits de maire, il était invariablement désigné sous son sobriquet de croque-mitaine par ses administrés. « Bang, comme dans les films de bang-bang », répétait-il. Le 27 janvier, vers 20 heures, son épouse Janete a entendu un bang, un seul, retentir devant leur maison isolée. En courant jusqu’au portail, elle a aperçu son mari au sol, dans une mare de sang, et au loin, sur la route nationale, deux motards qui détalaient. Frappé d’une balle en pleine tête, le tueur le plus redouté du Mato Grosso brésilien est mort avant d’arriver à l’hôpital. Toute la journée, les messages de menaces s’étaient accumulés sur l’écran de son téléphone : « Tu nous as fait beaucoup souffrir, maintenant c’est ton tour », disait l’un.
Luiz Carlos Machado, de son vrai nom, était considéré comme un tireur redoutable, l’un des cinq plus grands pistoleiros du Brésil. On lui attribue entre cinquante et cent assassinats. Une gâchette qu’il mettait généralement au service des gros propriétaires terriens, les fazendeiros, en lutte contre les Indiens ou les posseiros, ces petits paysans qui squattent les parcelles inoccupées, et aussi entre eux, afin de s’approprier le plus d’hectares possible. Un tueur à gages devenu chef de bande qui faisait régner la terreur au nord-est de l’Amazonie, de la vallée de l’Araguaia à l’État du Pará et à celui de Maranhão. Ses ennemis lui prêtent les pires méfaits : des victimes amputées de leurs oreilles, décapitées à la tronçonneuse ou réduites à l’esclavage. Un homme richissime, collectionnant ranchs, voitures, motos et lotissements, au patrimoine déclaré de 11,5 millions de réales, soit 4 millions d’euros.
Je l’avais interviewé deux mois plus tôt. Après plusieurs jours de harcèlement, de rendez-vous manqués, il avait accepté de me recevoir chez lui. Pour arriver jusqu’à Confresa, commune de douze mille habitants, il faut épuiser trois chauffeurs et deux autocars depuis la capitale de l’État. De part et d’autre de la route, là où autrefois la savane cédait doucement la place à la forêt amazonienne, s’étendent désormais à l’infini des champs de soja, un paysage monotone et monochrome, contrastant avec le sol rouge et le ciel bleu. Les trois cents derniers kilomètres se font sur une mauvaise piste de terre, bringuebalant les passagers qui tentent de dormir.
À l’approche de Porto Alegre do Norte se succèdent des tas d’arbres à moitié calcinés et des terrains en friche qui seront bientôt mis en culture. Un goudron tout neuf apporte un bref répit aux voyageurs pour les quelques kilomètres restants. Ici, l’agrobusiness est roi. Des tracteurs monstrueux envahissent la chaussée. Les panneaux publicitaires vantent les mérites de la technologie agricole et du maïs transgénique.
« Ici, tu ne meurs que si tu le cherches »
Dans Confresa, ville sans charme et désordonnée, les motos défilent en pétaradant entre d’énormes 4×4 aux vitres teintées et à la peinture maculée d’une poussière rougeâtre. Un soleil cru blanchit des constructions carrées qui bordent des allées dépourvues de verdure. Chez Luiz Bang, au contraire, l’herbe est bien tondue et des arbres fournissent une ombre salutaire. Sa maison, de plain-pied, est spacieuse mais sans luxe ostentatoire. Plusieurs pick-up gigantesques et reluisants sont garés le long d’un petit chemin en pierre blanche qui mène à l’entrée. La porte est ouverte.
Depuis la salle à manger où une dizaine de personnes sont attablées, Janete Bang me fait signe de les rejoindre. Deux clébards grognent quand je pénètre dans la pièce. Leur attention retombe vite sur des morceaux de poulet qui craquent sous leurs mâchoires. Luiz Bang demande quelques instants pour régler les détails d’une fête qu’il veut organiser. Quelques minutes après, il s’excuse et m’invite dans le salon où deux immenses photos montrent l’étendue de sa propriété vue du ciel.
À 62 ans, Luiz Bang, 1 mètre 90 et chapeau de cow-boy vissé sur le crâne, affiche un sourire satisfait quand on évoque « sa réputation ».Il parle parfois de lui à la troisième personne et veut établir sa vérité : « On dit beaucoup de choses sur moi, j’ai subi d’intenses campagnes de diffamation. » Il n’a, dit-il, jamais tué personne. Il est un homme « respecté ». La région n’est d’ailleurs pas si violente : « Ici, tu ne meurs que si tu le cherches. » Mais il prévient que « ceux qui causent à tort et à travers pour proférer des stupidités ou des mensonges meurent beaucoup » : « Ils finissent généralement avec la langue dans le cul. » Le reste du temps, Luiz Bang se montre plutôt enjoué, parle fort et s’empêtre dans d’interminables histoires. Lorsque je lui demande des précisions, son visage de vieux tonton rigolard se ferme.
À l’instar de dizaines de milliers de crève-la-faim, il suit la ruée vers le nord.
Né dans une petite ville pauvre en 1955, il grandit dans la misère jusqu’à son premier mariage à 20 ans. En 1977, il embarque son père, sa mère et sa femme vers le Mato Grosso, sans but précis, travaillant à droite à gauche. Des boulots harassants, les seuls auxquels il peut prétendre après avoir arrêté l’école en sixième. Il plante du riz, récolte du café, moule des briques. À l’époque, la dictature militaire encourage la colonisation de la forêt amazonienne présentée comme « une terre sans hommes pour des hommes sans terre ». À l’instar de dizaines de milliers de crève-la-faim, il suit la ruée vers le nord. Quelques mois de travail intense sans pouvoir mettre un sou de côté font naître chez lui une obsession : pour réussir, il devra être son propre patron.
Dans le sud du Mato Grosso, il rencontre un pilote de monomoteur qui lui parle d’un emploi possible dans une fazenda, un grand domaine, pour le compte d’une certaine dona Silvana : « Tu es grand et fort, et elle a du boulot pour des types comme toi. » Lui ne pose pas de questions et suit le pilote. Bang ne le sait pas encore, mais il a trouvé sa « reine ».
Gérante d’un fonds immobilier, dona Silvana a mis la main sur de nombreuses terres. Plusieurs immenses ranchs lui appartiennent. Elle en veut toujours plus et accroît le périmètre de ses propriétés en grignotant les terres voisines. Comme ses rivaux, elle recourt à la technique dite du « grilhagem » : s’approprier les terres de l’État à l’aide de faux documents authentifiés par des fonctionnaires corrompus. Le terme « grilhagem » vient d’un temps où les contrefacteurs laissaient des grillons morts se décomposer sur des titres de propriété fictifs, leur conférant ainsi un aspect ancien. Par ce moyen, d’immenses portions du Brésil passent entre les mains de propriétaires privés.
Pour le père José, membre de la Commission pastorale de la terre, « dona Silvana n’a jamais rien acheté, elle s’est servie ».En 2004, le gouvernement lui a confisqué ses biens fonciers à cause d’une histoire de fraude fiscale mais, pendant trois décennies, la « reine » s’est imposée sur ce coin oublié du Brésil.
Petit à petit, Luiz Bang devient son bras droit. Pour avoir accès à dona Silvana, tous passent par son intermédiaire. Avec sa puissance physique, sa violence, son courage et sa capacité d’organisation, il se distingue des autres « gatos » (littéralement « les chats »), ces gardiens armés qui, à l’occasion, font le coup de feu. Au domaine Frenova, Bang dirige jusqu’à mille vigiles.
Dans le même temps, des paysans sans terre affluent. Certains réclament leurs lopins, d’autres les occupent sans rien demander à personne. Les nervis de dona Silvana leur font comprendre qu’ils ne sont pas les bienvenus. Tous les moyens sont bons : incendie, menaces, chantages et meurtres. Luiz Bang se fait pistoleiro. Ironiquement, cet homme qui a passé une bonne partie de sa vie à expulser des familles avec ou sans titre de propriété me confesse qu’il ne possède toujours pas les papiers du terrain qu’il a acheté à dona Silvana et sur lequel il a construit sa villa : « J’ai toujours réglé les conflits sans faire couler une goutte de sang, à l’amiable, c’est ça qui m’a rendu célèbre », assure-t-il. Les locaux racontent tout autre chose.

La guerre des oreilles
À une quinzaine de kilomètres, dona Cecilia, 67 ans,reçoit au milieu d’une cinquantaine de chiens, chats, oies, poules. Elle prépare à manger sous l’auvent de sa cuisine. Sur le four en briques, des haricots rouges mijotent dans un autocuiseur.Petit bout de femme au visage mangé par les rides et aux cheveux grisonnants, elle a tenu tête au plus puissant tireur de la région. C’était en 1979. Luiz Bang débutait. « La première fois qu’il est venu, on ne savait pas que c’était un “pistoleiro”, il a juste dit qu’il travaillait pour Silvana et qu’on ne pouvait pas rester. On a répondu qu’on ne bougerait pas, il est parti sans insister. Quelques jours plus tard, il a détruit notre maison avec ses hommes. On a reconstruit. Plus tard, comme je rentrais à pied, il a essayé de m’écraser avec sa voiture. J’ai dû me jeter dans le fossé pour l’éviter. Pour finir, il a brûlé notre baraque. »
Luiz Bang tente de négocier avec son mari, mais dona Cecilia vient toujours mettre son grain de sel. « Ça l’a perturbé. C’est un macho. Les hommes sont comme ça ici. Si mon mari avait été seul, il serait déjà mort. » Elle sollicite l’appui de la police, du syndicat des travailleurs de la terre. Dona Cecilia va partout où elle peut trouver une oreille attentive. Même chez les concurrents de Silvana. « Celui qu’on appelle le Japonais, un des grands propriétaires du coin, m’a dit que la terre était à lui et que je pouvais rester dessus. Avec le recul, je crois qu’il voulait emmerder Silvana. »
Très souvent, les paysans pauvresse trouvent pris dans des conflits opposant deux propriétaires. Le premier encourage, voire paie des squatteurspour s’installer sur une parcelle convoitée. Considérant son bien envahi, le second envoie ses sbires. Parfois, les occupants mettent le feu au terrain pour le défricher. S’ils perdent le contrôle de leur brûlis, d’immenses incendies ravagent la région pendant la saison sèche, dévalorisant le fief du rival. Luiz Bang essaie d’amadouer dona Cecilia en lui faisant miroiter une terre meilleure, sans succès, puis finit par battre en retraite après lui avoir grappillé un ou deux hectares.
De temps à autre, les « pistoleiros » tuent au hasard un cultivateur. Une oreille en vaut bien une autre, et ça fait toujours un peu de pognon.
Dans les années 1980, la « guerre des oreilles » assoit définitivement sa notoriété. Des cadavres amputés de leurs pavillons auditifs commencent à proliférer dans la région. D’autres sont retrouvés avec la peau du visage arrachée pour ne pas être identifiés, « mais la plupart du temps, le corps disparaît purement et simplement »,remarque Maria José, avocate et membre de la commission des droits de l’homme de la paroisse de São Félix do Araguaia.La rumeur court que Luiz Bang se balade avec un collier d’oreilles à son cou. La raison de ces mutilations ? Avant de payer les tueurs, les commanditaires réclament désormais la preuve que le travail a bien été accompli. De temps à autre, les pistoleiros tuent au hasard un cultivateur croisé au bord de la route. Une oreille en vaut bien une autre, et ça fait toujours un peu de pognon.
Le prestige de Bang grandit. Très vite, il est plus demandé que ses collègues. « En 1985, après avoir résolu un problème avec cinq cents squatteurs, je suis devenu incontournable », dit-il avec fierté. Il réalise alors son vieux rêve et se met à son compte, tout en continuant à rendre des services à son ex-patronne.
« J’avais 12 ans. On était une quinzaine de familles avec pas mal de gosses. Pour ne pas être tués, nos pères étaient cachés dans la forêt. Très souvent, la nuit venue, on leur apportait à manger », se souvient Turana, fils d’un leader sans-terre. Aujourd’hui agent de santé, il a encore les mains crevassées par le travail de la terre et des cernes marqués. À l’époque, Bang ne se déplace plus pour ces broutilles, il dépêche ses porte-flingues. « Ils essayaient de nous intimider pour découvrir la cachette de nos parents. Ils gueulaient, nous secouaient. Ils nous foutaient sacrément les jetons. » Un jour, un membre du campement, un certain Zé « dos Cachorros », qui avait gagné ce surnom car il vivait entouré d’une dizaine de clébards miteux, disparaît en laissant ses animaux sur place. Il collaborait avec la paroisse et donnait l’alerte quand des pistoleiros rôdaient dans la région. Pas de cadavre, juste une flaque de sang dans sa baraque. « À partir de là, j’ai eu vraiment peur. » D’autant que les forces de l’ordre ne se déplacent pas pour un paysan assassiné : « Elles intervenaient uniquement quand un “pistoleiro” se faisait descendre. »
« Bang, l’homme aux décisions rapides »
Luiz Bang sillonne le nord du pays. Il devient chasseur d’esclaves. À l’époque, la forêt recouvre encore la région et quand un propriétaire s’empare d’un terrain, il commence par faire place nette en puisant dans la main-d’œuvre abondante pour déboiser. Les nombreux chômeurs acceptent sans poser de questions un labeur qu’ils croient bien payé. Le travail terminé, ils doivent rembourser le prix de leur voyage, la nourriture, leur équipement, l’eau… Tout leur salaire y passe et les voilà piégés. Les gatos, armes à la main les empêchent de fuir.
Durant sa jeunesse, Cascão a servi de chauffeur aux propriétaires. Ancien maire de Porto Alegre do Norte, il affirme que plus de 80 % des grands domaines ont eu recours à cette forme d’esclavage. La paroisse de la ville a recueilli des centaines de témoignages qui vont dans le même sens : des histoires de tortures, d’exécutions sommaires, d’humiliations et de châtiments…
De plus en plus puissant, Luiz Bang se lance en politique. Il s’exprime avec aisance. Ses qualités oratoires servent ses ambitions, son surnom aussi. Avant même de se présenter aux élections municipales de 1988, il est déjà connu de tous les électeurs. « Il n’y a qu’un Bang ! Bang, ça a un énorme impact sur les gens. Ma réputation va du Pará au Maranhão, même au Congrès à Brasília on sait qui je suis. » Son tableau de chasse lui tient lieu de programme, ses slogans font allusion à ses talents : « Bang, l’homme aux décisions rapides »,ou « Bang sur eux ». Rien à voir avec les armes, jure-t-il. « Ça veut dire que je vais surpasser tous mes adversaires. » Son marketing agressif ne convainc pas, il est battu.
Maintenant tu vas couper le son de ton machin ou une balle va venir te chatouiller les dents.
Luiz Bang
À l’annonce de son échec, Bang réagit en pistoleiro : « Tout ça c’est de la fraude, je vais pas laisser passer ça. » Et, en effet, il ne laisse pas passer « ça ». Lorsque les haut-parleurs d’une petite camionnette appartenant à son rival diffusent un message de victoire, il extirpe le chauffeur du véhicule et lui enfourne son pistolet dans la bouche. L’acier froid de l’arme écrase les dents de l’homme. « Maintenant tu vas couper le son de ton machin ou une balle va venir te chatouiller les dents. »
Apprenant l’agression, le maire porte plainte et rentre se claquemurer chez lui. Le bruit court que des tueurs sont à ses trousses. Depuis son installation dix ans plus tôt, sa maison a été incendiée et il vit constamment menacé de mort. L’édile est presque arrivé chez lui quand un pick-up déboule dans un crissement de pneus et se met en travers de sa route. Au volant, le frère de Luiz Bang. À bord, quatre pistoleiros, deux aux fenêtres, deux autres debout à l’arrière. Qui canardent sa voiture. Le maire et son garde du corps sont touchés chacun par deux balles. Les pistoleiros déguerpissent en mitraillant autour d’eux.
Attablé trente ans plus tard dans un restaurant de Belo Horizonte, l’ancien élu a troqué sa barbe touffue contre de longs cheveux grisonnants. « J’ai préféré faire une croix sur cette histoire, c’est la première fois que j’en reparle », murmure-t-il la gorge nouée. Lorsque je lui rappelle ce passé, Luiz Bang plaide non coupable. Comme à son habitude, il préfère accabler ses proches assassinés, des pistoleiros notoires : « Domingão, Raimundão, Tio do Gado, Caipixaba…, ils étaient tous ultraviolents et provocateurs. Moi j’étais plus discret, prêt à discuter, mais je suis ferme, c’est vrai. Bien sûr que j’avais des armes, deux revolvers et un couteau, mais à l’époque, c’était comme ça. Ce n’était pas contraire à la loi, c’était la loi. »

Le début des ennuis
À l’entendre, le simple fait d’avoir survécu quand tant d’autres sont morts prouve son innocence. « Si j’avais été comme eux, on m’aurait aussi buté. Quand tu tues quelqu’un, il a un fils, un cousin, un frère… Quelqu’un qui va forcément le venger. » Un peu plus tard, il explique pourtant avoir un jour échappé à une embuscade de squatteurs : « Je n’ai pu m’en sortir que grâce à la forte escorte qui ne me quittait jamais à l’époque. » Ce n’est pas la seule fois qu’il se contredit.
Ces calomnies émanent, dit-il, des « gens de la paroisse » regroupés autour de l’évêque dom Pedro Casaldáglia, son ennemi juré. « Ce monsieur m’a persécuté. À chaque incident, j’étais désigné comme le fautif. On m’a accusé d’avoir tué un sénateur, découpé des paysans à la tronçonneuse. » Opposé aux abus de la dictature dans les années 1970, le prélat s’est rangé du côté des plus faibles. Tout en se disant très croyant, Luiz Bang ne décolère pas contre ce « père rouge » aujourd’hui affaibli par un Parkinson : « Un évêque se doit d’être bien mis, pas de marcher en habit de paysan comme ce monsieur qui a toujours prêché la pauvreté quand je voulais le développement. »
Malgré les lourds soupçons pesant sur lui dans l’attentat contre le maire, Luiz Bang se représente aux élections en 1992 en endossant le rôle d’un personnage typique du Nordeste du Brésil, le « coronel », un mélange de seigneur sanguinaire et de patriarche venant en aide à tous. « Je crois qu’aujourd’hui on ne résout plus les choses à coups de feu, j’ai rangé mes flingues », déclare-t-il dans un journal local. Pour convaincre, il use de la cachaça, un alcool de canne à sucre très prisé. Le jour du scrutin, la ville est pleine de gens venus des campagnes, brandissant des bouteilles de gnôle et des billets de cent sous. « Une bonne partie de la population s’en foutait pas mal de l’élection, donc autant voter pour le type de la cachaça », raconte un petit agriculteur. Luiz Bang est élu.
Bang a fait disparaître tous les documents de propriété anciens. Ça l’a énormément aidé pour s’emparer des terres domaniales.
Un opposant de Luiz Bang
« Cette ville n’a pas connu un meilleur maire que moi. Tous les autres étaient des incapables et des voleurs. » Le pistoleiro insiste : « On dit tout et n’importe quoi sur moi, mais on ne m’a jamais traité de voleur. Celui qui le fait recevra une visite et devra s’en expliquer. » Ses opposants sont catégoriques : « Sa gestion a été désastreuse, il a fait disparaître tous les documents de propriété anciens. Ça l’a énormément aidé pour s’emparer des terres domaniales. » Pour son plus grand profit : le territoire de sa commune s’étend sur 4 000 kilomètres carrés, soit presque le triple de l’immense mégalopole de São Paulo.
C’est après son premier mandat, non renouvelable, que Luiz Bang connaît ses premiers ennuis. Comme d’habitude, il assure n’avoir rien fait et plaide le malentendu. Peut-il être tenu pour responsable des actes de son ami « Chapéu Preto », le « Chapeau noir », un tueur régnant sur des dizaines de mines d’or à 400 kilomètres à l’ouest de Confresa ? « Chapéu Preto n’employait pratiquement que des esclaves. Il travaillait main dans la main avec Luiz Bang. Ensemble, ils allaient chercher des travailleurs loin dans le Pará ou le Maranhão. On en a recueilli qui s’étaient évadés. Quand ils tombaient malades, leurs maîtres les laissaient crever, parfois ils les achevaient », raconte Seu Nico, un paysan d’une soixantaine d’années. Arrêté à l’occasion d’un contrôle de l’inspection du travail, Luiz Bang sort de prison au bout de deux mois.
Trois ans plus tard, il retourne derrière les barreaux pour vandalisme lors d’un conseil municipal. La secrétaire qui prenait en note les débats raconte, en faisant attention à ne pas citer Bang nommément, comment « un homme est venu avec ses alliés » pour « destituer le maire » de l’époque. « Ils ont tout saccagé. Des chaises volaient, ils se donnaient des coups en poussant des hurlements. Pensaient-ils vraiment que le maire allait quitter son poste une fois qu’ils auraient fini de tout casser ? » Le tueur ne semble pas comprendre que les mœurs changent.
Le temps de la justice
En 2006, dix-huit ans après les faits et grâce aux efforts d’un jeune procureur, Bang est accusé de tentative de meurtre contre Cascão, l’ancien maire de Porto Alegre do Norte, et son garde du corps. Quelques jours avant son procès, il croise une femme à la sortie d’un supermarché. « Tu vas être dans mon jury hein ? Fais gaffe ! », lui lance‑t‑il. Le procureur Leandro Volochko demande sa mise en détention provisoire, le juge réclame une protection. « La ville s’est remplie de policiers. L’ambiance était très tendue, tout le monde tremblait », se souvient Leandro Volochko.
La veille de l’audience, le procureur reçoit un appel : « Je veux juste vous faire passer un message : Chapéu Preto est en ville pour vous flinguer. » Le magistrat ne connaît pas ce « Chapeau noir » mais comprend la gravité de la situation à la mine de ses collaborateurs. Quelques secondes plus tard, le téléphone sonne à nouveau : « Chapéu Preto se déplace dans une voiture blanche, une Golf. » Lorsqu’il prévient le juge, ce dernier s’inquiète : « Hum, ce matin, une Golf blanche est passée devant ma fenêtre très lentement, comme si on voulait reconnaître les lieux… »
Le procès de Luiz Bang dure trois jours. Ses avocats concentrent leurs attaques sur l’ancien maire et le prélat, tous deux présents aux audiences. « Notre client ne devrait pas être ici, il a sauvé la région du péril rouge ! Les vrais coupables sont le maire et un homme que je ne qualifierais pas d’église ! Deux communistes convaincus, qui prônent le chaos et la révolution ! Bon nombre d’assassinats peuvent être mis sur le dos de ces criminels ! » Le pistoleiro refuse de répondre aux questions, sauf une. Quand le procureur lui demande d’où lui vient son surnom, il sort de son mutisme : « C’est parce que je suis beau comme un acteur de film de bang-bang. »
Acquitté, l’ex-accusé croise l’épouse du procureur à la sortie du tribunal. « Ton mari est bon, vraiment bon. Il ira loin, très loin… »,lui dit-il, pointant son doigt vers le ciel. La femme du magistrat le regarde, sans saisir l’allusion. Luiz Bang insiste : « Vous avez des enfants ? Il faut en faire vite, on ne sait jamais… » Le couple quitte la région sous escorte policière, sans prévenir personne, par crainte d’une embuscade.
Accusé d’escroquerie, d’assassinat, de torture, de chantage et d’esclavage, il reste seize jours en prison.
Luiz Bang se croit intouchable, il se trompe. Le 3 juillet 2009 au petit matin, des policiers fédéraux le surprennent à son réveil. L’État brésilien a lancé une gigantesque enquête sur les détournements de terres dans la vallée de l’Araguaia. Le voilà pris dans la tourmente de l’opération « Plume » qui met en cause une vingtaine de personnalités, dont plusieurs officiers de police, maires, députés, magistrats et industriels de l’agroalimentaire. Luiz Bang est désigné par les enquêteurs comme « l’un des plus actifs du groupe ». Il est « connu et craint par tous, non seulement pour sa violence sans pitié mais aussi pour ses accointances avec les pouvoirs locaux », écrivent-ils dans leur rapport. Accusé d’escroquerie, d’assassinat, de torture, de chantage et d’esclavage, il reste seize jours en prison.
Un mois plus tard, le voilà à nouveau arrêté par la police fédérale, cette fois pour une affaire de fraude à la caisse des retraites et des pensions. Incarcéré un an et demi, il dit n’avoir pas souffert de l’extrême violence des pénitenciers brésiliens. « Le mec qui fait le malin, je sais le remettre à sa place. Quand je circulais dans la taule, ça murmurait : “Regarde c’est Bang…, il est dangereux.” Du coup, je n’avais pas de problèmes. »
Lorsqu’il retrouve la liberté en 2011, la région n’est plus la même. Certes, les propriétaires continuent de batailler pour le contrôle de la terre, le soja ayant fait exploser les cours du foncier. Certes, les policiers « touchent » toujours. Mais le temps des tontons flingueurs s’achève. « La vallée est calme maintenant, les investisseurs peuvent venir en toute tranquillité », assure le nouveau président du syndicat des travailleurs ruraux. Qui prend en exemple le cas de Bang : « Autrefois à l’école, ses enfants étaient la terreur de la récré. Personne n’osait protester par peur du paternel, pas même les profs. Plus personne n’inspire une telle crainte aujourd’hui. »
Valdo, un petit paysan, annonce lui aussi la fin de l’ère Bang : « C’est un homme d’action, pas un stratège. Sous la loi du plus fort, il était le roi. Mais le monde est devenu plus complexe. Beaucoup de ses alliés sont morts. Dans ce business, tu es fort si tu peux compter sur des complicités. » Bang lui-même a conscience d’appartenir au passé : « Je suis un survivant », dit-il.
Sa vie adaptée à l’écran ?
Il habite toujours à Confresa, mais développe ses activités plus au nord, dans le Pará, la nouvelle frontière d’une forêt amazonienne qui se rétracte comme une peau de chagrin. Sur ces terres septentrionales où l’État a bien du mal à imposer son autorité, il peut encore espérer donner la mesure de ses talents : « De nos jours, si tu embauches un type au black dans un champ, tu es taxé d’esclavagiste. Là-haut, les choses sont plus simples. »
Dans cette contrée réputée pour ses gisements d’or, il s’arroge des concessions. « Le territoire à couvrir est immense et difficile d’accès, on ne peut pas y aller en voiture », se lamente le coordonnateur de la lutte contre le travail forcé dans les mines d’or. Luiz Bang s’y rend en avion. Ses puits, dit-il, sont parfaitement aux normes. Et qu’importe si l’organisme de supervision n’a nulle trace de lui dans ses dossiers !
À Novo Progresso où Bang possède une prospection, Marcos, un creuseur artisanal, secoue la tête : « Tous le craignent ici. Moi, je n’ai jamais bossé pour lui, mais je ne tenterais pas le coup. » Le creuseur indique un bar où rencontrer un de ses collègues qui a travaillé avec Bang. C’est un petit bouiboui en bois, à l’air étouffant, où un jukebox crache un reggae romantique qui fait se déhancher un quinquagénaire en sueur. Le collègue de Marcos est attablé, seul. On partage une bouteille de bière, puis deux, puis trois. On parle. J’aborde le sujet Bang, il se lève : « Laisse-moi, je veux rien avoir à faire avec ça. Tu ferais mieux de partir toi aussi. »
Ma vie est une succession d’aventures. Dix millions, ça doit suffire pour faire un film de qualité ?
Luiz Bang
Une grande exploitation peut rassembler huit cents mineurs, celle de Luiz Bang en compte cinquante. Il leur octroie 4 % du minerai extrait, une misère. Il en a marre de chercher de l’or : « C’est trop fatigant. Je vais filer ma concession à un mec en échange d’un pourcentage, comme ça je pourrais me concentrer sur ma ville. » Le tueur n’envisage pas de prendre sa retraite, il préfère évoquer les temps passés avec nostalgie, les bals où femmes et alcool ne manquaient jamais, les bagarres à coups de poignard ou de revolver. « C’était dangereux, mais on vivait. »
À la fin de la discussion, il me fait part de son projet d’adapter son histoire à l’écran. « Ma vie est une succession d’aventures. Dix millions, ça doit suffire pour faire un film de qualité ? » Je lui réponds que oui. Rassuré, il discute du scénario : « Je vais rester en ville pour m’entraîner, retrouver mes réflexes et montrer combien je suis habile. Ça fait longtemps que je n’ai pas tiré. »
Le 28 janvier dernier, mon téléphone se remplit de messages au petit matin : « Tu as vu ce qui est arrivé à Bang ? Il vient d’être assassiné ! » Pour la mort du tueur, la municipalité de Confresa décrète un deuil officiel. La police annonce, elle, « une enquête complexe » : « Beaucoup de gens pouvaient lui en vouloir. » « L’or, c’est très risqué », me dit un homme des terres septentrionales qui doute que l’on retrouve un jour le coupable. « C’est comme ça le Brésil. »