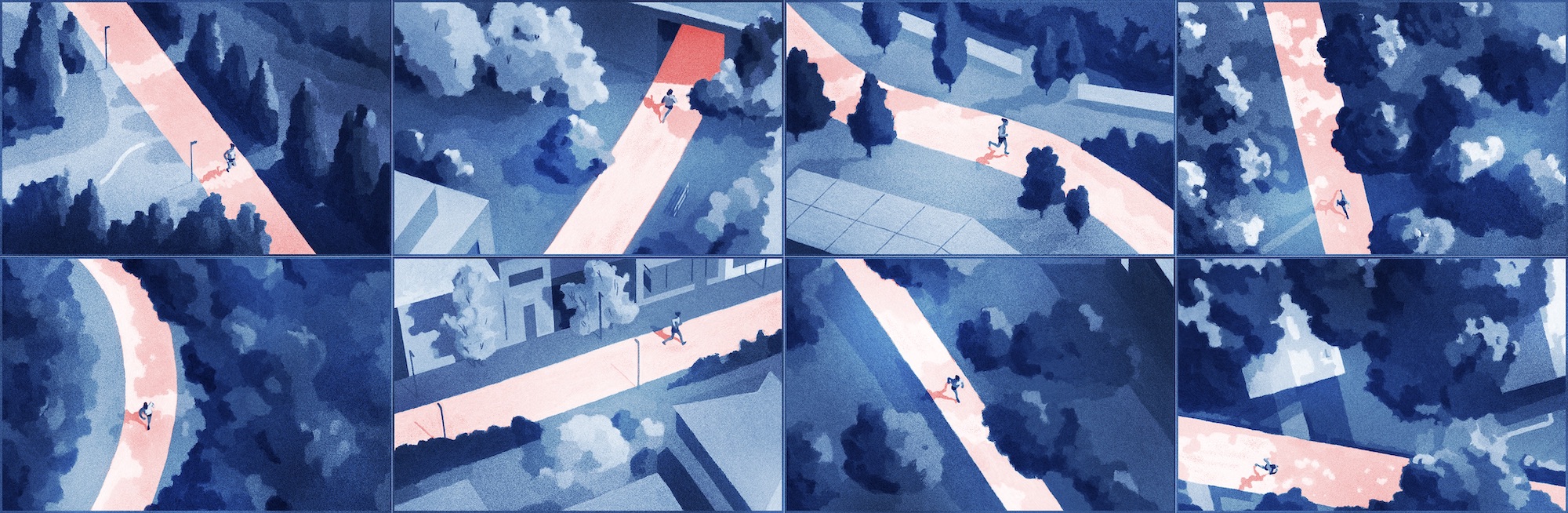La France possède le deuxième espace maritime mondial, avec 10,9 millions de km2 de mer, juste derrière les États-Unis. Que recouvre cette expression ?
Virginie Saliou : Par « espace maritime », il faut entendre principalement la mer territoriale et la zone économique exclusive (ZEE) : la zone située au-delà du littoral d’un État, de la ligne où la mer se retire à marée basse – la « laisse de basse mer » – jusqu’à 200 milles marins (370 km) au large. C’est un cadre juridique défini par le droit de la mer, dans la convention de Montego Bay de 1982. Dans sa ZEE, un État peut exploiter les ressources marines, y compris du sol et du sous-sol. Concrètement, pour avoir le droit de pêcher ou d’organiser une mission scientifique dans la ZEE française, par exemple, un autre État doit demander une autorisation à la France, qui est libre de la donner ou non. En contrepartie du pouvoir d’octroyer ces autorisations, la France est obligée d’accorder à tous les pays la liberté de circulation des navires, et le droit de faire passer des câbles sous-marins. Cette réglementation s’applique partout dans le monde. C’est l’un des textes internationaux les plus appliqués, même si les États-Unis ne l’ont pas ratifié. Il n’est pas toujours simple à comprendre, mais si l’on prend une référence terrestre, c’est un peu comme si on autorisait les voitures à traverser les champs agricoles.
En quoi l’espace maritime français est-il remarquable ?
Notre espace maritime possède une originalité : il est réparti sur l’ensemble de l’océan mondial, à l’exception de l’Arctique. 97 % de cet espace se situe en outre-mer, c’est-à-dire au-delà des mers de la métropole, ce dont les citoyens n’ont pas toujours conscience. De cette manière, la France est voisine d’une trentaine de pays, ce qui en fait un cas unique. Rien qu’avec l’Australie, par exemple, nous partageons 3 100 km de délimitation maritime. Cela implique entre autres une collaboration entre nos deux pays dans la lutte contre la pêche illégale ou le trafic de drogue, lequel prend sa source en Amérique latine et traverse les ZEE françaises avant d’entrer dans la ZEE australienne.
Quels sont les critères qui définissent la puissance maritime d’un pays ?
L’étendue géographique est bien sûr un atout, mais cela ne suffit pas pour définir la puissance maritime. Celle-ci s’appuie sur trois aspects : la capacité à agir en mer, la capacité à convaincre ses partenaires de collaborer, et le fait de croire en ses capacités. Sur le premier point, la France se distingue par la compétence opérationnelle de sa marine, qui intervient sur des opérations tant civiles – protection de l’environnement (par exemple la lutte contre les marées noires), sécurité de la navigation, etc. – que militaires – sûreté, défense nationale, antiterrorisme, etc. La fluidité du commandement est exemplaire : les préfets maritimes peuvent mobiliser et coordonner des moyens civils tout autant que militaires, ce qui fait gagner du temps en cas de problème. Sur le second aspect, la France est écoutée par ses partenaires lorsqu’il s’agit d’opérer en commun. On le voit par exemple avec l’opération européenne Aspides lancée en février 2024 pour défendre la liberté de circulation des navires en mer Rouge face aux attaques des houthistes. La France a participé au cadrage de cette opération, et un Français fait partie du commandement.
Il y a un vrai déficit de culture des enjeux maritimes dans la classe politique française, même si c’est en train d’évoluer doucement.
Mais notre pays est moins bon en ce qui concerne ce que j’appelle « le croire » : nous ne mettons pas assez en avant ce que nous savons faire. Or il est certain que la France possède depuis longtemps une forte légitimité dans le domaine maritime. C’est dû notamment au fait que sa flotte militaire couvre un large spectre d’interventions, de la dissuasion nucléaire à la protection de l’environnement. Ses navires militaires hauturiers [de haute mer, NDLR] sont capables de naviguer longtemps, en autonomie, autant dans le Pacifique qu’en Arctique. La Marine nationale possède au total 116 bâtiments dont 75 de combat, et quatre sous-marins lanceurs d’engins. C’est peu, comparé à la flotte américaine ou chinoise, qui avoisinent chacune les 400 bâtiments, mais la marine française sait tout faire, ou presque. La France est ainsi capable de mener des exercices militaires interalliés – quand par exemple deux membres de l’Otan s’entraînent ensemble à une réponse militaire – au même niveau de compétence que les États-Unis.
Comment se traduit ce déficit de croyance en ses capacités ? Un rapport sénatorial de 2022 pointait notamment la difficulté pour les gouvernements successifs et les entreprises à développer l’activité économique maritime au-delà de la métropole.
Il y a un vrai déficit de culture des enjeux maritimes dans la classe politique française, même si c’est en train d’évoluer doucement. L’imaginaire et les représentations restent centrés sur la métropole. On le voit dans l’enseignement – mais pas uniquement : on y parle surtout de l’Hexagone, or il faudrait parvenir à penser la France comme un archipel. Le processus décisionnel reste très centralisé, ce qui n’aide pas. Depuis le Grenelle de la mer de 2009, une stratégie globale de la mer est élaborée, et tout ce qui concerne les territoires ultramarins fait l’objet de documents dédiés. C’est un progrès.
Plus globalement, la question maritime en tant que telle n’est apparue dans les programmes des partis politiques qu’en 2022. Auparavant, ils en avaient une analyse sectorielle – pêche, ports, défense… Leur approche ne s’est élargie que récemment ! Peut-être parce que les sujets que cette question recouvre ne sont pas considérés comme assez clivants, et ne visent pas un électorat spécifique.
L’influence d’un pays sur les mers ne dépend pas uniquement de sa puissance militaire. Comment la France se positionne-t-elle dans les autres domaines ?
D’abord, le pays se situe au 26e rang mondial pour la flotte de commerce, avec 420 navires sous pavillon français dans un contexte de forte augmentation du trafic commercial : le nombre de navires commerciaux dans le monde est passé de 50 000 en 2013 à 95 000 en 2024 ! Plusieurs éléments permettent cependant de relativiser ce « mauvais » classement : la France dispose de leaders, comme CMA CGM, et se distingue par la qualité de sa flotte. Les navires sous pavillon français sont en effet deux fois plus jeunes que la moyenne mondiale, avec environ 7 à 8 ans d’âge. Autres points forts : la qualité de la formation aux métiers marins, le contrat social entre employeurs et marins, et le souci porté à l’environnement.
Du côté de la pêche, ensuite, la France se situe au 31e rang mondial en matière de captures. Cette activité relève d’une compétence exclusive de l’UE, qui est la seule entité politique mondiale à avoir réduit les quantités pêchées ces dix dernières années. L’objectif des normes européennes est également d’améliorer les conditions de vie des pêcheurs, alors que la profession n’attire plus.
Enfin, la France possède une flotte scientifique assez importante, de 18 navires, dont quatre hauturiers capables de naviguer partout, excepté en zone polaire. L’Ifremer, l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer, qui vient de fêter ses 40 ans, jouit d’une réputation internationale. Pour résumer, la France peut donner l’impression d’une puissance maritime moyenne, mais elle a la capacité d’intervenir dans l’ensemble des domaines impliquant la mer. L’une de ses limites actuelles réside dans les moyens alloués. Dans les années 2000, le budget de la défense, et donc de la marine, a progressivement été réduit, avant d’être revu à la hausse. L’Ifremer, de son côté, connaît une crise budgétaire en raison de l’inflation, ce qui met en péril ses activités.
Quels sont les défis à relever, par la France mais aussi les autres puissances, dans les années à venir ?
Le contexte international est celui d’une augmentation de la dépendance à la mer – en raison de l’épuisement des ressources terrestres notamment, ce qui accroît la compétition entre États. Protéger ses espaces maritimes des violations du droit international est de plus en plus crucial. Pour la France, il s’agit d’être plus vigilante sur ses espaces ultramarins. Ces zones sont loin des yeux ! Même si la surveillance satellitaire a fait des progrès et permet de repérer des infractions, il reste très difficile de contraindre ceux qui violent le droit international. On l’a vu, par exemple en 2013 dans la ZEE française autour des îles Éparses, au large de Madagascar, quand un navire singapourien a été intercepté en pleine prospection pétrolière sans aucune autorisation.
Le premier défi mondial reste cependant le pillage des ressources halieutiques. 90 millions de tonnes de poissons capturés sont déclarées par an, alors que la consommation mondiale, en 2018, était de 179 millions de tonnes – et devrait atteindre 204 millions en 2030. L’aquaculture n’explique pas seule ce différentiel ! La France s’est par exemple engagée aux côtés des États du golfe de Guinée pour lutter contre la pêche illégale. Enfin, il faut assurer la surveillance des 448 câbles sous-marins, grâce auxquels 99,1 % des échanges communicationnels se font. À titre d’exemple, 4,5 milliards de personnes dans le monde sont reliées par les câbles qui partent de Marseille (entre autres vers le Maghreb et l’Asie) ! Le chalutage en eaux profondes, les séismes, les morsures de requins ainsi que les ruptures intentionnelles constituent de sérieuses menaces.
La compétition concerne également les fonds marins. Beaucoup d’États, aux premiers rangs desquels la France, ont étendu leur plateau continental ces dernières années. En quoi cette démarche est-elle stratégique ?
L’extension du plateau continental consiste à prolonger le continent sous la surface de la mer, jusqu’à la pente qu’on appelle « talus continental ». Chaque ZEE inclut une partie de ce plateau. Chaque pays a le droit d’exploiter le sol et le sous-sol dans la limite de sa ZEE, mais au-delà, les fonds marins relèvent d’une zone internationale, reconnue patrimoine commun de l’humanité – et donc a priori inexploitable sans l’autorisation de l’Autorité internationale des fonds marins. La convention de Montego Bay a cependant prévu la possibilité, pour chaque État signataire, de déposer auprès de l’ONU des demandes pour obtenir le droit d’exploiter le sol et le sous-sol maritimes jusqu’à 150 milles marins (278 km) au-delà de leur ZEE. Ces demandes sont examinées par l’ONU, à condition qu’elles ne concernent pas des zones litigieuses, comme c’est le cas par exemple entre Chypre et la Turquie. L’ONU n’arbitre pas sur des différends maritimes, mais sur des aspects scientifiques, ce qui pousse les pays à coopérer. Les enjeux sont importants en matière de recherche, de protection, mais aussi d’exploitation. On pense aux ressources minières mais aussi génétiques : de nombreuses espèces des fonds marins sont exploitées ou exploitables dans l’élaboration de médicaments, par exemple.
La France s’est lancée en 1998 dans ce projet d’extension de son plateau continental, sous la houlette du secrétariat général de la mer et de l’Ifremer. Chaque demande s’appuie sur le travail préalable de missions scientifiques pour démontrer que la zone d’extension fait bien partie – géologiquement parlant – du plateau continental du pays. Onze dossiers ont ainsi été déposés par la France, souvent en coopération avec d’autres États, comme l’Afrique du Sud pour la zone autour de l’archipel de Crozet dans l’océan Indien. Aujourd’hui, il en reste cinq en cours d’instruction – le processus prend énormément de temps. Si la France obtient gain de cause sur toutes ses demandes, elle aura ainsi gagné quelque 729 000 km2 de plateau continental supplémentaire, soit près d’une fois et demie la surface de la métropole ! L’enjeu est avant tout politique : revendiquer ses droits, c’est une façon de s’affirmer. Mais il s’agit également de faire de la recherche pour augmenter les connaissances, et ensuite mieux protéger ou exploiter ces milieux.