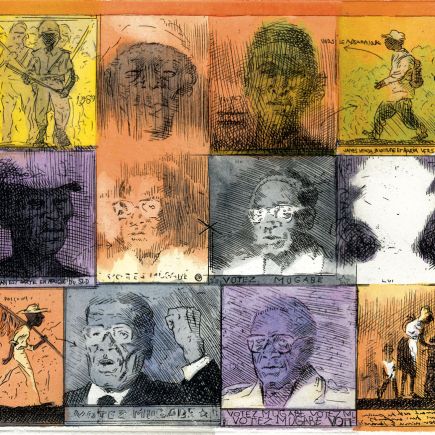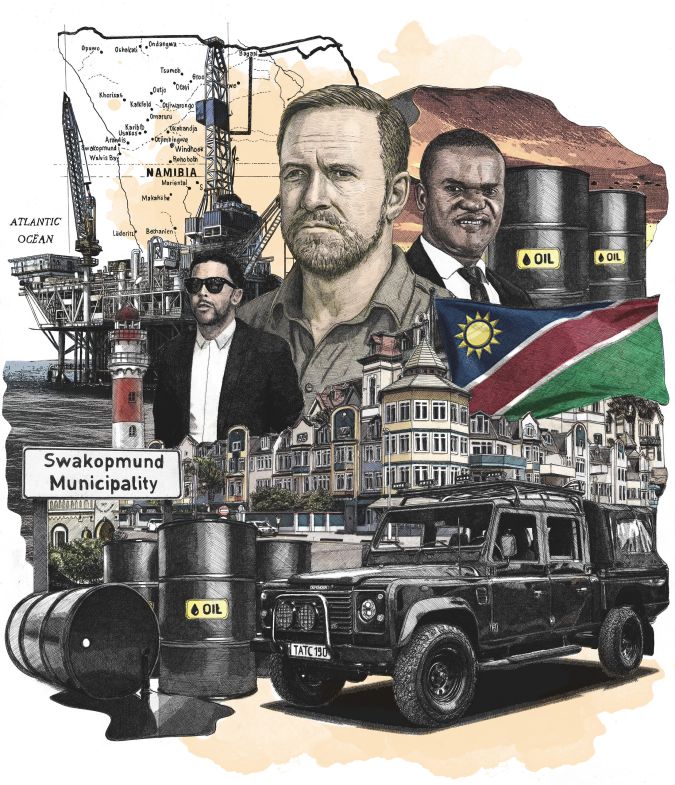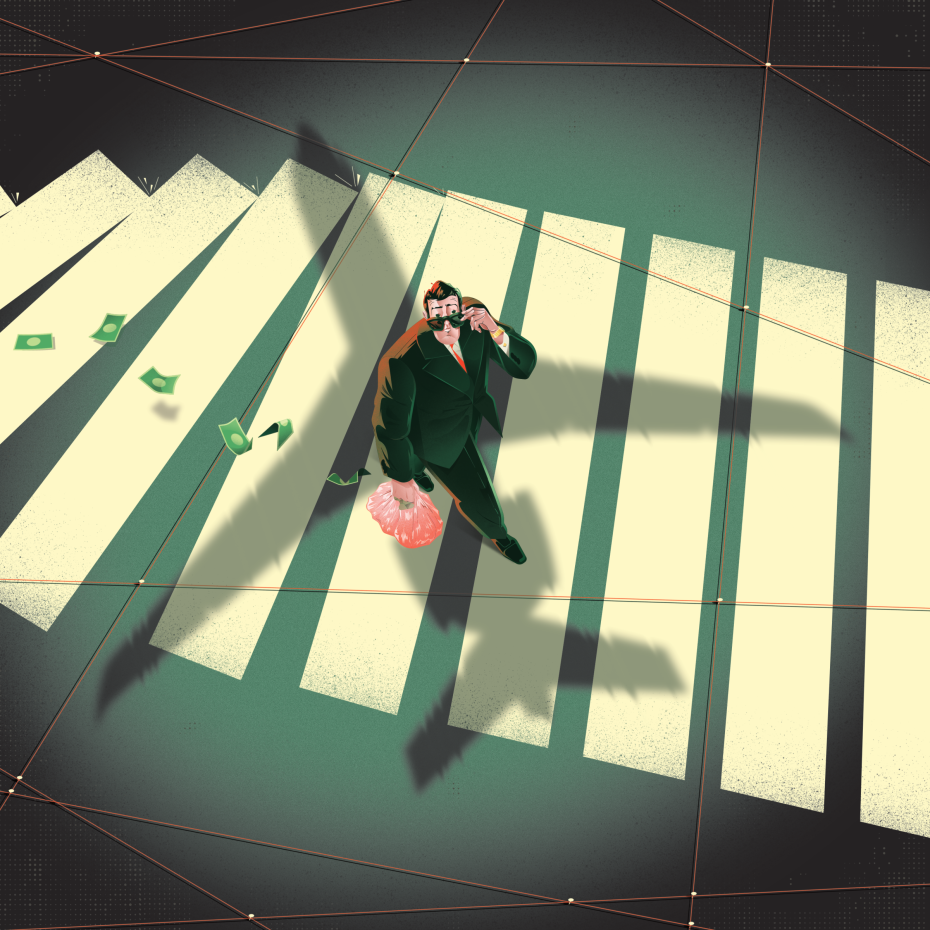« Et toi, c’est quoi ton rêve ? » C’est la question que je pose toujours aux étudiants de l’école de « storytellers » que j’ai fondée il y a quelques années au Nigeria. Ne riez pas de mon anglicisme… Au départ, j’avais imaginé une école de journalisme, à l’ancienne, comme celle qui m’a formée il y a vingt ans. Journalism School of Lagos. Ça sonne pas mal, non ? Mais tous mes associés nigérians m’ont dissuadée de l’appeler comme ça. « “Journaliste”, c’est pour les boomers », paraît-il. Alors j’ai fait semblant de ne pas me vexer, et on l’a appelée StoryMi Academy. « Mon histoire », en dérivé de la langue yoruba.
À StoryMi, des profs – nigérians, essentiellement – donnent des cours d’écriture, de film documentaire, de photojournalisme… et moi je me réserve toujours la séquence « comment se présenter aux éditeurs/producteurs ». Les étudiants se succèdent devant la classe, et doivent dire ce qui leur a donné envie de devenir journalistes (enfin, « raconteurs d’histoires du réel »), et ce qu’ils rêvent de « devenir plus tard ». Je dois souvent ajouter pour les encourager : « Vas-y, imagine que tout est possible. Si tu avais tout, qu’est-ce que tu ferais ? »
Innocence
Les réponses ne tardent pas à pleuvoir. « Je veux que mes enquêtes changent les lois ! » « Je veux casser les stéréotypes sur ma communauté ! » « Je veux que le monde entier parle de mon quartier, de ma famille, de mon hôpital ! » « Je veux bâtir les archives de mon pays ! » « Je veux fonder un journal en yoruba pour que ma langue ne disparaisse pas ! » Et toi, tu te vois où ? « Sur Netflix ! » « Aux Oscars ! » « Aux Grammys ! »
Ah oui, j’ai oublié de vous dire. Au Nigeria, pays le plus peuplé d’Afrique avec 235 millions d’habitants, dont les stars du cinéma et de l’afrobeats comptent des dizaines de millions de followers ou remplissent les stades du monde entier, on voit grand. Et on a l’innocence de croire qu’on peut changer le monde avec des histoires.
Quand je suis arrivée pour la première fois à Lagos, en 2014 – dans une autre vie et une autre époque –, les Nigérians étaient considérés comme « le peuple le plus optimiste au monde ». Je ne parierais pas sur la méthodologie de l’étude… mais je peux vous garantir qu’en tant qu’observatrice, je valide.
Aujourd’hui, après deux récessions, une inflation à deux chiffres depuis cinq ans, une dévaluation monstrueuse de la monnaie, une insécurité diffuse, après plusieurs émeutes matées dans le sang et un record absolu de 31 millions de personnes souffrant de faim aiguë, l’optimisme en a pris un sacré coup. Mais les rêves, eux, sont restés. L’école et les étudiants aussi, et avec plus d’envie encore de raconter ce qui les entoure.
Croire aux histoires
Moi, finalement, je suis partie. La crise économique et ses pénuries auront eu raison de moi. Je suis rentrée vivre à Paris et j’interviens désormais comme « prof » au CFJ, le Centre de formation des journalistes. J’en suis très heureuse, j’adore la transmission et être nourrie par les idées des nouvelles générations.
Le jour de la rentrée des deuxièmes années de master, j’ai ressorti mon exercice : « Allez, c’est quoi ton rêve le plus fou ? Pourquoi t’as voulu devenir journaliste ? » (Ici, j’ai le droit de le dire, j’en profite.) Il y a eu quelques rires étouffés. Une petite gêne a traversé la pièce – c’était la rentrée, on s’apprivoisait tous encore un peu. Ils se sont regardés. Un ou deux ont osé avancer qu’ils aimeraient bien un jour faire une enquête collaborative, écrire un livre ou avoir une émission de radio. Avant de se raviser : « Mais bon, on sait que ça ne sera pas possible. »
J’avais envie de leur glisser que si la jeunesse nigériane, sans grands moyens ni grandes écoles, pouvait y arriver, alors il n’y avait pas de raison de douter. Comment pouvons-nous avancer ensemble, en tant que pays, si notre jeunesse même s’interdit de rêver ?
On ne choisit pas ce métier par hasard, du moins je le crois. À moins d’être totalement inconscient, on ne choisit pas de préparer un concours aussi difficile quand les rédactions les unes après les autres multiplient les plans sociaux, quand l’extrême droite est aux portes du pouvoir, quand la confiance des Français dans les médias s’est évaporée, et quand l’intelligence artificielle et les réseaux sociaux menacent chaque jour un peu plus de vous dévorer tout cru. Il faut quand même avoir un peu envie d’y croire. Je veux dire, il faut bien croire que les histoires peuvent changer le monde pour vouloir encore les raconter.
Choses vues, choses lues, vécues ou ressenties : dans ces chroniques, Revue21 capture un fragment de l’époque dans ses bouleversements minuscules ou majuscules.