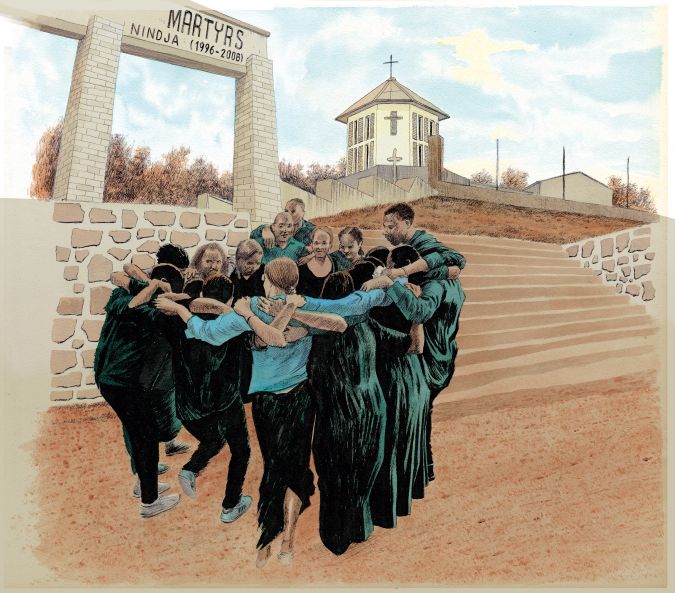En 2022, alors que Lorenzo Meloni photographie la Seine entre nature et usines, de Paris au Havre, il découvre qu’il existe sur les berges du fleuve une plante invasive familièrement appelée l’arbre aux papillons (ou buddleia). Importée de Chine durant la seconde révolution industrielle, elle a remplacé en grande partie la végétation originelle. « Très résistante, elle pousse surtout sur les sols industriels et pollués. Son odeur attire les papillons au point de les rendre accro, et pourtant son nectar n’est pas assez nourrissant pour eux et ses feuilles sont mêmes toxiques pour les chenilles », explique le photographe, plutôt habitué aux terrains de guerre. Avec ses fleurs violettes et ses allures de métaphore de la relation de l’être humain avec l’environnement, cette curieuse découverte va devenir le fil rouge de Lorenzo Meloni dans le projet qu’il réalise dans le cadre de la grande commande de photojournalisme de la Bibliothèque nationale de France. Initiée sous l’égide du ministère de la Culture et intitulée « Radioscopie de la France : regards sur un pays traversé par la crise sanitaire », cette commande a missionné 200 photographes pour dresser le portrait du pays au sortir de la pandémie de Covid-19.
D’avril à septembre 2022, l’Italien, qui réside en France, parcourt les 500 kilomètres de berges très industrialisées de la Seine. En grande partie à vélo électrique : « Cela m’a permis d’être au plus près de l’eau, de faire des repérages, de découvrir des endroits auxquels je n’aurais pas eu accès en voiture, pour y retourner ensuite. » Il découvre une industrie encore très présente et « une pollution importante et visible ».
Le drone pas expressément interdit
À l’embouchure du fleuve s’élève Le Havre avec son port, apothéose du monde industriel et étape incontournable du projet au long cours désormais baptisé L’Arbre aux papillons. Certaines parties de la zone portuaire sont accessibles au public, l’Italien y balade son appareil à plusieurs reprises. « Mais avoir accès à des lieux stratégiques comme les docks est toujours un peu plus compliqué », relate-t-il. Les premières demandes envoyées vers novembre 2021 n’aboutissent qu’en avril de l’année suivante.
« Entre-temps, il faut montrer patte blanche par mail et téléphone, fournir des documents, expliquer son projet, se justifier… » Lorenzo Meloni obtient finalement une autorisation d’une journée. Sous bonne escorte. « C’est un lieu dangereux, il faut faire attention à tout. Un docker m’a accompagné : il m’a guidé, expliqué les cargos qui entraient et qui sortaient, les conteneurs qu’on bougeait d’un lieu à un autre. Pour certaines photos, il m’a fait monter sur les grues qui servent à décharger les bateaux. » Pour les photos au drone, le photographe revient discrètement un dimanche et se glisse dans une faille : « Elles n’étaient pas expressément interdites. »
Dans le but d’inviter à réfléchir aux « équilibres précaires entre développement industriel et protection de la nature, entre urbanisation, identité territoriale et changement climatique ou transition écologique », Lorenzo Meloni a décidé d’étendre ce travail au reste de l’Europe. Une sorte d’effet papillon.