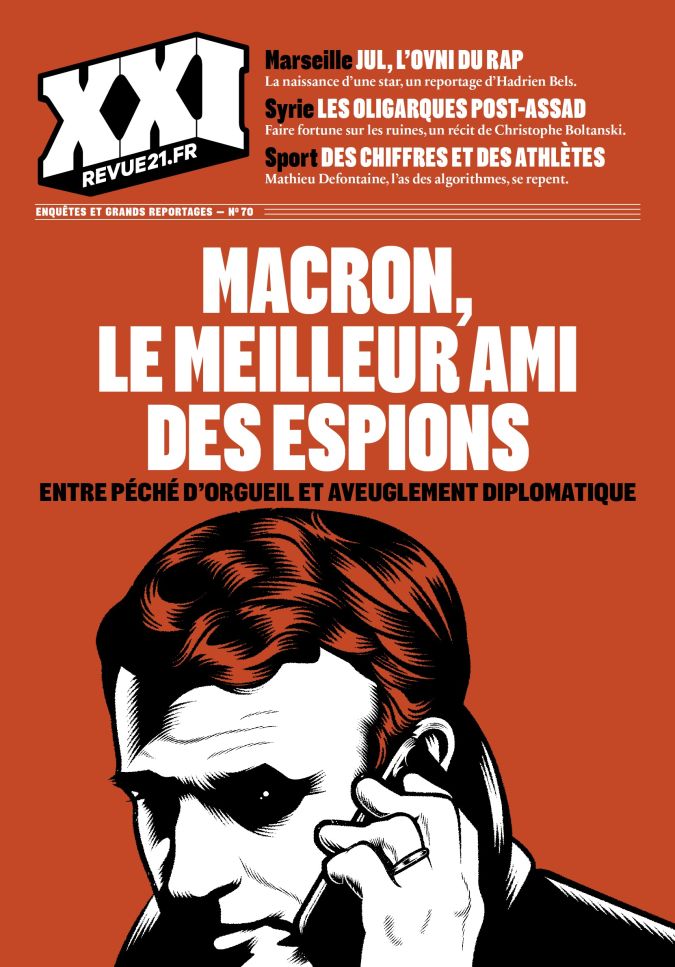Avant d’être un projet, l’utopie est d’abord une projection, un rêve représenté, une échappée hors des sentiers battus. Elle est surtout la traduction littéraire et intellectuelle de ruptures en cours.
Voltaire est l’un des premiers à ramener à terre la figure de l’utopie. Son jeune Candide, exclu du « jardin d’Eden » après « une leçon d’expérimentation physique » avec la fille de son protecteur, un gentilhomme allemand, part à la recherche du « meilleur des mondes ». Son périple l’amène à « l’Eldorado » qu’il délaisse, préférant « cultiver son jardin ».
L’utopie entre dans son âge historique. Les révolutionnaires de 1789 en font le moteur des temps nouveaux. Pour être de ce monde, l’idéal doit être imposé. La vertu s’appuie sur la terreur et Robespierre célèbre le culte de l’Être suprême. Le socialisme scientifique du XXᵉ siècle reprend l’impératif. Et bute sur l’éternelle nature humaine : « Pas d’hommes, pas de problèmes », lance Staline.
Ébranlée, l’utopie s’écrit alors en contre-utopie. Née fille du songe et du paradis, la voici parée de nouveaux atours, sombres et inquiétants. Dans 1984, Orwell imagine le monde parfait et terrifiant de « Big Brother », maître du vrai et du faux, et donc du destin de chacun. Le rêve peut aussi se faire cauchemar.
Elle resurgit dans les années 1960 sous la forme de l’universel « I have a dream » de Martin Luther King. En Occident, les fenêtres du songe se rouvrent : pacifisme, tiers-mondisme, création de communautés... Tout redevient possible. Jusqu’à la chute du Mur de Berlin, qui signe l’échec de la plus longue utopie du XXᵉ siècle.