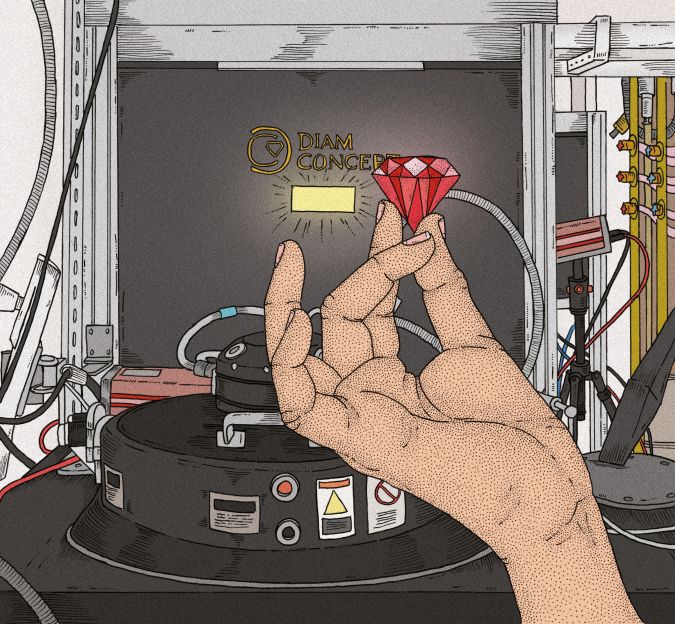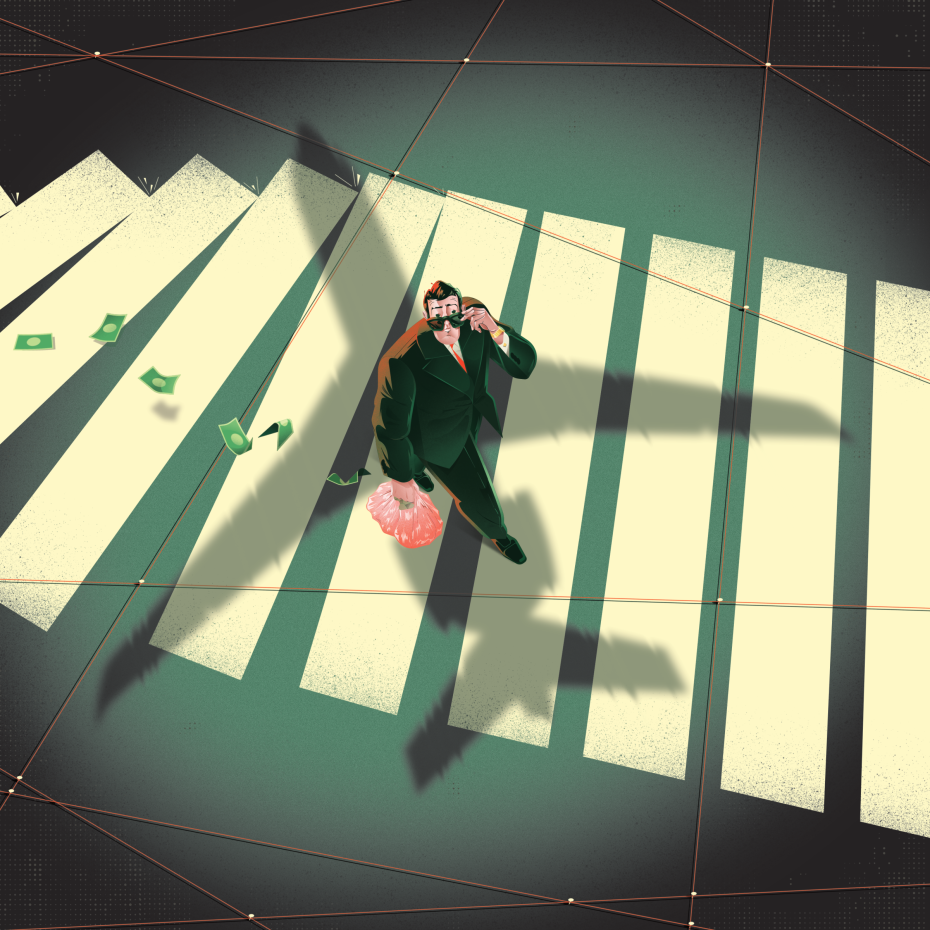De l’église où elle a été baptisée et de sa maison d’enfance, Pierrette Théroux ne possède plus qu’un vieux cliché. « Ça n’existe plus tout ça », dit-elle. Du doigt, elle effleure l’image des deux bâtiments, avalés par la plus grande mine à ciel ouvert du monde occidental.
Nous sommes à Asbestos, une petite ville au cœur du Québec, à une centaine de kilomètres de Montréal. D’ici, des millions de tonnes d’amiante ont été tirées du sous-sol pour être disséminées à travers le monde. L’amiante – asbestos en anglais – a donné son nom à la ville.
La région est verdoyante, légèrement vallonnée. On ne devine la présence d’Asbestos et de son gouffre de deux kilomètres de diamètre qu’au détour d’une route secondaire. L’abysse grisâtre est bordé de singulières montagnes de rejets miniers, où s’accroche une maigre végétation. Un panneau indique que le trou est d’une profondeur suffisante pour y contenir la tour Eiffel.
Les groupes environnementaux et les spécialistes de la santé publique martèlent que l'amiante, toxique sous toutes ses formes, doit être interdit et sa production abandonnée.
C’est en quelque sorte pour éviter que son histoire personnelle, et celle de la ville, ne soient englouties comme les lieux de son enfance que Pierrette Théroux a créé il y a une quinzaine d’années la Société d’histoire d’Asbestos. Petite femme grisonnante de 71 ans, elle a installé sa modeste organisation dans l’aile d’une vieille église reconvertie en bibliothèque municipale. Des photos d’époque ont été collées aux murs des quelques pièces dont elle dispose, confirmant la nouvelle vocation de l’endroit. Pierrette Théroux est la mémoire vivante d’Asbestos. L’ancienne enseignante est aussi l’un des porte-drapeau les plus déterminés de la ville. Depuis des années, de son réduit, elle fait face avec énergie aux assauts des adversaires de l’amiante – d’Asbestos donc.
Les groupes environnementaux et les spécialistes de la santé publique martèlent que le produit, toxique sous toutes ses formes, doit être interdit et sa production abandonnée. Les pressions se multiplient, et l’indignent : le problème, dit-elle brutalement agitée, n’est ni l’amiante, appelé ici « l’or blanc », ni la mine.
Elle se lève, empoigne une feuille fichée bien en vue sur un babillard devant l’entrée et la pose sur la table comme le ferait un avocat en présentant la pièce maîtresse de son réquisitoire. « Regardez, c’était dans le journal il y a quelques jours ! »
Un silence total accueille le visiteur
En gras, on lit l’intitulé – « Attention victimes de l’amiante » – d’une annonce publiée par un cabinet juridique new-yorkais. Les présumés malades sont appelés à se signaler afin de réclamer justice. Plus d’un milliard de dollars d’indemnisation ont déjà été obtenus, insiste le cabinet, qui souligne à l’attention de ses clients potentiels « qu’il est dans leur meilleur intérêt » d’appeler immédiatement un numéro de téléphone gratuit.
« Chaque fois qu’il est question d’amiante, on voit apparaître des annonces comme ça », note Pierrette Théroux. Comme la plupart des habitants d’Asbestos, elle est persuadée que le véritable problème est là : le « lobby anti-amiante » a compris qu’il y avait beaucoup d’argent à faire en lançant des poursuites. « Ils sont très, très puissants », clame l’ex-enseignante.
Elle a beau se battre, les critiques sur l’amiante portent. Et Asbestos est, aujourd’hui, touchée au cœur. Contrairement aux années passées, la mine n’a pratiquement pas repris ses activités cet été. Les convoyeurs et les moulins – où le minerai est concassé pour en tirer la fibre d’amiante – sont figés. Les imposants camions orange, qui normalement vont et viennent en noria le long des flancs de la mine, demeurent immobiles. Un silence total accueille le visiteur.
Le responsable de la guérite de sécurité, presque étonné de devoir consigner un nom inconnu dans le registre, ne met pas longtemps à confier ses inquiétudes : « Si la mine ferme, qu’est-ce qui va suivre ? L’hôpital ? C’est la dernière grande entreprise que nous avons ici. » Un soupir : « Nous allons devenir une ville fantôme. »
J’ai fait le tour de la planète à la recherche d’un investisseur. J’en ai trouvé un en Chine, mais il s’est désisté par crainte des poursuites liées à l’amiante…
Bertrand Coulombe
Personne n’est plus conscient de ce risque que le président de la mine, Bernard Coulombe. Son grand bureau offre une vue directe sur le gouffre à ciel ouvert. Des échantillons de produits à base d’amiante sont répartis un peu partout.
Ancien cadre, ingénieur minier devenu le principal actionnaire de l’entreprise, Bernard Coulombe a consacré sa vie à la mine et à l’amiante. « La pression des habitants de la ville sur mes épaules est très forte », dit cet homme mince au regard sévère qui, depuis des années, tente de lancer l’exploitation d’un important filon souterrain.
Le projet permettrait de faire tourner la mine pour plusieurs années et garantirait le maintien de quatre cents emplois à temps plein. Mais il y a un hic : les fonds se font rares et il peine à convaincre : « J’ai fait le tour de la planète à la recherche d’un investisseur. J’en ai trouvé un en Chine, mais il s’est désisté par crainte des poursuites liées à l’amiante… » Son téléphone ne cesse de sonner, des appels « urgents », s’excuse l’administrateur, qui y répond à coups de directives tranchées. Ses espoirs résident actuellement dans le gouvernement québécois. Il négocie une garantie de crédit de soixante millions de dollars, n’est pas certain d’aboutir : « Si ça ne marche pas avec le gouvernement, je reprendrai mon bâton de pèlerin. »

« Le soleil aussi est cancérigène »
Les pressions exercées par les détracteurs de l’amiante ne lui facilitent pas la tâche, mais le président de la mine s’affiche déterminé. Il est « ridicule », dit-il avec une pointe d’exaspération, de vouloir interdire l’amiante sous prétexte que le produit est cancérigène. « Le soleil aussi est cancérigène. Va-t-on interdire le soleil pour autant ? Tout est question de dosage et de temps d’exposition. »
Comme Pierrette Théroux, l’ancien ingénieur a une dent contre les firmes d’avocats représentant les victimes de l’amiante : « Je les appelle “les machines à compensation”. » Il n’est pas non plus partisan du principe de précaution. « S’il fallait toujours appliquer le principe de précaution, on serait encore dans les cavernes en train de traîner les femmes par les cheveux… Il faut faire et laisser braire. »
Que d’anciens employés de la mine continuent de tomber malades et de mourir des suites de leur exposition à l’amiante ne l’affecte pas outre mesure. La compagnie verse des indemnisations pour soutenir les familles touchées et continuera de le faire : « C’est le prix de péchés anciens qui sont payables aujourd’hui. »
Dans l’attente d’une hypothétique relance assurée par une nouvelle phase de développement de la mine, Asbestos s’étiole. Depuis des années, la ville vit sur son passé et n’est, aujourd’hui, que l’ombre de ce qu’elle a été, affirme Pierrette Théroux : « C’est mort. On essaie de faire revivre Asbestos, d’attirer des jeunes, mais ce sont surtout les retraités qui viennent. Beaucoup de familles sont parties lors des mises à pied massives au début des années 1980. »
Le déclin démographique des dernières décennies a vu la population de la ville chuter de près de moitié pour s’établir à sept mille habitants.
Les écoles abandonnées témoignent du mouvement. Dans le quadrillage de rues résidentielles qui forment la majeure partie de la ville, dessinée en carrés à l’américaine, on repère facilement plusieurs établissements dont les fenêtres ont été bouchées avec du contreplaqué. L’herbe pousse dans les craquelures de l’asphalte. Un panneau placé devant l’une des anciennes écoles indique qu’elle sera bientôt convertie en résidence pour personnes âgées.
Le déclin démographique des dernières décennies a vu la population de la ville chuter de près de moitié pour s’établir à sept mille habitants. Le contraste avec la folle expansion du début du siècle est évident. Pierrette Théroux, la présidente de la Société d’histoire d’Asbestos, aime à remonter dans le temps en s’appuyant sur les photos installées dans ses locaux. Sur l’une des plus anciennes, des hommes posent, massues et pioches à la main, sans sourire, au bord d’une excavation rocheuse qui ne laisse rien présager du gouffre à venir. Leur équipement témoigne du caractère rudimentaire de l’exploitation, entamée à la fin du XIXe siècle, au cœur d’une région jusque-là essentiellement agricole.
Depuis plusieurs années, les habitants sont surpris par l’étrange nature des rochers qui, situés sur la terre d’un agriculteur, laissent émerger des fibres soyeuses. Il faudra l’œil averti d’un mineur originaire du pays de Galles pour identifier le minerai et son potentiel commercial.
Un gentleman farmer établi dans la région accepte d’avancer les sommes requises pour l’exploitation, lancée à l’été 1879. La ville d’Asbestos voit le jour vingt ans plus tard quand son nom apparaît pour la première fois sur le bureau de poste construit à proximité de la mine.
Une ville « sous influence »
À la fin du siècle, le village compte un peu plus de mille âmes, pour la plupart des francophones catholiques. Un premier prêtre résident s’installe. Afin de « propager et maintenir l’esprit chrétien dans la famille », il crée la Ligue du Sacré-Cœur. Ses membres doivent communier au moins quatre fois par an, ne jamais manquer « par leur faute » la messe du dimanche, ne pas blasphémer et, surtout, « ne pas aller boire dans les débits de boisson ». Par la suite, l’emprise de l’Église catholique ne cesse de se renforcer, insiste Pierrette Théroux. Asbestos devient une ville « sous influence » des religieux et des propriétaires de cette mine, qui ne cesse de gagner en importance.
L’héritage est encore palpable aujourd’hui : une croix est placée à une entrée de la ville, un camion de deux cents tonnes à une autre. Le contrôle de l’exploitation finit par passer aux mains d’intérêts américains. Les profits augmentent à mesure qu’explose la demande mondiale pour l’amiante. La fibre aux vertus ignifuges sera utilisée dans une foule d’applications : patins de freins, ciments, fours électriques…
Les salaires des ouvriers ne suivent pas, les conditions de sécurité sont insuffisantes, la haute direction est anglophone. La table est mise pour qu’éclate un conflit social. Le 13 février 1949, deux mille mineurs se mettent en grève. Ils réclament une augmentation de salaire et l’élimination de la poussière générée par l’exploitation du minerai. La grève est déclarée illégale. Le Premier ministre de l’époque, Maurice Duplessis, dépêche sur place la police provinciale pour soutenir la direction de la mine, qui fait appel à des briseurs de grève. Le conseil municipal d’Asbestos dénonce la venue des renforts. Les policiers, est-il noté dans une résolution, sont « sous l’influence de liqueurs alcooliques » et certains « se sont même rendus coupables d’actes indécents » dans les rues de la ville. L’archevêque de Montréal, Mgr Joseph Charbonneau, voit dans le conflit une « conspiration pour écraser la classe ouvrière » et apporte son soutien aux grévistes.
« Les jeunes ne savent plus ce qu’est un chapelet »
Ponctuée de nombreux affrontements violents, la grève s’éteint après de longs mois. Aujourd’hui, la bataille d’Asbestos reste un moment important de l’histoire du Québec : elle marque un pas dans la Révolution tranquille qui, à la fin des années 1960, fera de la province un Etat laïc et moderne.
Mais loin d’en tirer fierté, la ville rumine toujours ses divisions de l’époque. Les anciens grévistes n’ont jamais pardonné aux briseurs de grève, les « scabs ». Leurs enfants ont hérité de cet ostracisme. En 1999, date du cinquantième anniversaire du conflit, un ancien gréviste reprochait vertement à son fils d’être allé prendre un verre avec « des fils de scabs ».
Pierrette Théroux, la présidente de la Société d’histoire, se souvient comme hier du conflit. De mémoire, s’amuse-t-elle, elle entame une ritournelle chantée alors par les enfants. Les policiers y sont décrits comme de « grosses poires ». « On ne savait pas trop ce qu’on disait dans la chanson mais on savait qu’on parlait de la police. C’était de vrais bums. » Autrement dit, des vauriens. « Notre professeur nous répétait à l’école qu’il ne fallait pas parler de la grève, qu’elle ne voulait pas avoir de chicane. Nous devions rentrer chez nous après la classe en marchant deux par deux, sans parler à personne. »
Les gars ont tenté d’oublier le conflit, mais c’est comme s’ils étaient allés à la guerre.
Rodrigue Chartier, président du Syndicat national de l’amiante
Conseiller municipal et employé de la mine, Serge Boilard se souvient avoir été pris à partie voici une dizaine d’années alors qu’il interprétait le rôle d’un policier dans une pièce de théâtre sur le conflit : « Un ancien gréviste m’a traité de gros dégueulasse, de maudit baveux [de provocateur] comme si j’étais un vrai policier. Il avait eu les deux jambes cassées pendant la grève. »
« Les gars ont tenté d’oublier le conflit, mais c’est comme s’ils étaient allés à la guerre », explique dans des bureaux quasi déserts, à la périphérie d’Asbestos, le président du Syndicat national de l’amiante, Rodrigue Chartier.
À Québec, le Théâtre du Trident a rejoué au printemps dernier une pièce inspirée de l’affrontement entre l’Eglise et le Premier ministre de l’époque. Pour Gill Champagne, le directeur artistique de la troupe, le livret, vieux de quarante ans, est plus que jamais d’actualité : « C’est une page importante. »
Dans les années 1970, des spectateurs faisaient une génuflexion avant de quitter la salle : « L’entracte était à la fin du sermon de l’archevêque », explique Gill Champagne. Aujourd’hui, autre époque, certains artistes sont perplexes face aux références religieuses : « Les plus jeunes ne savaient pas ce qu’était un chapelet, un scapulaire, un vicaire… Ces termes ne sont plus familiers. »

L’âge d’or
À la fin du conflit, Asbestos entre dans une période de prospérité exceptionnelle. La mine tourne à plein régime, la ville fait l’envie de la région et au-delà. « C’était un âge d’or à tous points de vue », note Pierrette Théroux. Le destin des jeunes est tracé : « Les gars finissaient leur secondaire, faisaient une petite formation technique et entraient ensuite à la compagnie pour la vie. C’était réglé. » La compagnie minière est partout. Elle emploie, elle finance les infrastructures, elle soutient les loisirs. Rien – jusqu’au golf – ne se réalise sans son appui. Pierrette Théroux : « C’était une véritable culture de dépendance. Quand quelqu’un voulait lancer quelque chose, il allait demander de l’argent à la mine. C’était comme ça pour tout, tout. La compagnie mettait des dollars partout. » La ville est la mine, la mine est la ville.
La présidente de la Société d’histoire se souvient avoir pris conscience de la richesse des mineurs alors qu’elle faisait du porte-à-porte, au début des années 1970, pour un parti politique. « Je suis revenue à la maison et j’ai dit à mon mari : “Sais-tu qu’on est pauvre ?” Les gens étaient bien plus équipés que nous. C’était l’american dream au maximum. »
Son conjoint, également enseignant, se faisait narguer à l’école par des élèves qui trouvaient sa voiture trop modeste. Certaines familles changeaient de modèle deux, voire trois fois par an. « Quand j’allais chez la coiffeuse, j’entendais les femmes se plaindre parce qu’elles n’avaient pas encore le dernier modèle de laveuse ou de sécheuse. C’était vraiment l’abondance. »
Les gens travaillaient pour avoir la voiture de l’année, la motoneige de l’année… Il fallait aussi avoir un chalet sur un lac. Ça, c’était très important.
Francesco Spertini, géologue
Il y avait une fièvre consumériste, confirme Francesco Spertini, un géologue d’origine italienne venu s’établir à Asbestos à la fin des années 1960. Engagé par la compagnie minière, il n’est pas reparti. « Les gens travaillaient pour avoir la voiture de l’année, le skidoo [la motoneige] de l’année… Il fallait aussi avoir un chalet sur un lac. Ça, c’était très important. » Lui assure n’avoir « jamais vraiment embarqué là-dedans » : « Ayant été pauvre, si j’avais de l’argent, je répugnais à le dépenser. Pour tout dire, j’ai eu quatre voitures en quarante ans. L’actuelle a 10 ans et fonctionne encore très bien. » Pour un immigrant qui avait connu la misère de l’Italie, la vie était facile, dit-il. Travailler à la mine ouvrait toutes les portes. Amusé, il se souvient du jour où il loua un avion sans pratiquement présenter aucun papier : « J’étais employé de la mine, cela suffisait. »
De ses missions d’exploration, Francesco Spertini a gardé de nombreux échantillons de minerai. Ils sont abrités dans un petit musée aménagé dans l’ancienne église, à côté de la Société d’histoire de Pierrette Théroux et de la bibliothèque municipale. L’état de la porte, qui aurait besoin d’un coup de peinture, montre que l’endroit n’est pas des plus fréquentés.
En traversant les salles débordant de minerais colorés, on tombe sur une rangée de photos. Des couples bien mis regardent de face l’appareil. Ils sont sereins, de bonne humeur. La vie est belle. La croissance est forte, rapide. Le développement urbain d’Asbestos est régulièrement chamboulé. La ville est un chantier perpétuel.
De la poussière partout
Au bord du gouffre, une photo panoramique est placée en évidence pour les visiteurs. En son centre, le trou de la mine à ses débuts. Autour, des cercles concentriques. Chaque nouveau cercle marque une vague d’expropriations. « À mon arrivée à Asbestos, j’habitais là. C’est incroyable comme la mine a grandi », s’étonne encore un habitant. L’homme pointe du doigt un endroit imaginaire suspendu au-dessus du gouffre à plusieurs centaines de mètres de lui.
Les expropriations, largement indemnisées, se faisaient sans trop de heurts. « La mine offrait plus ou moins deux fois le prix de l’évaluation officielle de la maison. Les gens disaient oui et c’était ça », explique le conseiller municipal Serge Boilard. Un ancien employé, Charles Giguère, se souvient que certains cherchaient même à se loger à côté de la mine pour revendre rapidement et faire un « coup d’argent ». Des maisons sont parfois emportées par l’affaissement des parois. Rodrigue Chartier, le président du Syndicat national de l’amiante, est réveillé en pleine nuit et sommé de quitter d’urgence son domicile sur le point d’être aspiré. Paniqué, à moitié déshabillé, il ne trouve pas sa fille, la cherche partout. « Les gars sont revenus et m’ont demandé ce que je faisais encore dans la maison. C’est là que j’ai appris qu’ils l’avaient embarquée. »
À partir de 1930, des études sur la toxicité de l’amiante sont réalisées. La population commence à comprendre les dangers d’une exposition prolongée à la fibre.
Tenu par la compagnie minière, le conseil municipal n’a pratiquement aucun droit de regard. Il faut attendre le milieu des années 1970 pour qu’une zone tampon soit établie autour du gouffre. C’est à la même époque que sont mises en place les premières mesures strictes de contrôle des émissions de poussière. À partir de 1930, de nombreuses études sur la toxicité de l’amiante sont réalisées. La population commence à comprendre les dangers d’une exposition prolongée à la fibre.
« Dans les années 1950-60, il y avait de la poussière partout. Quand je me promenais en moto dans les rues de la ville, ça faisait comme quand on passe dans de la neige, ça tourbillonnait autour des roues… », raconte Charles Giguère, l’ancien de la mine : « La ferme de mes parents était à un peu plus de deux kilomètres du trou. L’été, quand on fauchait le foin, la poussière d’amiante s’élevait et les vaches mangeaient ça. »
L’entreprise minière modernise graduellement ses infrastructures. Un moulin de concassage sous vide est aménagé. Pour le président du syndicat, les conditions de travail deviennent véritablement sécurisées au milieu des années 1970 : « Avant, les gens travaillaient dans des conditions exécrables. Ceux qui ont commencé après 1975 ne risquaient plus de développer des maladies professionnelles. »
L’exode massif
Rodrigue Chartier a défendu des dizaines d’anciens mineurs tombés malades en fin de carrière. Son père a souffert de troubles respiratoires à la fin de sa vie. Comme la plupart des résidents d’Asbestos qui ont perdu un proche ayant travaillé à la mine, il ne s’étend pas trop sur le sujet.
Propriétaire du site, la Johns-Mansville Corporation voit la rentabilité phénoménale de ses activités d’extraction compromise à mesure que l’opposition au produit va croissant. Accusée de négligence, confrontée à un nombre sans cesse plus important de poursuites, elle vacille quand son principal assureur, inquiet de l’explosion des demandes d’indemnisation, lui retire son appui.
Une restructuration s’impose. Des investisseurs québécois, dont Bernard Coulombe, reprennent le contrôle de l’exploitation au début des années 1980. La récession est là. Des centaines d’ouvriers sont mis à pied, la production est divisée par trois, passant de six cent mille tonnes par an à deux cent mille. La déprime s’installe.
L’hôtel de ville – un imposant cube gris – devient le symbole du déclin. Il doit être bientôt rasé, faute de moyens pour assurer sa réfection.
Habituée aux années d’abondance, la population a du mal à s’adapter. « Beaucoup pensaient que ce serait temporaire, mais ça ne l’a jamais été. La crise s’est transformée en tragédie. Il y a eu des divorces, des suicides, des faillites personnelles. C’était le côté triste de la médaille », se rappelle Francesco Spertini, le géologue italien. Les jeunes tentent leur chance ailleurs, l’exode est massif, Asbestos vieillit. L’âge moyen des habitants est aujourd’hui parmi les plus élevés de la province.
La transformation se lit dans la géographie des lieux. Après les écoles, des commerces ferment. Les rues, parsemées de façades closes, prennent triste allure. L’hôtel de ville – un imposant cube gris – devient le symbole du déclin. Erigé sur une vaste dalle de béton fissurée, il doit être bientôt rasé, faute de moyens pour assurer sa réfection. L’administration sera relogée dans l’ancienne église, là même où est installée la présidente de la Société d’histoire.
« Quand le bâtiment a été construit, c’était un concept architectural novateur, mais ça coûte les yeux de la tête à entretenir et on n’a plus les moyens de payer, explique un conseiller municipal. Uniquement pour le toit, il faudrait investir 500 000 dollars sans qu’on puisse être certain qu’il ne recommencera pas à couler dans cinq ans. »
« Je ne vous dis pas que tout est rose »
Les élus espéraient pourtant avoir trouvé une voie d’avenir. Dans un livre publié par la municipalité en 1999 à l’occasion du centenaire d’Asbestos, il est noté avec soulagement que « le vent a enfin tourné » avec le projet Magnola, visant à extraire le magnésium des montagnes de rejets de la mine. Soutenu par le gouvernement du Québec, un consortium venait d’accepter d’investir plus d’un milliard de dollars dans la construction d’une usine. A la clé, des centaines d’emplois et, surtout, la relève après l’amiante.
Restait une interrogation mentionnée dans l’ouvrage historique : « On risque de substituer une mono-industrie à une autre mono-industrie […] Saura-t-on éviter l’écueil d’une confiance exagérée en une industrie qui n’est pas à l’abri des caprices des marchés mondiaux ? » La question était bonne. Victime des fluctuations des cours mondiaux du magnésium, l’usine n’a fonctionné que quelques années. Ses installations vont bientôt être démantelées et son dernier lingot repose dans le musée de minéralogie de Francesco Spertini. Le géologue ne cache pas son amertume : « Les responsables du projet n’ont pas pensé plus loin que le bout de leur nez. »
Le directeur général d’Asbestos, Georges-André Gagné, reçoit dans un bureau à moitié vide, aux finitions surannées. La fermeture de Magnola a été difficile à digérer, convient-il : « Comme tout le monde, on espère pouvoir prendre l’autoroute du développement économique et, quand une grosse usine s’installe, ça va plus vite. »
Plus récemment, la ville a jonglé avec le possible accueil d’une usine de traitement de déchets, installée au cœur des montagnes de résidus miniers. Mais le projet est bloqué, les agglomérations voisinent n’appréciant pas l’idée de voir affluer des tonnes de détritus.
« On s’en sort, on s’en sort. Je ne vous dis pas que tout est rose, mais on réussit à revamper et à construire », assure Georges-André Gagné, qui dit vouloir briser l’image négative d’Asbestos : « Je suis quelqu’un qui a tendance à voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide. »
« On dirait que nous sommes des extraterrestres »
Cette volonté de positiver est manifeste chez les habitants d’Asbestos qui, tous, insistent sur la nature de l’amiante produit par la mine. De type dit « chrysotile », cet amiante est moins dangereux pour la santé que les fibres de type amphibole, assurent-ils.
Au centre commercial d’Asbestos, un homme explique, sûr de lui, qu’ « interdire le chrysotile, c’est comme dire qu’on va interdire les champignons parce qu’il en existe des vénéneux ». Il insiste, lourdement : « De toute manière, ce n’est pas parce qu’un produit est dangereux qu’il faut l’interdire. Va-t-on dire aux Français d’arrêter de boire du vin sous prétexte que le vin est mauvais pour la santé ? Bien sûr que non ! »
« On dirait que nous sommes des extraterrestres », s’énerve un employé occasionnel de la mine. Les journalistes sont vus avec suspicion.
Pour Charles Giguère, l’ancien mineur, la question ne se pose même pas. Il ne croit simplement pas à la dangerosité de l’amiante : « Après mes quarante ans à la mine, je suis en pleine forme et prêt à mettre mon corps à la disposition des scientifiques. » Le nombre important de cancers relevés chez les anciens mineurs est, selon lui, d’abord et avant tout dû à la cigarette, pas à l’amiante : « Tout le monde fumait. Les gens finissaient une cigarette et allumaient la suivante avec leur mégot, ça n’arrêtait pas. »
Le régime de retraite des mineurs s’est effondré il y a quelques années et Charles Giguère reçoit, comme tous les anciens, une pension de misère. Ayant réalisé quelques heureux investissements, il ne s’en préoccupe pas trop. Tous n’ont pas eu sa chance. « Le pot aux roses, c’était les années passées, pas maintenant », dit le président du syndicat. « Ça ne va pas bien du tout : il y a actuellement quatre cent cinquante gars sur la liste des anciens alors qu’on a déjà été deux mille quatre-vingts dans le syndicat. »
Les habitants, souvent montrés du doigt en raison de leur attachement à l’amiante, le supportent mal. « On dirait que nous sommes des extraterrestres », s’énerve un employé occasionnel de la mine. Les journalistes sont vus avec suspicion.
« Voilà, vous êtes condamné, vous avez touché de l’amiante »
Bernard Coulombe, le principal actionnaire de la mine, peste encore contre un reporter qui avait filmé un membre de sa famille souffrant d’un handicap comme s’il symbolisait les risques liés à l’amiante. Lors de notre premier échange téléphonique, il avait prévenu, mi-blagueur, mi-sérieux : « Si vous n’êtes pas honnête, on vous pendra au moulin. »
Les habitants citent souvent des anecdotes sur les visiteurs terrorisés par l’idée de se trouver dans une zone de production d’amiante. Pierrette Théroux, l’historienne, se souvient d’une femme « qui ne voulait pas visiter le moulin de concassage et refusait de sortir de l’autobus ». D’autres, dit-elle, croient que l’amiantose s’attrape par un simple contact et « refusent de toucher la fibre ».
Francesco Spertini, le géologue, aime bien déposer dans les mains de ses interlocuteurs des échantillons du redouté minerai. De son accent chantant, un grand sourire aux lèvres, il lance alors : « Voilà, c’est fait, vous êtes condamné, vous avez touché de l’amiante. »
Bien qu’ils jurent n’avoir rien à faire des critiques, les élus d’Asbestos ont songé un temps à changer le nom de la ville. Pierrette Théroux s’est offusquée : « Il ne faut pas avoir honte de l’histoire de l’amiante. Asbestos, ça veut dire “amiante”, c’est ce qui a donné naissance à la ville… Même si on a un morceau de notre identité que l’on n’aime pas complètement, on ne l’enlève pas, ça nous appartient. »