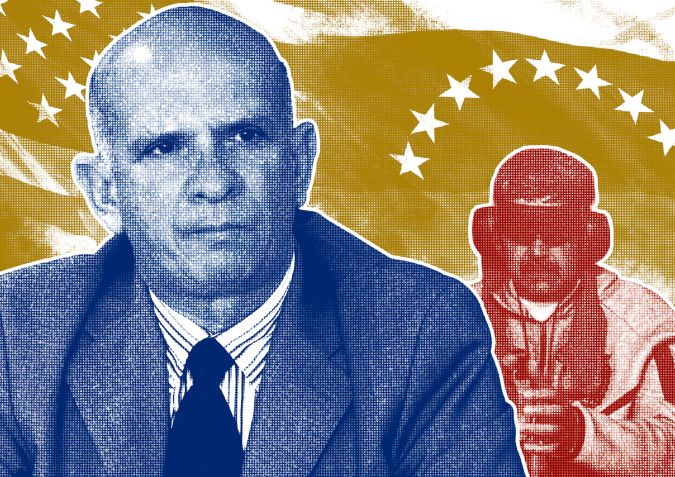La révolution de mes 20 ans
Je me souviens encore de ma première rencontre avec Albert, de l’immédiate impression de fraternité. Nous étions attablés le long d’une rue poussiéreuse de Xpujil, principale ville de la région de Calakmul, au Yucatan, aux portes de la plus grande forêt tropicale d’Amérique du Nord. Un camarade du Conseil régional indigène et populaire était investi aux élections régionales sous les couleurs d’une vaste coalition. Celle-ci visait ni plus ni moins que l’accession à la présidence de la République du grand espoir de la gauche mexicaine, Andrés Manuel López Obrador.
C’était il y a vingt ans, au printemps 2004. Et j’étais là, au milieu de paysans, d’universitaires, de militants, de monteurs de projets opportunistes, à savoir qui mangerait le plus de piments. La présence d’un étudiant français n’avait rien d’extraordinaire. À l’époque, le Sud-Est du Mexique était la destination privilégiée d’une myriade de jeunes Occidentaux venus voir à quoi ressemblait un peuple qui prenait son destin en main. Là-bas, au Mexique, des femmes et des hommes ne se contentaient pas de parler de révolution. Ils la faisaient.
De la petite stature d’Albert Chan Dzul se dégageait une détermination qui tranchait avec sa timidité apparente. Il avait exactement l’air de ce qu’il était : un biologiste de terrain passionné, avec son bermuda kaki, ses chaussures de montagne, son polo floqué d’un centre d’études agronomiques. C’est avec lui que j’allais travailler les six mois suivants, pour mon stage de fin d’études de master de géographie. Ce jeune Maya yucatèque, fraîchement diplômé, venait d’être embauché par une ONG mexicaine pour travailler à renforcer l’autonomie alimentaire des communautés locales, une trentaine de villages installés en grappe le long d’une piste de 75 kilomètres s’enfonçant dans la végétation et l’extrême isolement. Il s’agissait notamment pour nous de tracer un sentier touristique d’interprétation à travers les vestiges archéologiques, la faune et la flore de la zone la plus préservée.
Un goût pour la bière, le foot et les débats
Je quittais la vie étudiante de ma petite région tempérée béarnaise, et partais à la découverte de ma personnalité d’adulte sous les bouillonnants tropiques. J’aspirais au voyage, à l’altérité. Libre de tout héritage. En tout cas, c’était ce que je croyais. Albert aussi. Nous avions le même âge et cette même ascendance paysanne que les études devaient nous faire abandonner. Un goût partagé pour la bière, le football et les débats à mi-chemin entre l’éthique et la philosophie de comptoir nous a rapidement rapprochés. Le plus souvent possible, je profitais de son enthousiasme lors de nos sorties dans la jungle. Sa passion pour les orchidées ne m’excitait guère, mais ses explications, sur les fruits domestiqués au temps des Mayas anciens et qui pourraient redevenir aliments aujourd’hui, donnaient à voir la profondeur des liens avec cette nature d’apparence sauvage. Moi le gringo et lui le Yucateco tentions le jour de détourner le projet touristique pour lequel nous avions été embauchés – en essayant de construire des réserves d’eau ou mettre en place des formations –, et débattions la nuit de rêves plus grands que nous. Albert deviendra mon ami.
Le village où nous travaillions se trouvait aux portes du Chiapas. Cet État mexicain, le plus éloigné de la capitale, à l’extrême sud du pays, enclavé entre le Pacifique et le Guatemala, était surtout le plus pauvre et le plus indigène. Là, en 1992, l’Ejército Zapatista de Liberación Nacional – l’Armée zapatiste de libération nationale, l’EZLN, créée en 1983 – et la population avaient voté la guerre contre l’État et l’armée, préférant « la mort digne à la mort indigne ».
Les habitants se préparaient à cette éventualité. Début 1994, ils avaient estimé que les événements l’imposaient : le très libéral président Carlos Salinas de Gortari venait de modifier la constitution héritée de la révolution de 1910 menée par Emiliano Zapata. Les parcelles collectives communales et d’usage familial – les ejidos – allaient pouvoir être privatisées, donc vendues. Il s’agissait de préparer l’Accord de libre-échange nord-américain (Alena) entre le Mexique, le Canada et les États-Unis, qui ouvrait les terres aux investisseurs étrangers. Carrillo Puerto, compagnon de route yucatèque de Zapata, avait pourtant prévenu la veille de sa mort en 1924 : « Quand le conquistador vole sa terre à l’Indien, il lui vole sa liberté. Dans un pays agricole, terre et liberté sont synonymes. »
Des militants mexicains venaient nous voir, et prêchaient une utopie du possible : changer le monde sans prendre le pouvoir.
Le 1er janvier 1994, alors que l’Alena entrait en vigueur, les principales villes du Chiapas étaient investies par des centaines de femmes et d’hommes en habits militaires ou traditionnels, visages masqués de foulards et de passe-montagnes. Ce n’était pas une simple escarmouche – les premiers jours de conflit ont fait 145 morts selon les autorités. Pas une guérilla non plus – malgré d’atroces massacres perpétrés par les paramilitaires –, comme celles qu’avait connues l’Amérique centrale dans les années 1980 et qui s’étaient enlisées.
C’était la révolution zapatiste, une dizaine de jours d’affrontements avec l’armée mexicaine, suivie d’un cessez-le-feu, puis d’une guerre de basse intensité entretenue par le gouvernement. Dans le monde, ce soulèvement unique a donné un souffle nouveau au mouvement altermondialiste naissant pour devenir une référence majeure lors des contre-sommets des G8 à Seattle en 1999, Gênes en 2001, puis dans les cycles des forums sociaux, de Porto Alegre à Mumbai. Une icône à la pipe fumante était née, « le sous-commandant Marcos », auprès duquel allaient venir se faire photographier Noam Chomsky, Alain Touraine, Danielle Mitterrand ou encore Manu Chao. Les zapatistes réclamaient justice, respect, dignité pour les peuples indigènes, mais aussi la démocratisation du Mexique et la lutte pour une autre mondialisation.
Albert avait découvert ces événements à la télé, comme des millions de Mexicains. Depuis son paisible village, il avait vite pris fait et cause pour ces paysans qui ressemblaient à ses pairs et qui se revendiquaient fièrement indigènes. Pour moi, ça avait été autre chose. Je suivais la situation lors des réunions du comité Chiapas de Pau. Il en fleurissait alors dans toutes les villes. Des gens de chez nous partaient là-bas. Des militants mexicains venaient nous voir, et prêchaient une utopie du possible : changer le monde sans prendre le pouvoir. Le zapatisme enseignait une éthique qui mettait à bas les travers de nos cercles militants – l’intention, plus que l’action –, tout en proposant une alternative pratique.
Trois semaines loin de mes bêtes
Mon séjour au Mexique a renforcé en moi un certain romantisme révolutionnaire duquel je ne me suis jamais départi. Surtout, il a fait prendre un virage à ma vie. Ces six mois loin de la France ont contribué, des années plus tard, à mon retour à la terre, certes tardif, mais longuement mûri : j’ai repris le troupeau de ma mère, sur la ferme de son père, dans le village d’Aramits, dans les Pyrénées-Atlantiques, lors de son départ à la retraite il y a six ans. Quinze vaches, dans le Mexique d’Albert, c’est un ranch. Un rêve. Ici, c’est peu, ou pas assez pour gagner un revenu d’Occidental. Pour vivre de mes montagnes, je suis aussi bûcheron.

Durant les vingt années qui ont suivi ce voyage, nous n’avons que très peu échangé avec mon ami maya. Exclusivement par e-mail. L’un comme l’autre devions penser que les dialogues virtuels ne valent pas grand-chose. L’un comme l’autre devions avoir la certitude que notre amitié n’avait pas besoin de discussions plates et de remises à niveau. C’est ce que je me plaisais à croire. Jusqu’à ce qu’au printemps 2023, tout s’accélère. La révolution qui m’a attiré au Mexique aura 30 ans le 1er janvier 2024. Les zapatistes administrent toujours de manière autonome un territoire grand comme la Bretagne, renforçant leurs systèmes alternatifs et novateurs en matière de santé, d’éducation et de justice. Nos 20 ans à nous vont avoir 20 ans.
La revue XXI m’a proposé d’y retourner. De retrouver Albert, pour aller voir de plus près ce que sont devenues nos idées à l’épreuve de la réalité. J’ai hésité. Mon ami devait être d’accord et me donner sa bénédiction. C’était ma condition. Albert a tardé à répondre à mon e-mail, qui disait : « On m’a proposé un article sur l’influence qu’a pu avoir le zapatisme sur nos trajectoires. S’il est accepté, je vais devoir venir te voir dans le mois. Tu serais d’accord ? » Son message, après plusieurs années sans nouvelles, s’est fait encore plus concis : « andale, bankil » – « ça marche, mon frère » –, auquel il a joint son numéro de portable. J’ai pris mon billet d’avion. Trois semaines loin de mes bêtes. Une éternité tourmentée pour un paysan. C’était plus facile il y a vingt ans, quand je livrais des pizzas à mobylette dans les rues de Pau entre deux cours de géo.
Terre et liberté, un combat ordinaire

Me voilà posé pour douze heures de vol, le travail en forêt assuré par deux jeunes que j’ai formés, les vaches confiées à ma mère. Makhnovchtchina a vêlé cette semaine, tout devrait bien se passer. N’empêche, je ne suis pas tranquille. Serai-je à la hauteur de ma première mission de journaliste ? Pour évacuer les vagues d’angoisse, je me remémore les chemins louvoyants dans la jungle jusqu’aux parcelles cultivées, les après-midis de discussions à l’ombre des manguiers et les volées d’enfants passant de maison en maison. La Mancolona, la communauté dans laquelle nous construisions notre sentier d’interprétation, était composée d’une quarantaine de familles du Chiapas voisin, regroupées dans un village en grande partie autoconstruit, avec des murs en planches et des toits de palme.
Malgré l’abandon total de l’État qui avait déplacé ces populations suite à la création de réserves de biosphère, les nouveaux venus avaient réussi à recréer un espace de vie au cœur de la végétation. Chacun avait droit d’usage sur une parcelle de cinquante hectares. L’agriculture traditionnelle pourvoyait aux besoins primaires de tous, et les chasseurs puisaient dans la forêt tout en veillant à son équilibre. Il n’y avait pas d’électricité, l’eau potable manquait, l’accès aux soins était très difficile, mais la communauté tenait bon. Les décisions étaient prises avec l’assentiment de tous sous l’aljibe, un grand préau muni d’une réserve servant à récupérer l’eau de pluie. Chacun, parfois au prix d’interminables palabres, savait se ranger ou plutôt s’additionner au collectif. Antonio, moteur discret mais infatigable du dynamisme communautaire, m’avait dit un jour : « si la communauté est heureuse, alors je peux être heureux ».
Au lieu de revenir tous les soirs au bureau de l’ONG, nous nous arrangions, Albert et moi, pour rester le plus souvent possible dormir chez ce père de famille intarissable, à débattre sous son avocatier des subtiles différences entre les langues mayas tzeltal et yucatèque, ou à deviner, en voyant des enfants passer, de quelle famille ils venaient. Antonio avait connu les prêtres rouges, qui avaient sillonné le Chiapas au tournant des années 1970 et 1980, préparant le terrain au futur soulèvement. Puisait-il là son engagement ? En tout cas, la vie à la Mancolona nous faisait sentir l’intelligence collective que proposait le zapatisme. Une forme d’organisation libertaire concrète, dans la simplicité et la patience du quotidien. Cela faisait écho en moi à une construction idéologique faite d’intuitions et de lectures. Pour Albert aussi. À une nuance près, de taille : sa culture maya le rattachait de manière plus profonde à cette histoire.
Le bar rock passait de la bachata
Albert m’a donné rendez-vous au terminal de l’ADO – la gare routière – de Mérida, la capitale d’État du Yucatan. Le timing est serré, Sara et Yamili m’attendent à la descente de mon bus. La dernière fois que je les ai vues, la compagne et la sœur d’Albert avaient 15 et 17 ans et ne se connaissaient pas. Aujourd’hui, ce sont deux femmes décidées et complices qui prennent en main notre commande dans un bruyant petit restaurant ouvert sur la rue. Nous voilà bien étonnés devant le plat de tacos, ne comprenant pas très bien le sens de nos retrouvailles, mais revenant vite et avec plaisir sur ces mois du printemps 2004 où nos vies se sont croisées. Trois quarts d’heure plus tard, elles me donnent les clés de la voiture familiale, et je les salue. Elles montent dans un autobus, pour San Cristóbal, au Chiapas, où elles vont suivre une formation d’une semaine à la gestion communautaire des conflits.
Dans la même minute, Albert descend de son bus à lui, en provenance de la capitale, Mexico. Je suis toujours aussi gauche pour donner les accolades qui ne se font pas chez moi – il m’est plus facile de signer mes e-mails en espagnol d’abrazos. Pour rendre la pareille de la gêne à Albert, je lui claque une bise, ce qui a encore aujourd’hui le don de le déstabiliser. « Que faire à Mérida ? me lance-t-il. Pas grand-chose à part aller aux cantinas ! Enfin, il y a bien des activités pour touristes, comme visiter les bâtiments construits sur les temples mayas, par exemple ! » Ce soir-là, nous n’arrivons même pas à trouver un de ces bars restaurants qui, avec les accordéons de corridos, font le ciment du Mexique. Nous finissons dans un café rock qui passe de la bachata.
On rit, on opine, on exagère
Passé le constat partagé que nous vivons dans une course permanente, loin de nos rêves de sages paysans, nous retrouvons, devant un burger, notre grammaire, faite de mon espagnol approximatif et de son humour mexicain. La seule évolution notable de nos échanges étant le langage inclusif, qui donne de nouvelles perspectives aux jeux de mots.
Nous poursuivons notre discussion pendant l’heure et demie de route qui nous mène de Mérida à Sanahcat. Puis autour de notre première caguama, bière à partager au nom de grosse tortue marine, nous nous remémorons celles et ceux que nous avons connus. On rit, on opine, on exagère. C’est bon, on n’a pas perdu nos 20 ans. Même si les cheveux d’Albert ont poussé, et nos ventres aussi. Surpris de m’en sortir parfaitement avec mon hamac, je m’endors la tête pleine d’images et d’interrogations.
Le réveil se fait au chant du coq, d’autant plus que celui d’Albert semble m’avoir pris en grippe et s’est posté à deux mètres de mon hamac. Ma chambre est ouverte sur le solar, la basse-cour traditionnelle plantée d’arbres fruitiers, parcourue de dindons, canards et poules. Ce matin, je vais enfin découvrir Sanahcat, le fief d’Albert et de ses aïeuls, où il a décidé de retourner vivre. Je savais bien qu’il venait d’une autre histoire que celle de la jungle de Calakmul. Ici, plus près de la mer, au cœur de la péninsule du Yucatan, pas d’ambiance tropicale, mais une impression de friche arbustive et épineuse infinie, que seuls interrompent des murets de pierres sèches calcaires plus ou moins effondrées. Le village, quadrillé de rues perpendiculaires, est composé de maisons de parpaings aux fondations apparentes et démesurées. Il ne reste plus que quelques bâtisses traditionnelles en terre rouge et bois, aux pignons joliment arrondis. Une église du XVIe siècle trône au centre, à proximité du terrain de basket couvert, de l’école et de la mairie. Ce paysage traumatisé tranche avec la tranquillité de ses habitants. Ici, tout semble en attente, comme l’extension des maisons.
L’heure des zébus et des grands-pères
Albert a terminé sa maîtrise de biologie. Il s’est marié avec Sara, a eu trois enfants et a travaillé dans des projets de développement de l’ONG grâce à laquelle nous nous sommes connus, avant de s’installer ici. Sa famille a maintenant sa parcelle au sein de l’ejido, comme les familles que nous avions accompagnées vingt ans plus tôt. La sienne se trouve à deux kilomètres de la maison, après le terrain de foot. Ce matin, je m’y rends à 6 heures pour profiter de la fraîcheur. C’est l’heure où l’on croise, sur la route de pierre blanche qui s’enfonce dans la savane arborée, des petits troupeaux de zébus, pas très épais en cette saison sèche, et les grands-pères, sac en bandoulière et machette à la main, qui partent préparer leurs cultures. Ils prennent le temps de s’arrêter pour me saluer : « Vous allez au chile feliz ? »
Le chile feliz, le « piment heureux », c’est le nom donné à la parcelle d’Albert par son père, qui y a cultivé la plante de manière intensive dans les années 1990. Jusqu’alors, les paysans produisaient le sisal, exporté pour ses fibres. Quand le marché du sisal s’est effondré, l’État et la Banque rurale ont mis en place des programmes pour financer d’autres cultures. Le paternel n’y a rien gagné, mais y a laissé sa santé et ses illusions : il a fini par travailler comme maçon à Mérida, partant avant le lever du jour et revenant de nuit. Cette période a été particulièrement marquante pour mon ami. L’argent manquait et il voyait son père beaucoup souffrir. C’est à ce moment-là qu’il a décidé d’étudier l’agronomie, pour trouver une issue et, pourquoi pas, relancer ce sisal qui finalement donnait plus de sécurité à ses parents.
Les fous du pich
Le retour à la terre d’Albert a été officialisé au pied du pich. C’est le nom maya pour le grand arbre aux fruits en forme d’oreilles, à l’entrée de sa parcelle. En 2013, avec sa sœur et son frère, ils y ont réuni leurs parents pour leur annoncer qu’ils voulaient reprendre le terrain et y développer un projet collectif. « Ils nous ont pris pour des fous, mais au fond de leur cœur ils étaient avec nous », se souvient Yamili, la sœur d’Albert. Elle aussi travaille ici, dans cette structure hybride entre centre de recherche et ONG : U Yich Lu’um, « Le Fruit de sa terre » en maya, regroupe des activités agricoles – pour faire revivre l’agriculture traditionnelle et gagner en autonomie alimentaire – mais aussi éducatives destinées aux enfants du village – sur la faune et la flore, la langue maya, les rapports de genre, les relations de violence, etc.
Les frères ont également demandé que le titre d’usage du terrain soit transmis à Yamili. Pour la première fois, une femme allait siéger à l’assemblée, socle de la communauté villageoise. Jusqu’alors « les hommes faisaient taire les femmes », dénonce Yamili avec une émotion tranchante et claire. Dorénavant, « en tant qu’ejidataria, ma parole vaut la leur. Pour mes frères, c’était normal. Pour certains voisins, c’était plus difficile à accepter ». Cette décision s’inscrit dans une réflexion plus globale encore : « Pour nous, Mayas, la notion de communauté s’étend à la nature. On ne peut pas défendre la nature sans s’opposer aux violences faites aux femmes. Les combats pour l’écologie ne peuvent être détachés des combats de genre. » Du haut de sa trentaine, la cadette des Chan Dzul est également représentante du Yucatan au sein du Conseil national indigène, entité liée au zapatisme, qui combat pour l’autonomie des peuples au Mexique, contre ce que ses membres nomment « le capitalisme patriarcal ». Yamili sourit : « C’est grâce à Albert, il m’a fait lire tellement de textes sur le zapatisme quand j’étais ado… J’ai voulu me former à une discipline qui me permette de ne plus avoir honte de ma famille, de nos noms mayas, de ce que nous sommes. J’ai étudié l’anthropologie, puis j’ai passé une maîtrise d’éducation populaire, pour travailler avec des enfants hors de leur temps scolaire et leur permettre d’avoir un espace pour s’épanouir en dehors de contextes familiaux souvent violents. »
Féministe au pays du macho
Il y a vingt ans, Albert me confiait déjà la difficulté d’être féministe au pays du macho mejicano. Peut-être que le changement le plus profond se situe là aujourd’hui : les femmes occupent une place centrale dans l’organisation, la pensée collective, les prises de décisions et les développements concrets des projets. Sara, la compagne de mon ami maya, est à la tête de U Yich Lu’um, qui compte maintenant neuf salariés. Quatre travaillent dans la partie productive, notamment de légumes, cinq se consacrent à l’administration de l’association et aux projets socio-éducatifs. Albert est chargé de dénicher les financements pour faire tourner la structure. « Ça fait trois ans que nous avons trouvé un équilibre économique. Avant, c’était très difficile », soupire mon ami.
Au pied du pich, le sol apparaît extrêmement âpre pour un paysan béarnais habitué aux vertes prairies et aux forêts. Des bandes argileuses rouges s’étalent entre les affleurements de roche calcaire sur lesquels pousse un maquis épineux dense et sec. Il est bien difficile d’imaginer cette terre offrir assez de ressources pour faire vivre les grandes cités mayas, qui ont abrité jusqu’au XIVe siècle des dizaines de milliers de personnes, voire des centaines de milliers pour les plus importantes. Mais si elle l’a fait, elle le peut encore. Albert entreprend de me faire la visite.
Le maïs n’était pas une simple céréale, comme on dit en Occident, c’est une force, une énergie, un souffle qui habite le grain.
Pedro Uc, poète maya contemporain
Un petit chemin monte à gauche jusqu’à un bâtiment en construction, aux extrémités arrondies, ressemblant aux maisons traditionnelles mayas en bien plus grand et qui abrite une salle de classe, bientôt terminée. Plus loin, une pépinière couve des dizaines de ramones, des arbres fourragers qui dynamiseront le maquis. Un verger tout proche accueille des ruches pour les abeilles mélipones, et des bacs pour les lombrics. Albert file et je suis son catogan – il faut que je pense à lui demander s’il s’est laissé pousser les cheveux pour affirmer sa « mayitude ».
Nous arrivons au jardin où travaillent Carlos, Ariel, German et Rodolfo, quatre voisins, anciens maçons à Mérida. Passé un portillon en grillage, la vie éclate. Les plants de tomates et d’aubergines ploient sous les fruits, les planches sont remplies de coriandre, salades et piments. La terre rouge et argileuse se fait plus douce. Derrière le muret de pierres commencent à se former de petits ananas au cœur de leurs cactus.
« Albert, tu ne m’avais pas dit que vous aviez des cochons ?
— Si, ils sont dans leur grange avec les moutons, derrière les deux hectares où on prépare le brûlis de la milpa. »
La milpa – kool en maya – est une technique d’association de cultures, à la base du système alimentaire de Mésoamérique, qui a nourri pendant près de trois mille ans la civilisation maya. Dans ces espaces de production annuelle, on sème à la main trois plantes sœurs ensemble : le maïs, la calebasse et le haricot rouge. Mais kool signifie aussi « notre âme » : la milpa est le lieu du maintien de la relation des vivants et non-vivants à leur territoire. La faire revivre, c’est retisser cette relation. Albert, avec un air grave que je lui ai rarement vu, me dit : « Nous sommes persuadés que nous avons un lien particulier avec l’environnement naturel, ce lien nous constitue. En revenant à la milpa, nous retournons à notre place. » Une interconnexion à la fois matérielle et spirituelle, dans laquelle le maïs joue un rôle sacré, comme l’écrit Pedro Uc, poète maya contemporain : « La culture du maïs, chair et sang de la femme et de l’homme mayas, nous a permis de rêver, de croire, de créer un langage et une langue singulière grâce auxquels nous communiquons avec l’âme – ool – de ce fruit. On a découvert que ce n’était pas une simple céréale, comme on dit en Occident, c’est une force, une énergie, un souffle qui habite le grain. Ce n’est pas pour rien que l’on appelle “inaj” la semence, ce qui signifie la maison du vent, de l’énergie, du ool. »
Dans un Mexique sans sombreros
Lors d’une veillée à Calakmul il y a vingt ans, Albert m’avait demandé : « ETA, ils tiennent combien d’hectares ? » À l’époque, sa question m’avait fait beaucoup rire. Je pensais qu’il réfléchissait selon un logiciel guévariste : groupe armé, territoire, Sierra Madre, expansion de la révolution… Je comprends aujourd’hui que le territoire revêt un sens plus profond pour mon ami : il représente à la fois l’espace de vie et de production où se recrée, dans l’apparente simplicité du travail de la terre, un mode de rêver ensemble. Sur la milpa, le ool, l’âme, l’énergie de vie, se maintient et se développe dans l’acte de semer. Lorsque ce travail est collectif, le ool devient un souffle où s’additionnent les aspirations et les forces. « Mon grand-père a connu l’époque où la milpa se travaillait de manière collective, les paysans regroupant leurs parcelles pour y travailler », m’explique, nostalgique, Albert quand nous terminons la visite par 35 degrés à 10 h 30 dans ce Mexique sans sombreros.
Mon ami lit le combat des zapatistes avec des yeux profondément mayas, je ne m’en rends compte que maintenant. Ici, lutter pour son territoire n’est pas une tactique révolutionnaire, c’est un combat ordinaire, vital. La propriété privée était étrangère à l’Amérique précoloniale. D’ailleurs, le « terre et liberté » scandé par Zapata en 1910, et qui a inspiré les zapatistes des années 1990, était un cri de révolte non pas pour demander un transfert de propriété des terres, mais pour que celles-ci reviennent à un usage collectif.
Du Yucatan au Béarn, contre le libre-échange

Depuis mon arrivée, Albert a des allures de trader en télétravail à la campagne. Entre les conférences téléphoniques et les séances d’ordinateur, il n’a pas une seconde à lâcher pendant la journée. C’est dans la fraîcheur du soir que nous discutons de la vie. Mon ami me demande à quoi ressemblent mes vaches. Je lui montre une photo que vient de m’envoyer ma mère, responsable temporaire du troupeau à Aramits. Oui, c’est beau, l’herbe est grasse et les bêtes sont deux fois plus grosses que celles de son village. Mais je lui explique que je vois surtout, à l’arrière-plan, le mauvais état de la clôture et de la haie. Que mon grand-père me foutrait des claques. Albert sourit, il me comprend.
La légende familiale des Chan Dzul veut que les parents, suivant une coutume maya, aient déposé dans son berceau des stylos pour lui garantir un avenir studieux. Le grand-père serait passé après, y déposer des grains de maïs. Aujourd’hui, ce grand-père qui n’a eu de cesse de donner à ses petits-enfants le goût et le savoir de la terre serait fier du chemin parcouru par son petit-fils, lui qui a dû vendre sa milpa parce que personne ne s’en occupait au village. « J’en ai pleuré », confie Albert dans sa cuisine, construite par l’aïeul. Nous baissons les yeux pour fixer la table.
Mon lien à la terre s’est noué sur des émotions semblables. Le village de mon père, entre Béarn et Pays Basque, a perdu plus de la moitié de sa population en trente ans. « Il y a bien longtemps qu’on a entendu le rire d’un enfant dans le quartier », a glissé un jour mon oncle berger avec tristesse. Mon grand-père n’a pas déposé de veau dans mon berceau, mais je porte son prénom. Passionné de livres et curieux du monde, il avait relancé la ferme familiale au sortir du stalag et de la Seconde Guerre mondiale. C’est sur ses terres que je travaille aujourd’hui. Peut-être le sentiment fraternel qui me rapproche d’Albert se nourrit-il de cette conscience mâtinée de culpabilité.
Un monde se déchire
Quand je suis rentré de mon premier séjour au Mexique, après avoir terminé mon parcours universitaire, j’ai travaillé sept ans durant dans un syndicat paysan basque. Cela m’a permis de défendre une agriculture qui avait fait vivre ma famille, mais aussi d’approfondir ma compréhension d’un monde rural en mutation. Mutations qui engendrent des drames individuels silencieux. J’ai accompagné des dizaines de paysans subissant des décisions dont la rationalité scientifique et administrative allait souvent à l’encontre de la réalité du terrain. Une grande partie de la violence se situe là aujourd’hui : si une mesure ou une amélioration technique ne fonctionne pas, alors tout l’échec repose sur l’agriculteur. Or les échecs répétés poussent des personnes souvent seules à cesser l’activité et à couper le lien transgénérationnel à la terre.
Avec d’autres, nous luttions au syndicat pour que les paysans, même de petites exploitations, puissent percevoir les aides européennes. Dans le même temps, le libre-échange, qui avait poussé des cultivateurs mayas à se soulever, percutait aussi de plein fouet les campagnes pyrénéennes. En 1992, quand l’EZLN votait la guerre là-bas, la France agricole se déchirait et manifestait violemment contre les orientations prises dans le cadre de l’Uruguay Round, cycle de négociations internationales ayant abouti à la création de l’Organisation mondiale du commerce.
La puissante FNSEA (Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles), poussant d’abord les agriculteurs à aller dans la rue, avait rapidement accepté que la production agricole européenne entre sur ce vaste marché mondialisé. Les producteurs allaient devoir désormais vendre aux prix des cours mondiaux, particulièrement bas. Leurs pertes seraient compensées par des subventions allouées en fonction des surfaces et de la productivité. Autrement dit, les propriétaires d’exploitations les plus grosses et les plus productives allaient bénéficier de la majorité des aides. La froideur statistique masque mal une apocalypse : en France, en trente ans, le nombre de fermes est passé d’un million à 500 000. Ce qui a été vécu à l’échelle de mon village s’est produit dans toutes les campagnes.
Une porte vers l’inframonde
Rodolfo s’engage dans un layon, je lui emboîte le pas, Albert ferme la marche. Nous partons explorer une lagune avec le voisin, qui travaille aussi pour U Yich Lu’um. Comme il y a vingt ans, nous voilà dans la forêt, débattant avec un troisième camarade, que nous interrogeons sur le nom des plantes en maya. Nous repérons les traces de dinde sauvage ou de cerf quand, tout à coup, la végétation verdit et se fait plus haute. « Mira ! s’emballe Albert – “Regarde !” Des orchidées ! » Au son de l’exclamation, deux oiseaux à la queue prolongée de plumes irisées surgissent d’une masse fraîche et sombre, dissimulée derrière des lianes parsemées des fleurs favorites de mon ami. Un cénote ! C’est la première fois que j’en vois un. Il s’agit d’une cavité dans le sol, qui donne accès à l’une des plus grandes réserves souterraines d’eau du continent américain, courant sous la roche blanche du Yucatan – la même qui alimentait les grandes cités. C’est aussi une porte vers l’inframonde des Mayas. La région de Sanahcat en est constellée.
Alors, comme il y a vingt ans dans la jungle de Calakmul, nous nous asseyons et discutons du sens de ce que nous avons observé. De l’impossibilité de donner une valeur à une telle richesse, du système de goutte-à-goutte qui pourrait être tiré depuis la cavité pour arroser des légumes, des roches sur lesquelles pourrait être posé un rucher à mélipones… Rodolfo ne veut plus travailler à Mérida, ni vendre sa parcelle – il a subi la pression de voisins qui voulaient le pousser à la vendre. Je sais que ces mots sonnent comme une victoire pour Albert.
Le sisal a rasé la forêt
À quelques centaines de mètres de la parcelle surgissent les ruines d’anciennes écuries. Sur un tertre, une grande maison coloniale éventrée laisse s’échapper des frondaisons de ficus à ses fenêtres. Ce sont les restes d’une dépendance de l’hacienda du village. « Construite sur les fondations d’un temple des anciens », précise Rodolfo. En 1519, lorsque les premiers Espagnols touchaient les berges du Yucatan, mes ancêtres commençaient à construire la maison où j’habite. Le village d’Albert, lui, n’existait pas. Mais les conquistadors avaient droit à une récompense – la mercedes – pour leurs efforts, offerte par leur capitaine et sujette à l’approbation du roi. Il s’agissait le plus souvent de terrains, marquant le début de la propriété privée sur les terres mayas. Les autochtones étaient regroupés et confiés au colon qui les exploitait. Sanahcat, le village d’Albert, est né du rapprochement des habitats dispersés en un seul village ou paroisse, en vue de l’évangélisation et de l’asservissement.
Avec le développement des haciendas de sisal, cette organisation a duré près de deux siècles et transformé le Yucatan en une immense monoculture. Il faut dire que la plante a deux facultés exceptionnelles : elle pousse quasiment sur la roche, sans eau ni engrais, et possède des fibres extrêmement résistantes. Pour moi, la couleur blonde du sisal, son odeur âcre et chaleureuse, son tranchant me renvoient avec plaisir aux dernières bottes de foin carrées de la ferme familiale, au tournant des années 1980. Pour Albert, c’est une culture qui a rasé la forêt maya et exposé son grand-père à des scènes inouïes de violence : les journaliers qui ne faisaient pas leur quota de ballots étaient attachés et fouettés au sang. Après la réforme agraire, à la fin des années 1930, qui a redonné les terres aux communautés, c’est l’État qui a pris en main la transformation et la commercialisation du sisal. Les paysans sont passés du statut de quasi-esclaves à celui de petites mains d’un capitalisme d’État. Et ce jusqu’aux années 1980, quand le marché du sisal s’est effondré avec l’avènement des cordes synthétiques.
Aujourd’hui, les projets agricoles que le gouvernement a promus – sisal, piment, vaches – ont tous cessé. Pour mon dernier jour, nous présentons la récolte hebdomadaire d’Albert et ses collègues sur la place principale du village, à côté du vendeur de tacos. Pour la première fois depuis des années, des denrées cultivées à Sanahcat y sont vendues. En une heure, nos étals sont vides. « Nous pourrions vendre trois fois plus cher au marché Slow Food de Mérida, sourit mon ami. Mais pour atteindre l’autonomie alimentaire du village, nous préférons rester ici, dans l’espoir de susciter des vocations. »
Le président des constructeurs
En haut de l’escalator qui mène à l’embarquement, à l’aéroport, une exposition de photos dont les légendes sont écrites en maya et traduites en espagnol retrace le passé archéologique du Yucatan. Ma gorge se noue : ces panneaux sont presque cachés, comme si les voyageurs ne devaient pas trop savoir où ils avaient mis les pieds. J’entends Yamili, la sœur de mon ami, me raconter le profond racisme subi encore aujourd’hui. Je revois les irréparables saignées dans la forêt yucatèque, causées par le mégaprojet de train maya, destiné à relier les pôles touristiques côtiers aux sites archéologiques – projet initié par ce même Andrés Manuel López Obrador que nous soutenions il y a vingt ans, devenu entretemps président et soutien des grands constructeurs. Je ressens à nouveau ma stupeur quand Rodolfo m’a donné le prix du maïs qui sert de repas à ses bœufs : le même qu’à la bourse de Chicago, ou à la coopérative de ma commune.
Et puis ma gorge se dénoue au souvenir des saluts brefs et amicaux lancés par mon frère maya quand il se promène dans son village. « Héou ! » Les mêmes onomatopées campagnardes que je me surprends à utiliser chez moi. Le visage maculé de terre rouge d’Ixchel, la fillette d’Albert au milieu des rangs de tomates. Je vois Felipe, son grand frère, moquant le gringo venu lui apporter son goûter en retard, au portail de l’école. Quelques minutes plus tôt, j’ai pris une grande inspiration pour donner des abrazos à mes amis. « Reviens, c’est bien de t’avoir par ici. » Non, « c’est à votre tour de venir ».