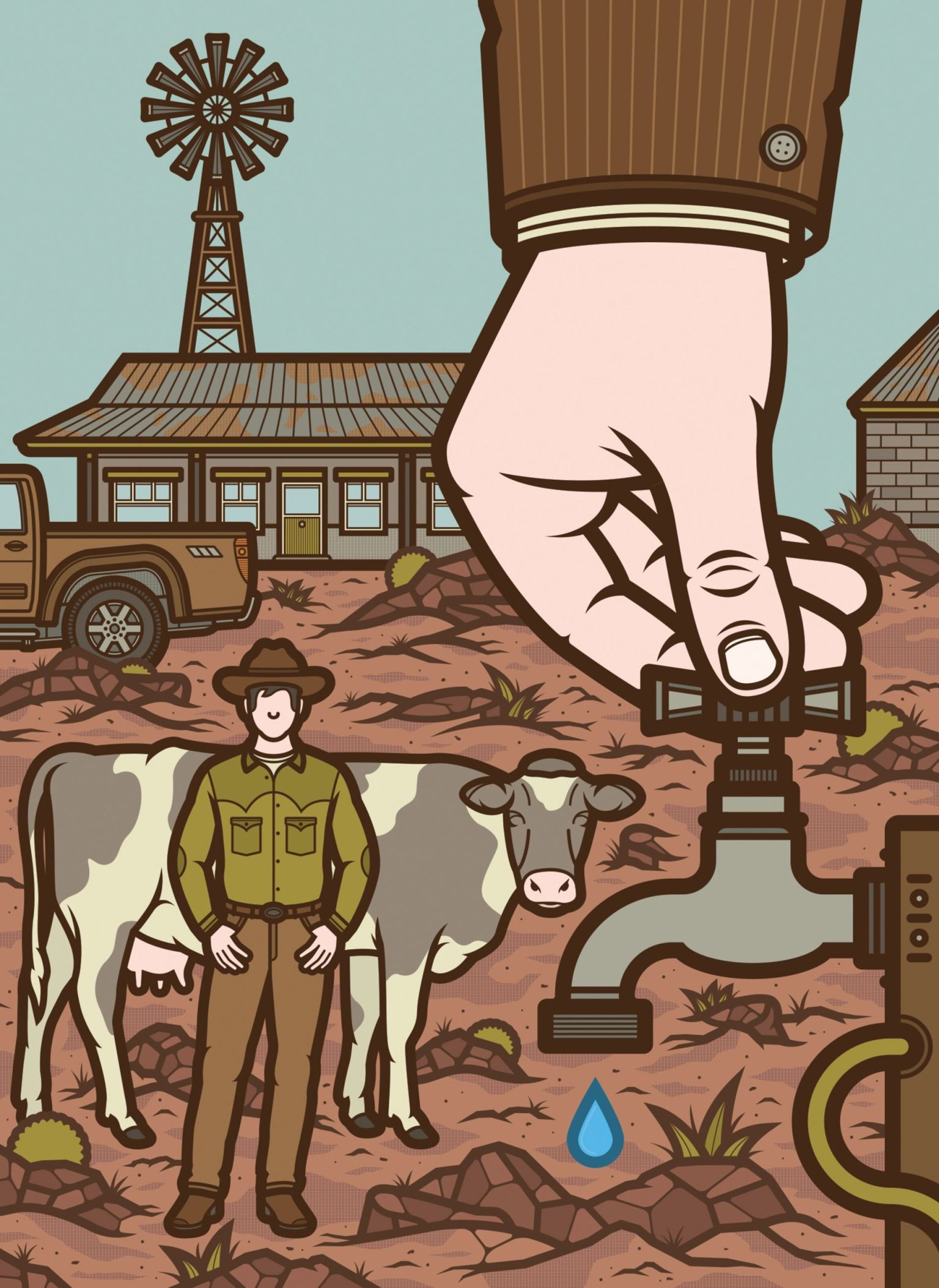Kilomètre après kilomètre, de l’herbe sèche, à perte de vue. La terre est orange, de minitornades dansent à l’horizon. Le macadam fonce tout droit, interminable. De temps à autre, des eucalyptus, des bosquets, des arbres morts. Parfois, quelques maisons alignées. Seules traces de présence humaine à des centaines de kilomètres à la ronde, elles voient passer les trucks, les camions à double remorque qui sillonnent le continent jour et nuit. Le GPS prévient : « prochain virage dans 92 kilomètres ». Les panneaux à fond vert annoncent Bendigo, Finley, Leeton. C’est le bush australien : pas encore le désert, mais déjà l’immensité monotone.
Et puis, à mesure qu’on avance dans cet océan couleur de paille et d’ocre, des taches de vert. De hautes herbes à vaches, des cultures de riz, de luzerne, de soja. Des étendues de blé, même du maïs. Des parcelles de vie arrachées à la terre aride. La Nouvelle-Galles du Sud, au sud-est, est l’un des États les plus secs de l’Australie transformé en grenier agricole. Ici, l’homme a domestiqué la nature à coups de bulldozer, de barbelés, d’engrais et d’irrigation. Il a dompté le fleuve le plus majestueux du continent, le Murray, à l’aide de gigantesques barrages. L’eau est partout. Elle longe la route et brille au soleil, arrogante, dans ses canaux artificiels en béton. Larges comme des avenues, les voies d’eau se séparent en rues secondaires qui se divisent en chemins puis en impasses pour arroser les fermes les plus reculées.
« Même quelques millimètres… »
Devant la ferme familiale de David Owen, sur la Riverina Highway, à mi-chemin entre Finley et Deniliquin, un panneau « Auction » annonce une vente aux enchères. Les voisins sont venus nombreux, en pick-up déglingués ou en 4×4 neufs. Ce dimanche matin, le peuple des fermiers pleure l’un des siens. David Owen vend.
Le commissaire-priseur porte des bottes de cow-boy et un stetson. Quand il ne liquide pas une ferme, il anime les mariages. « 50 dollars ! 60 ! 80 derrière moi ! 100 ! Personne d’autre à 100 ? hurle-t-il à toute vitesse d’une voix nasillarde. Une fois, deux fois, trois fois, adjugé à 100 dollars ! » Autour de lui, les visages sont fermés. Pour faire monter l’enchère, il suffit d’un signe discret de la tête. On ne se frotte pas les mains quand un voisin crève.
L’Australie est une des principales puissances agricoles du monde. L’ancienne colonie britannique, bâtie par des bagnards et des pirates, exporte 70 % de sa production et fournit une grande partie de l’Asie en viande, riz et céréales. Mais pour combien de temps ? Sur le continent le plus sec de la planète, demander au ciel qu’il pleuve est devenu la prière collective de la région. « Même quelques millimètres », implore la boulangère de Finley. Il faudrait des jours d’une pluie diluvienne pour rassasier les sols qui rendent l’âme sous l’œil impuissant des agriculteurs. « Même les arbres centenaires, qui ont survécu à tout, finissent par mourir. Il n’y a plus un brin d’herbe, plus un ver de terre ni un insecte, plus d’oiseaux ni de grenouilles, se désespère la commerçante. Les kangourous pullulaient, on en voit beaucoup moins. » Les cinq dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées. Jusqu’à 49,9 °C dans le sud du pays en décembre 2019. L’ampleur des récents feux de forêt, à 250 kilomètres de là pour les plus proches, a encore ajouté à la catastrophe écologique.
On a eu jusqu’à 1 300 vaches dans les années 1980-1990. L’an dernier, on avait réduit à 300.
David Owen, fermier à mi-chemin entre Finley et Deniliquin
Tout doit partir. Abreuvoirs en ciment, rouleaux de barbelés jamais posés, citernes en aluminium, tracteurs, motos, quads. David Owen, 62 ans, colosse barbu aux yeux tristes et aux joues tannées, laisse au plus offrant les milliers d’objets qui résument ce qu’il est : un Australien du bush, fils de paysan, éleveur de vaches laitières acculé à la faillite. Une vie de travail et de liberté, jusqu’au jour où tout s’est arrêté, faute d’argent pour acheter de l’eau. Il a passé toute sa vie ici, dans un rayon de dix kilomètres. « La propriété de mes parents était à quelques pas. » Les dernières bêtes sont parties il y a une semaine. Certaines rachetées par les éleveurs des environs, les autres à l’abattoir.
Bras croisés, David répond aux sourires gênés, scrute les acheteurs. La vente couvrira l’achat d’une maison avec un petit lopin de terre, pour commencer une vie de retraité avec sa femme Jenni. Une fois tout le monde parti, il desserre la mâchoire. « On a eu jusqu’à 1 300 vaches dans les années 1980-1990. L’an dernier, on avait réduit à 300. Je connaissais le nom de chacune, celui de leur mère, de leur grand-mère. » Il s’essuie un œil. « Il paraît qu’on s’en remet. »
Le pays-continent affronte depuis vingt ans des périodes de sécheresse de plus en plus fréquentes, longues et intenses. Il ne pleut plus, les rivières se tarissent, les sols se craquellent, les arbres sèchent sur pied et le bétail est à demi mort de soif. Ce n’est pas une crise, c’est l’Australie de demain, il va falloir s’habituer. Le réchauffement pose aux 25 millions d’Australiens des questions de survie. Comment adapter sa façon de consommer, de produire ? L’eau devient une ressource rare, comment la répartir ?
Le pays a cru trouver la solution dans son esprit de conquête. La terre australe, colonisée à la fin du XVIIIe siècle, au mépris des aborigènes qui la peuplaient, par les parias de Grande-Bretagne, les exclus de la révolution industrielle, puis des centaines de milliers d’Européens après la Première Guerre mondiale, revendique une mentalité de pionniers. En 2007, le pays s’invente de nouvelles règles en votant le Water Act. Les autorités évaluent chaque année la quantité d’eau disponible dans chaque État. Elles en répartissent la moitié entre les différents types de consommateurs – agriculteurs, industriels, foyers – et soumettent l’autre moitié à la loi de l’offre et de la demande.
Depuis les premiers colons, les fermiers australiens ont droit à des quantités d’eau qu’ils peuvent pomper des rivières ou sous-sols. Depuis toujours, des droits d’eau sont liés à chaque parcelle. Avant la loi sur l’eau, on pouvait revendre le surplus à son voisin, à prix d’or ou à prix d’ami. Désormais, le prix de cette eau n’est plus fixé par le détenteur des droits d’eau, mais par le marché.
L’ouverture au marché s’accompagne d’une autre règle qui change tout : plus besoin de posséder une terre pour acheter des titres d’eau. Un cadre allemand, un trader australien, un investisseur lyonnais, tout le monde peut y prétendre. L’eau est cotée en Bourse, comme le blé ou le pétrole. D’année en année, la part de la spéculation a grossi au détriment des agriculteurs. Pendant les sécheresses, moment où les fermiers ont le plus besoin d’eau, des financiers à l’autre bout du monde se frottent les mains, en espérant que la pénurie dure pour que leurs bénéfices explosent.
L’Australie croit sauver son agriculture intensive, ses espaces naturels, son mode de vie. En fait, le pays accélère la catastrophe.
L’eau s’achète du bout des pouces, debout au milieu de son champ, grâce à un téléphone portable et à une application connectée au marché vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Une vanne, équipée d’un petit panneau solaire, bloque l’arrivée d’eau. Une fois qu’on a payé, la compagnie de distribution d’eau prévient par texto du jour et de l’heure de l’ouverture des vannes. Depuis le Water Act, le monde du business regarde l’Australie, laboratoire où se testent les règles du monde d’après, avec des dollars dans les yeux. Le pays croit sauver son agriculture intensive, ses espaces naturels, son mode de vie. En fait, il accélère la catastrophe.
Au début, les fermiers applaudissent. « On voyait ces marchés comme un moyen de gagner un complément de revenu, raconte David Owen. On se disait qu’on pourrait arrondir les fins de mois. » C’est ce qui est d’abord arrivé : il a beaucoup plu les premières années. Et puis, ça a commencé à mal tourner. C’est la sécheresse, les autorités – l’État fédéral et les États en concertation avec les acteurs de la filière – réduisent les quantités d’eau allouées aux fermiers qui possèdent leur terre. Les quotas varient en fonction de chaque région, puisque la sécheresse ne sévit pas partout aussi fort. Si vous possédez 1 000 mégalitres (10 millions d’hectolitres) de droits d’eau et que votre quota est fixé à 80 %, vous aurez le droit de puiser 800 mégalitres. Si le quota est à 0 %, vous n’aurez pas une goutte. En 2013, David bénéficie d’un quota de 79 %. Depuis 2018, sa zone est à 0 % : il doit payer son eau au prix fort sur les marchés, et s’endetter pour acheter le fourrage qu’il n’a pas pu faire pousser.
« Je ne comprends rien aux Bourses de l’eau, soupire David. Si vous ne les consultez pas en permanence, vous ne savez pas comment les prix évoluent. Vous ne voulez pas les consulter, parce que la plupart du temps ça vous déprime. Vous vous dites : ça va baisser, il faut attendre. Mais ça continue d’augmenter. » Les prix ont doublé en moyenne ces cinq dernières années sur le territoire. Multipliés par neuf en deux ans chez David. « Plus le prix augmentait, plus on empruntait, plus notre lait coûtait cher à produire, plus on perdait de l’argent à la vente et plus on s’endettait… Un jour, ma femme a dit stop. » Un soir d’été, en mars 2018, après un nouvel épisode d’intense canicule, Jenni exige de quitter cette vie. « J’étais en train de perdre l’homme que j’aimais, raconte-t-elle sans le quitter des yeux. Et nous y laissions toutes nos économies. » Depuis, plusieurs de leurs voisins ont vendu leur ferme.
« C’est la roulette russe »
Rouler en Nouvelle-Galles du Sud, c’est plonger dans un film d’anticipation. Les volets claquent au vent, les barrières ne gardent plus aucun troupeau. Le dérèglement climatique et les marchés de l’eau ont eu la peau des petits. Il y a quarante ans, ils étaient 3 600 éleveurs de vaches laitières. Ils sont six fois moins. Dans cette région grande comme la France, dont 80 % de la surface est dédiée à l’agriculture, les villages se vident. « La production laitière en Australie, c’est fini. Bientôt on importera du lait de Chine ! »
À l’entrée d’une propriété au sud-ouest de Finley, un vieux micro-ondes rôtit au soleil : la boîte aux lettres de Bart Dohan, éleveur laitier. Casquette, chemise en jean et short kaki, il a le look des fermiers du bush. Il vit sur cette terre sauvage avec sa femme Tracie et leurs quatre enfants de 11 à 18 ans. On se croirait dans La Petite Maison dans la prairie. Mais la prairie n’a plus d’herbe. Les vaches ont les flancs creusés. Nous sommes fin janvier 2019. C’est l’été, il n’a pas plu depuis deux mois. Dans les canaux, l’eau est majestueuse, paisible. Trop belle. « Elle est là, sous mon nez, je peux la toucher, je peux y tremper mes pieds, mais je ne peux pas l’utiliser. Je n’ai pas les moyens. » Les caisses sont vides. Les factures impayées s’empilent. La nourriture des bêtes est rationnée. Elles ne produisent plus que la moitié de leur lait.
Tout arrêter ? Pour faire quoi, et où ? Bart et sa famille ont toujours vécu à la campagne et ils aiment cette vie. Autour de la table familiale, tout le monde a le nez dans son assiette. Le dîner est sommaire. Pain de mie toasté au gruyère râpé, et Coca-Cola. Sur son smartphone, Bart regarde les cours de l’eau. Ce jour-là, le mégalitre est à 250 dollars. Au début des années 2000, il se vendait entre 30 et 50 dollars. « On essaie de sauver nos vaches et de tenir le coup. Pour produire leur fourrage, il faudrait que j’achète pour 300 000 euros d’eau par an. Ça nous étranglerait. » Son voisin a dû débourser 600 000 euros. « Si une tempête détruit ses récoltes, il perd tout. Ce que j’espère, c’est qu’il pleuve, que les rivières se remplissent. Est-ce que ça arrivera ? Impossible de savoir. C’est comme jouer à la roulette russe ! » Il mime le revolver sur la tempe, le doigt sur la détente.

Pour la première fois de sa vie, Bart est allé manifester à Melbourne fin 2018 pour réclamer l’augmentation de la part d’eau réservée aux agriculteurs dans le bassin des fleuves Murray et Darling. Au détriment de celle promise à la nature. « Les écolos des villes mangent aussi », entend-on dans la manif. « Si les fermiers meurent tous, demain l’Australie devra importer sa nourriture. Et ça, ça pollue énormément ! » Le peuple des villes a ignoré les paysans du bush, c’est la part dévolue à la nature qui a augmenté, de 16 % : 3 200 milliards de litres sanctuarisés. Un cataclysme de plus pour les petits fermiers. Mais encore trop peu pour la nature, selon les scientifiques.
L’agriculture intensive et les spéculateurs ont trop puisé dans les nappes et les fleuves. Les débits fluviaux ont été modifiés, la salinité a augmenté, les berges se sont effondrées, la biodiversité s’est dégradée. Des centaines de milliers de poissons sont découverts ventre à l’air à la surface du lac Menindee en octobre 2018 et janvier 2019. « Une algue toxique », affirment un peu vite les autorités. Trop simple, répondent des chercheurs du Centre pour la biodiversité de l’Australian National University. Si l’algue toxique prolifère, c’est que les eaux du bassin sont mal gérées et que la pression sur les stocks exercée par les marchés est trop forte.
Dans un monde où l’eau doit être rentable, on l’immobilise parfois pendant des mois avant de la vendre au plus offrant. Les coffres-forts à or bleu sont des barrages titanesques. Elle ne circule plus. « Le flux des rivières n’est plus suffisant pour oxygéner les poissons, reconstituer les nappes phréatiques et charrier le sel jusqu’à l’océan », explique le rapport. L’État et les associations de défense de l’environnement ont rendu 2 750 milliards de litres d’eau à la nature depuis 2011, mais il faudrait doubler ce chiffre. Entre les exigences de la nature et la spéculation, Bart, l’éleveur laitier, est coincé.
Au volant de son 4×4 rafistolé, il nous emmène faire un tour. Voilà le canal à l’entrée de son champ. « Le combat est inégal. On n’aurait jamais dû laisser passer la loi. Une fois que le système est dérégulé, c’est trop tard. » Sa fille aînée vient se coller à lui. Elle rêvait depuis l’enfance de reprendre l’exploitation. Plus le temps passe, moins elle y songe. « Ne faites pas comme nous, ne choisissez pas ce modèle. Autrefois, l’Australie était le pays de l’entraide. Maintenant, c’est chacun pour soi. »
On a pompé trop d’eau du Murray. Le fleuve avait fini par mourir à petit feu. En donnant un prix à l’eau, les gens la gaspillent moins, surtout les agriculteurs.
Sarah Hanson Young, sénatrice écologiste
Pour répondre à la crise de l’eau, l’Australie a choisi le libéralisme en vogue depuis le début des années 1980, sous l’influence de Ronald Reagan aux États-Unis et de Margaret Thatcher en Grande-Bretagne. Tout le personnel politique a approuvé. Au moment du Water Act, en 2007, Malcolm Turnbull, le ministre de l’Environnement et des Ressources en eau, est un ancien dirigeant de la filiale australienne de Goldman Sachs, la banque contrainte de payer 5 milliards de dollars aux États-Unis pour avoir ruiné ses clients dans la crise des subprimes en 2008. Et qui a toujours prôné la libéralisation totale de tous les marchés.
Même les écologistes étaient pour. Au nom du climat. « On a pompé trop d’eau du Murray. Le fleuve avait fini par mourir à petit feu. En donnant un prix à l’eau, les gens la gaspillent moins, surtout les agriculteurs », assure la sénatrice écologiste Sarah Hanson Young, 35 ans. Elle reconnaît que l’eau des marchés ne profite pas toujours à ceux qui en ont le plus besoin. « Elle obéit à la loi du plus riche. » La sénatrice dénonce depuis dix ans les géants de l’agrobusiness, tout en défendant le modèle spéculatif. « Il fallait en passer par là pour que la prochaine génération dispose d’assez d’eau pour vivre. »
Les écologistes ont obtenu que la part d’eau réservée à l’environnement soit priorisée et se battent pour qu’elle augmente. En plus de la part que les autorités octroient chaque année à l’environnement, de riches fondations écologistes australiennes achètent des dizaines de millions de litres sur les marchés au prix fort, pour les soustraire aux agriculteurs et rendre l’eau à la nature. Et font encore monter les prix.

Des parcs verts, un golf en ville arrosé en permanence. Adelaïde, la ville la plus sèche du continent le plus sec de la planète, a des airs de Californie. Les gens circulent à vélo et vivent en short. La capitale de l’État d’Australie méridionale est aussi la capitale mondiale des marchés de l’eau. L’idée de privatiser la ressource et d’organiser son commerce a été théorisée par Mike Young, professeur d’économie à l’université de la ville. Cheveux gris plaqués en arrière, les yeux pétillants derrière ses fines lunettes, la voix douce, l’habitude de convaincre. « Moi j’enseigne comment rendre le monde meilleur », lance-t-il à un auditoire d’étudiants silencieux. Il a enseigné à Harvard et travaillé pour l’OCDE à Paris. Il apprend à ses étudiants à créer et gérer un compte d’eau. « Les pénuries existent déjà. D’ici 2050, la moitié de l’humanité vivra avec des ressources limitées. Il faut gérer l’eau avec parcimonie, pour être sûr qu’elle soit utilisée de la façon la plus rentable possible. Et gagner de l’argent. Et nourrir la population de la planète. »
Il compare la quantité d’eau disponible à une piscine dont la taille varie chaque année, selon l’état des réserves et des prévisions météo. Tous les acteurs se voient attribuer un pourcentage de la piscine, en fonction de l’activité, la taille, la population ou la consommation passée. En année faste, tout le monde est bien servi. En période de sécheresse, on se serre la ceinture. Il y a des garde-fous. La moitié de la piscine est réservée à la consommation quotidienne des humains et à la nature, pour entretenir l’écosystème et recharger les nappes phréatiques. L’autre moitié s’achète sous forme de droits, soumis à quotas. Certains droits sont permanents et leurs titulaires, assimilés à des propriétaires ; d’autres sont provisoires, octroyés à des locataires. Les propriétaires sont servis en priorité. Pendant les dernières canicules, certains locataires, la plupart du temps des agriculteurs, comme David et Bart, n’ont pas reçu une goutte. Des compteurs scellés, placés dans les canalisations et reliés à un terminal informatisé, permettent de suivre en direct la consommation. Et de fermer le robinet quand la limite est atteinte.
La population mondiale va passer de 7,5 milliards à 10 milliards d’habitants, il faudra nourrir et habiller tous ces gens. Il est temps de lui donner un juste prix pour arrêter de la gaspiller. »
Tom Rooney, fondateur et PDG de Waterfind
Et surtout gagner de l’argent.
Quartier d’affaires d’Adélaïde. Quelques tours entre les blocs d’immeubles. Dans un modeste open space, des trentenaires parlent avec calme dans le micro de leur casque, les yeux sur leur écran. Les petites mains du « monde meilleur » rêvé par Mike Young ont une chemise bleue avec un logo brodé : Waterfind. La première Bourse de l’eau du monde. Mâchoire carrée, poignée de main ferme, Tom Rooney, fondateur et PDG de Waterfind, sourit de toutes ses dents blanches dans le brouhaha : « On m’appelle “le pionnier” des marchés de l’eau. Sans eau, vous n’auriez ni vêtements, ni téléphone, ni voiture, ni maison, ni café. La population mondiale va passer de 7,5 milliards à 10 milliards d’habitants, il faudra nourrir et habiller tous ces gens. Il est temps de lui donner un juste prix pour arrêter de la gaspiller. » Et surtout gagner de l’argent.
Le patron de Waterfind est tombé dans l’eau par tradition. Son père avait monté la première entreprise d’échange entre fermiers dans les années 1980. Les transactions se concluaient en tapant dans la main. Acheminer l’eau pouvait prendre plusieurs jours. Désormais, tout se passe en temps réel. « Je me souviens de mon premier deal entièrement électronique, en 2003. Il a duré une microseconde. Une belle journée ! », sourit le trader. Il imagine l’avenir, un marché mondial qui fixera les cours selon les régions de la planète, l’œil sur la météo et le niveau des nappes. « Les sécheresses constituent-elles des opportunités ? C’est sûr. Est-ce mal ? Non. Les marchés sont le meilleur moyen de répartir l’eau. Sinon, quelle alternative ? Réduire la population mondiale en se débarrassant de 50 % des habitants ? Ce ne serait pas joli, non ? »
On pourrait imaginer une Bourse nationale de l’eau gérée par les pouvoirs publics, mais ça n’existe pas. Quatre plates-formes privées, dont Waterfind, se partagent les 2 milliards d’euros de ce marché en croissance et prélèvent un pourcentage sur chaque transaction. Le dérèglement climatique est une variable du marché. L’eau, un actif financier. « C’est fascinant de voir comment nos marchés sont devenus sophistiqués, sourit Mike Young, dans son université. Quand la météo annonce quelques gouttes de pluie la semaine prochaine, le prix de l’eau baisse, car les fermiers savent qu’ils n’auront pas besoin d’irriguer. Si les températures doivent monter dans la prochaine quinzaine, il grimpe. »
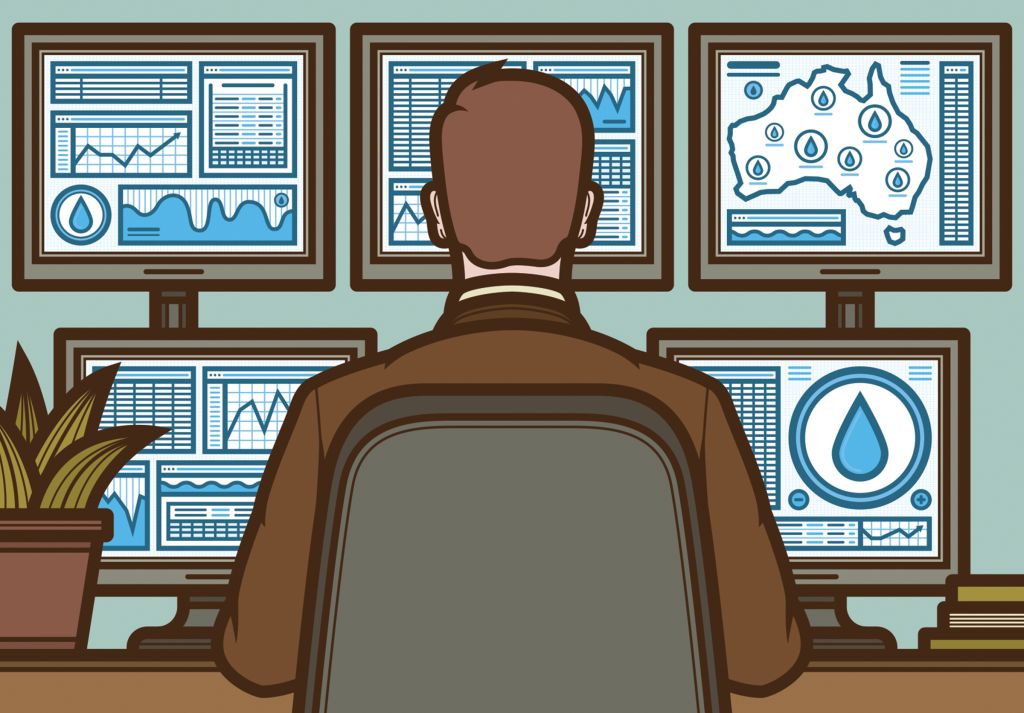
On vend ses droits via des plates-formes d’échanges, véritables salles de marché. Les Bourses qui fonctionnaient entre agriculteurs avant 2007 à l’échelle des États australiens ont été interconnectées, les canalisations, reliées entre elles. Des centaines de millions de litres circulent d’un point à un autre du pays. Tout le monde peut acheter des quotas d’eau australienne et les revendre après avoir encaissé les profits, les louer à des fermiers moyennant une redevance, ou les stocker dans des bassins artificiels géants en attendant que les prix montent. Tout le monde joue. Les investisseurs, les municipalités, les industriels de l’agroalimentaire, des agences gouvernementales. Même des ONG écologistes.
Les nouveaux seigneurs sont les fonds de pension australiens et étrangers, canadiens surtout, les sociétés d’assurances, même des universités américaines, comme Harvard. Les fermiers australiens leur ont trouvé un nom : les water bandits, les voyous de l’eau. David Williams, un des plus grands propriétaires de droits d’eau de Tasmanie, assume. Ce banquier d’affaires gère son empire depuis le 45e étage d’une tour de Melbourne. Il reçoit dans son bureau où s’entassent des caisses de bordeaux et de champagnes millésimés – avant, il était dans le vin. David Williams en a gardé un air rougeaud et une mine réjouie. Il y a cinq ans, il a investi 15 millions d’euros dans l’achat de droits d’eau qu’il loue aux fermiers. Une rentabilité à 8 %. Et les éleveurs ruinés ? « Je suis sincèrement désolé pour ceux qui vont devoir arrêter. Ce n’est pas une question de morale. L’eau a un prix. C’est le marché qui le fixe. Point final. »
Une récolte comme une autre
Retour dans le bush de la Nouvelle-Galles du Sud. Coton, céréales, noix, bétail, à cheval sur plusieurs états, Webster Limited, le pionnier de l’agroalimentaire australien depuis près de deux siècles, possède 350 000 hectares, l’équivalent de la moitié de la Corse. Sa fierté : les amandiers. Ce géant s’est lancé dans leur exploitation depuis que la Californie, premier producteur mondial, a été ravagée par une sécheresse en 2014. Par rapport à sa consommation d’eau, c’est le fruit qui se vend le plus cher. Dans l’agrobusiness du futur, chaque plante est évaluée selon la quantité d’eau nécessaire à sa croissance. Rentabilité maximale. Ici, on dit « optimisation ». À ce rythme, pour nourrir la planète, les hommes seront transformés en rongeurs.
À perte de vue, des amandiers au garde-à-vous. Dans un tourbillon de poussière, un tracteur surgit, serre un tronc dans une pince géante et secoue. Tout l’arbre vibre. Les amandes tombent comme des grêlons. Un engin les aspire, les nettoie et les trie. Brendan Barry, la quarantaine, chemisette et jean, en goûte quelques-unes. Il est le water manager, responsable de la gestion de l’eau, l’homme clé. Il gère un portefeuille de droits d’eau de 200 millions d’euros au cours du jour. Il cache son stress sous des airs tranquilles.
« Le prix de l’eau a doublé en six mois dans la région. La valeur totale de notre eau est plus élevée que celle de toutes nos terres, de nos usines et de notre bétail réunis. » Il stocke des millions de litres dans un bassin gigantesque. Sa mine d’or. Un dédale de tuyaux distribue la quantité dont chaque arbre a besoin, calculée selon la température de l’air, la sécheresse du sol, les prévisions de pluie. Il lâche un rire nerveux. « Un sac de grains vaut de l’argent. L’eau, c’est pareil. Mon métier est d’en dégager le plus de profit. Créer de la richesse pour nos actionnaires. »
À votre place, je regarderais du côté des éleveurs laitiers. Ils sont tous au bord de la faillite et cherchent à vendre. Il y a sûrement de belles terres à racheter. Et avec elles, des droits d’eau.
Lex Batters, courtier en eau
Brendan Barry est moins souvent dans les vergers qu’au siège, à Leeton. La pression est forte. Webster Limited est un poids lourd sur les marchés de l’eau. Elle en achète de grandes quantités quand les cours sont bas, les stocke et en revend une partie quand ils s’envolent. Une récolte comme une autre. Certaines années, il est plus rentable de la vendre que de l’utiliser dans les cultures. « Ce système est critiqué, dit Brendan. Mais quelle alternative ? Confier le soin à un bureaucrate de répartir l’eau entre les producteurs ? Ce serait ouvrir la porte à la corruption. »
La gestion de Webster à la goutte près attise les convoitises. Le plus important fonds de pension des fonctionnaires canadiens a proposé de racheter l’entreprise pour 530 millions d’euros. Pourtant, Webster Limited est aussi victime de la sécheresse qui frappe l’Australie. Après avoir affiché 24 millions d’euros de profits en 2018, elle en a fait dix-huit fois moins l’an dernier. La crise de l’eau n’épargne personne, mais quand les géants se contentent de morfler, les petits crèvent. Ce matin, notre water manager a rendez-vous avec son courtier en eau, Lex Batters. Webster est l’un de ses plus gros clients. « À votre place, je regarderais du côté des éleveurs laitiers, l’avertit Lex Batters. Ils sont tous au bord de la faillite et cherchent à vendre. Il y a sûrement de belles terres à racheter. Et avec elles, des droits d’eau. »
Mike Young, l’économiste qui veut « rendre le monde meilleur », et Tom Rooney, le « pionnier » des marchés de l’eau, rêvent d’étendre le modèle australien dans le monde. En Californie, des marchés se créent. En 2013, sollicité par un ministère britannique, Mike Young a préconisé la création de marchés de l’eau, à l’échelle nationale. Son rapport est resté dans un tiroir. « Ils ont trouvé mon approche un peu radicale », s’amuse-t-il. L’Europe résiste. Jusqu’à quand ?