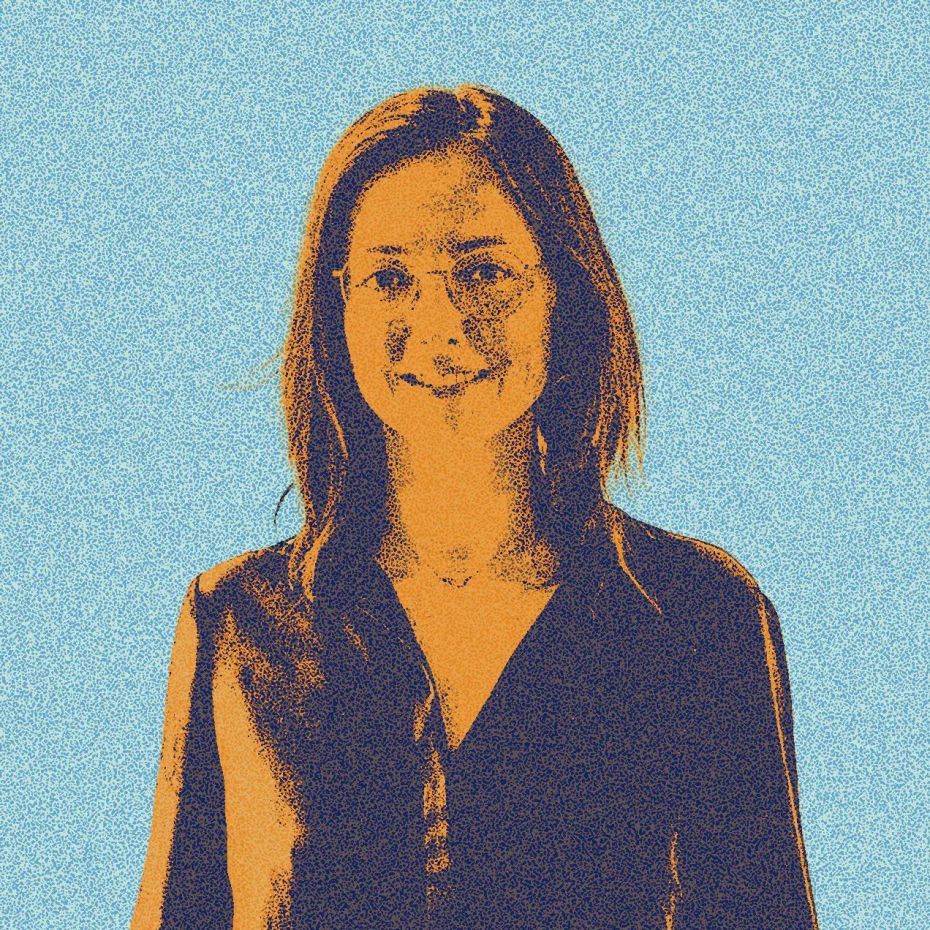Les mains sur le volant de sa vieille Fiat garée sur le bord de la route, en bas du versant italien du col de l’Échelle, Giuseppe* attend. Silence dans l’habitacle. Les deux Afghans sagement assis à l’arrière savent un peu d’anglais mais Giuseppe ne parle que l’italien. C’est sa fille qui traduisait pendant les jours qu’ils ont passés chez lui à Turin, le temps que s’organise leur passage à travers les Alpes. Elle n’est plus là. Giuseppe est un peu nerveux. Un Italien aux cheveux blancs à l’arrêt en bas d’un col frontalier avec deux Afghans emmitouflés comme des djihadistes à l’arrière ne passent pas inaperçu.
Lorsqu’ils nous voient enfin arriver dans les premières lueurs de cette matinée d’hiver, Tofan* demande à Mohmand* qui des deux est « son » capitaine : « Le chauve ou le hippie ? » Mohmand n’en sait rien. Il n’a pas vu mon visage depuis l’été 2010. À cette époque, officier dans la Légion étrangère en Afghanistan, j’avais le crâne rasé. Je m’étais engagé dans la Légion pour créer une radio communautaire en langue pachto et combler l’absence quasi totale de médias dans sa région perdue d’Afghanistan. Installée au milieu d’un camp militaire, Radio Surobi diffusait des émissions sur la santé ou l’agriculture, facilitait les communications entre auditeurs et proposait les programmes classiques d’un service public radiophonique. Mohmand y était technicien. Chaque matin, il marchait onze kilomètres dans la rocaille pour venir travailler.
La marche en montagne, une idée abstraite
Il me prend dans ses bras. Dix ans plus tard, il continue de m’appeler « my captain ». Rasé de près, le regard doux, la quarantaine, il n’a pas changé malgré l’épreuve de son long voyage clandestin. Moi, j’ai une barbe mal entretenue et les cheveux hirsutes. Il me présente son ami, un instituteur de son village. Je lui présente le mien. « Le chauve » est caméraman, il prépare un film sur les passeurs. Giuseppe, le chauffeur de la Fiat, serre nos mains et repart vers Turin. Nous nous connaissions à peine. Sa fille et la mienne se sont rencontrées lors d’un échange scolaire. Il a passé une nuit à la maison en venant la récupérer à Paris. De lui, je sais juste qu’il est artisan dans le bâtiment et militant de gauche. C’est un taiseux, un atout quand on s’essaie à l’action clandestine. Bref, il a ma confiance. Il n’a pas barguigné lorsque je lui ai annoncé que deux Afghans épuisés arriveraient bientôt de Trieste pour squatter chez lui quelques jours.
Un quart d’heure plus tôt, à l’aube, j’ai récupéré quatre paires de raquettes et de quoi habiller les Afghans. Un contact en France avait confié le matériel à un ami italien, qui, prudent, m’a donné rendez-vous dans un endroit discret. Il a ouvert son coffre. J’ai pris le matériel et il est parti.
Mohmand et Tofan ont investi dans une paire de baskets neuves et des lunettes de soleil. Comme la plupart des exilés qui passent par ce col, ils ont une idée très abstraite de la marche en montagne en hiver. La neige, ils la voyaient tous les jours depuis leur village afghan, mais au loin, sur les sommets enneigés de la chaîne du Panshir. Il ne neige pratiquement jamais dans leur village. Ganda Khasaray se trouve dans la vallée de Tizin, une étendue plate de caillasse et de touffes végétales où un oued presque à sec se fraie un chemin chaotique.

Les deux Afghans sont en slip au bord du coffre ouvert de ma voiture. J’ai insisté pour qu’ils troquent leur jean contre un pantalon en Gore-Tex, leurs baskets contre des chaussures de montagne étanches. J’ai ajouté collants et chaussettes en laine. Alors qu’ils ont enfin lacé leurs chaussures, j’étale la carte au vingt-cinq millième sur le capot. Je pointe l’index sur Pian del Colle, le lieu-dit où nous sommes. Je fais glisser le doigt sur la route qui conduit à Névache, le village français où on nous attend dans l’après-midi si tout se passe bien. Douze kilomètres et environ sept heures de marche. Afin de protéger l’ami qui a fourni l’équipement et nous attend de l’autre côté, je lui ai fait croire que je passais le col avec une équipe de tournage qu’il fallait habiller pour l’occasion. C’est aussi ce que j’ai prévu de dire aux forces de l’ordre.
Je lève la tête, regarde autour, rassuré de ne voir personne à cette heure matinale. Je m’inquiète pour rien, il n’y a pas grand-chose à craindre de la police italienne. Les locaux de la Guardia di Finanza, la police aux frontières, sont à deux pas de la gare de Bardonnèche (Bardonecchia, en italien), sur la route qui mène au col. Les exilés passent là par centaines depuis la découverte de ce passage en 2016. En quatre ans, les arrestations et éloignements par le train ont été rares et toujours ordonnés par la hiérarchie en période de tension diplomatique entre la France et l’Italie. La police française, elle, se concentre sur le col de Montgenèvre, quelques kilomètres au sud. Il arrive qu’elle patrouille où nous marchons. Mais les passages en hiver sont plus rares ici, le col est fermé à la circulation et l’épais manteau de neige qui recouvre la départementale le rend plus dangereux. Plus d’un mètre cinquante ce matin, selon les informations que j’ai pu glaner.
Je peux être arrêté pour avoir facilité leur entrée sur le territoire et encourir jusqu’à 30 000 euros d’amende et cinq ans de prison.
Nous partons. Les Afghans ouvrent la marche, je veux pouvoir apprécier leur rythme. Nous n’avons pas fait 500 mètres que voilà la borne frontière. « Déjà ? » Mohmand est déçu. Il avait imaginé arriver en France au terme d’une longue et éprouvante marche. Je lui explique que rien n’est encore fait : les accords de Schengen permettent à la police française de nous interpeller jusqu’à vingt kilomètres à l’intérieur du pays sans avoir à le justifier. Ils peuvent être renvoyés en Italie. Je peux être arrêté pour avoir facilité leur entrée sur le territoire et encourir jusqu’à 30 000 euros d’amende et cinq ans de prison. Mohmand a confiance : « Si j’ai dû quitter mon pays, c’est parce que j’ai servi la France. Et toi, tu es mon capitaine. » Ils nous invitent à un selfie devant la borne, j’essaie de leur expliquer la date qui y figure, 1947. Cette année-là, le traité de Paris a contraint l’Italie à céder à la France ces territoires frontaliers. L’armée française devait pouvoir contrôler « les hauts » en cas de conflit. Si bien qu’ici la frontière n’est plus au sommet du col mais à sa base.
Leur rythme est plus enjoué depuis qu’ils savent qu’ils foulent la terre de France. Lorsqu’ils arrivent à la fourche qui conduit à gauche au col de l’Échelle et tout droit vers la vallée Étroite, leur instinct leur commande, comme aux autres clandestins avant eux, de marcher droit vers un cul-de-sac. S’il ne demande pas sa route, le voyageur peut se perdre dans le dernier hameau. Une bonne heure de marche pour rien, plusieurs au plus fort de l’hiver. Alors, les réserves en eau et en nourriture, quand il y en a, s’amenuisent, les vêtements se trempent, et les membres s’engourdissent, gèlent. Les morts découverts à la fonte des neiges, les mains, les pieds amputés, les passeurs servent à éviter cela.
Convoyeurs de sel ou d’humains
Les artisans-passeurs avaient presque disparu des frontières intérieures de l’Europe avec les accords de libre circulation entre États de l’espace Schengen en 1995. Ces contrebandiers convoyaient des moutons, du tabac, du sel, de l’alcool ou des humains, selon les époques. Leur connaissance de la montagne a permis aux migrants italiens, puis aux antifascistes, aux juifs d’Europe centrale, d’Allemagne et d’Autriche de trouver refuge en France. Contrairement à une idée répandue, les escroqueries ou les abandons dans la montagne étaient rares.
De nouveaux passeurs, souvent petits délinquants, ont commencé à convoyer des passagers en voiture dans des cols peu surveillés après la fermeture partielle de la frontière franco-italienne, en juin 2015, contre une centaine d’euros. D’autres malfrats basés à Turin se sont mis à monnayer aux plus crédules des informations sur l’itinéraire, sans jamais accompagner leurs clients : les gares de départ et d’arrivée, le numéro d’un bus, l’adresse d’un refuge solidaire où passer la nuit, les chemins.
Le début du parcours est simple : sortir de la gare de Bardonnèche, suivre la rue perpendiculaire aux voies de chemin de fer, longer les anciens bâtiments des Jeux olympiques d’hiver de 2006, les remontées mécaniques, le parcours de golf, puis prendre à gauche une centaine de mètres après la borne frontière. C’est après que ça se corse. La quasi-totalité des exilés arrivés en hiver n’a pas d’équipement adapté. En reportage en 2017 dans le col de l’Échelle, j’avais trouvé quatre mineurs, transis de froid. La gendarmerie les avait arrêtés pour les abandonner ensuite dans la montagne en pleine nuit.
La troisième tentative a été la bonne : Tofan et Mohmand ont marché treize jours, du pain et du ketchup pour seuls repas, guidés par leur smartphone à travers les montagnes et les forêts de Croatie et de Slovénie.
La route n’est plus damée. Ça grimpe. Nos raquettes s’enfoncent un peu plus. Le manteau blanc absorbe les bruits de la montagne, nous n’entendons que nos souffles et le grincement sourd de la neige que l’on écrase. La pente entre chaque lacet monte de plus en plus raide, la neige déborde du parapet, se forme en congères. Il faut les gravir à pas lents pour ne pas risquer le précipice. La veille, jour que j’avais initialement prévu pour notre randonnée, il neigeait à ne pas voir à un mètre : nous ne serions pas passés, ou au prix de trop grands risques.
Ce matin, c’est grand bleu. Mohmand s’en émerveille à chaque enjambée. « Oh, captain! It’s beautiful! » C’est sa promenade de santé. Il n’y a pas un mois, il a dû s’aliter deux semaines dans une cabane de fortune du camp-bidonville de Bihać, en Bosnie, après une bastonnade des garde-frontières croates ; la fois d’avant, ils avaient brisé son téléphone, volé ses vêtements, le laissant en slip. Pratiques quotidiennes à la frontière croate. Ordres d’un gouvernement qui tient à donner des gages de bon gardien de la frontière orientale de l’Europe pour espérer intégrer l’espace Schengen. La dissuasion par la violence est commune à la plupart des pays de l’Union européenne, France comprise.
La troisième tentative a été la bonne : Tofan et Mohmand ont marché treize jours, du pain et du ketchup pour seuls repas, guidés par leur smartphone à travers les montagnes et les forêts de Croatie et de Slovénie. Ils ont passé les rivières à gué, bu cette eau, s’y sont lavés, ont dormi dans des grottes alors que tombaient les premières neiges. Ils sont arrivés à Trieste les pieds en sang. Ils ont pansé leurs plaies dans une gare abandonnée avant que je les oriente vers Giuseppe à Turin. Depuis dix ans, Mohmand me donnait des nouvelles tous les deux, trois mois. J’ai vécu de loin la naissance de ses enfants, le décès de son père, les menaces de mort des taliban, ses projets de départ…
« Tout ça, c’est du passé »
Après avoir quitté son pays au printemps 2017, Mohmand me racontait l’avancée de son voyage. Il ne me disait pas tout. Lors de notre première pause, au soleil, au milieu d’un bosquet de pins aux branches alourdies par la neige, il s’épanche. Une nuit dans les montagnes entre l’Iran et la Turquie, il a entendu ses compagnons de route crier, tomber autour de lui sous les balles des garde-frontières. À Istanbul, pour financer la suite du voyage, il a été peintre en bâtiment, ouvrier dans une usine de vélos, manœuvre dans une casse automobile. Il a dû s’y prendre dix fois, vingt fois pour entrer en Grèce, par la mer puis par la terre. « Tout ça, c’est du passé », me dit-il la bouche pleine de fruits secs qu’il mâche avec délice.
En patrouille dans la vallée de Tizin, j’avais eu la liberté de me promener dans son village, Ganda Khasaray. On m’avait présenté à son doyen, le père de Mohmand. On le disait centenaire. Il portait une barbe blanche et fournie, un turban assorti, ses yeux humides brillaient comme souvent chez les personnes d’un grand âge. L’archétype du sage afghan. Tout ce que la France comptait de ministres, parlementaires, généraux venus soutenir la troupe en Afghanistan s’était fait prendre en photo à ses côtés. C’était le village modèle, conforme à la fable selon laquelle nous étions là-bas pour aider les Afghans à lutter contre l’obscurantisme et embrasser les promesses de la démocratie. Ses habitants, Mohmand le premier, y avaient cru et avaient collaboré.
Le voyage de Mohmand a duré deux ans et demi. Deux ans et demi pour savourer ce moment inconnu de la plupart d’entre nous : le sentiment de sécurité après des années d’angoisse.
Quand les troupes françaises sont parties en 2012, les menaces des taliban ont commencé. Des lettres, des appels anonymes d’abord. Puis des vidéos d’exécutions et des photos de têtes tranchées, testicules dans la bouche. Les demandes de visa accompagnées des preuves de son emploi comme personnel civil de recrutement local (PCRL) par l’armée française sont demeurées sans réponse. Exilé à Kaboul, Mohmand a fini par se résoudre à partir pour la France. Un an plus tard, en décembre 2018, le Conseil d’État a enjoint au ministère français de la Défense de délivrer un visa à un PCRL menacé. Et ouvert enfin la voie à beaucoup d’autres.
Le voyage de Mohmand a duré deux ans et demi, sans autre projet que d’atteindre la France. Depuis cette nuit de terreur à la frontière iranienne, il ne rêve plus, « ou alors, des cauchemars ». Ici, il a l’impression d’un autre monde. « Un paradis. » Il en a la chair de poule. Deux ans et demi pour savourer ce moment inconnu de la plupart d’entre nous : le sentiment de sécurité après des années d’angoisse. Je le préviens, rien n’est fait, la police française peut encore nous barrer la route. Il balaie mes inquiétudes. « Ta police ne tire pas à balles réelles ! » Il serait passé sans moi. Au prix souvent de plusieurs tentatives, ils passent toujours. Sauf ceux qui meurent. Pour la quasi-totalité des exilés, entrer en fraude est le seul moyen de demander l’asile.
Nous négocions des congères plus hautes. Après plus de quatre heures de marche, voici deux petits tunnels creusés dans la roche du col de l’Échelle. La police se poste souvent ici pour arrêter les voyageurs clandestins. Les guides bénévoles s’interdisent d’aller au-delà lors de leurs maraudes. Deux Guinéens étaient tombés dans le précipice après une course-poursuite avec les forces de l’ordre en août 2017 – ils ont survécu. Sous le premier tunnel, des stalactites de glace. Nos raquettes résonnent sur le bitume. Le second tunnel est à une dizaine de mètres, nous escaladons la neige qui nous dépasse en taille. Plus loin, c’est le plateau, une étendue parsemée de bosquets de pins à crochet. Au sommet, le col. Nous quittons l’ombre de la face nord.
Courage, rigueur, loyauté et droit d’asile
Sous le soleil à son zénith, la neige nous éblouit. Un paysage en nuances de vert et de blanc sous un bleu profond. Nous avons enlevé nos vestes, nos corps fument. La sueur mélangée à la crème solaire dégouline de nos fronts et pique nos yeux. Des traces de motoneige rendent la marche plus facile. Voilà la fameuse cabane du col de l’Échelle, propriété de la commune de Névache. Le maire a ordonné qu’elle demeure ouverte pour les « naufragés » de la montagne. Des maraudeurs la ravitaillent en bois de chauffage et en vivres. Ils maintiennent un stock de couvertures, de chaussures et de vêtements chauds. À la fenêtre, un écriteau en quatre langues : « Prends ce dont tu as besoin, laisse ce que tu peux. »
Mohmand m’aide à sortir un banc en bois pour pique-niquer au soleil devant la cabane. Notre aventure prend des airs de vacances. « Merci, “my captain”. Je suis heureux d’être enfin arrivé. » Il ne me demande pas pourquoi j’ai fait ça, je présume que c’est une évidence pour lui. Il a été éduqué selon le code d’honneur des Pachtounes, le pachtounwali. Des principes de courage, de rigueur, de loyauté, mais aussi de droit d’asile. En Afghanistan, j’avais été frappé par l’admiration des officiers de la Légion envers les Pachtounes et leurs lois. Dans le village de Mohmand, nous posions sans crainte nos armes contre le mur en pisé de la maison du chef. Le pachtounwali nous protégeait.
* Les prénoms ont été changés.