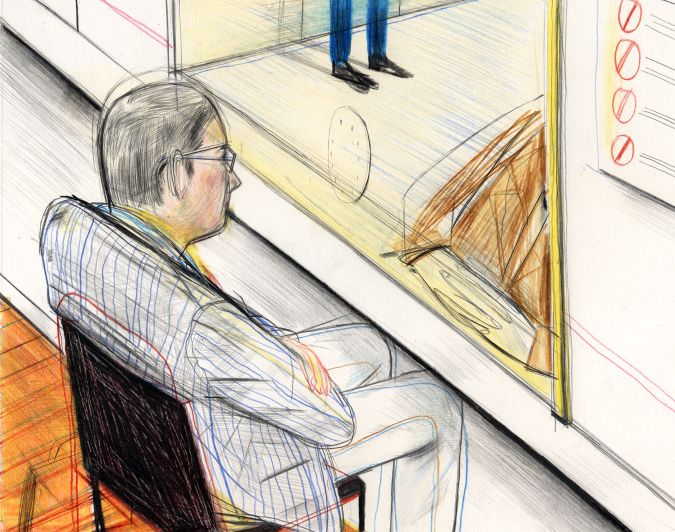Jean-Baptiste Fressoz nous installe à la table à manger familiale. Elle est en céramique, ce qui est « terrible » en matière de CO2, déplorera plus tard l’historien des sciences, puisque sa fabrication requiert de chauffer la matière à 1 000 degrés. Mais pour l’heure, le salon est jonché de jouets. Il faut enlever ses chaussures et faire attention où on met les pieds. Il y a des voitures, des soldats, des méchants, de quoi lever une armée. Jean-Baptiste Fressoz sert le café, étonnamment tranquille pour quelqu’un qui vient de déclarer la guerre… à un mot. Celui qui circule sur toutes les lèvres depuis qu’il est acquis que la planète brûle. Son dernier livre, publié au Seuil, consacre 333 pages et 778 notes à la démolition de ce seul et unique terme. Le titre est clair : Sans transition.
Pour le chercheur au CNRS, professeur à l’EHESS et à l’École des Ponts, jamais l’histoire n’a connu de « transition » énergétique. Et il est peu probable qu’elle en connaisse une dans les prochaines décennies. La transition ne serait pas un fait observable mais un discours, un imaginaire, une idéologie même, qui colporte une vision erronée du monde et qui permettrait aux promoteurs des énergies fossiles de poursuivre leur business.
Le coup a porté. Selon les chiffres des éditions du Seuil, le livre s’est vendu à 13 000 exemplaires en moins de deux mois, un plébiscite rare pour le fruit d’une habilitation à diriger les recherches. La parole de l’historien va même plus loin. À la suite de son intervention, l’exposition permanente de la Cité des sciences et de l’industrie, à Paris, a changé de nom : Transition énergétique s’appelle finalement Urgence climatique. Un colloque de l’Académie des sciences a suivi le mouvement. L’historien a exposé ses travaux devant les 400 experts de la Direction générale de l’énergie et du climat, au Commissariat à l’énergie atomique et à l’Académie des sciences. Dans Le Monde, une tribune signée par des chercheurs l’accuse de « défaitisme ». Ce n’est pas la bataille d’Hernani, tempère-t-il. Mais le doute a été instillé.

Chacun se souvient des frises chronologiques de la révolution industrielle dans les manuels scolaires. En quoi nous induisent-elles en erreur ?
L’histoire des énergies est présentée comme une compétition dans laquelle celles-ci se font la guerre et se remplacent au rythme des inventions : au XIXe siècle, le charbon aurait rendu obsolète le bois, avant de laisser sa place au pétrole qui, à son tour, serait en train d’être remplacé par les énergies renouvelables. Sauf que ces transitions n’ont jamais eu lieu. Le charbon n’est pas du tout une énergie du XIXe siècle, il a même connu la plus forte croissance de son histoire entre 1980 et 2010. Résultat, après deux siècles de prétendues transitions énergétiques, l’humanité n’a jamais brûlé autant de pétrole, de gaz, de charbon et de bois.
Vous consacrez justement une partie de votre livre au bois. Ce n’est donc pas un personnage secondaire de l’histoire de l’énergie ?
C’est ce que l’on croit, mais c’est faux. Savez-vous qu’il représente, de nos jours, deux fois plus que le nucléaire en énergie finale [l’énergie délivrée au consommateur, ndlr] ? Le charbon de bois peut paraître ringard, pourtant il est une source d’énergie très importante pour des centaines de millions de personnes dans le monde. Le bois s’est aussi modernisé avec l’explosion du contre-plaqué, des panneaux de particules et surtout des cartons d’emballage. La papeterie est le quatrième consommateur industriel d’énergie – après la sidérurgie, les cimenteries et l’industrie chimique. Il faut aussi garder à l’esprit que le bois dépend entièrement du pétrole, depuis les tronçonneuses qui le découpent jusqu’aux camions qui le transportent. Même le sol sur lequel il pousse est arrosé d’engrais produits à partir de gaz naturel. En ce sens, le bois est en partie une énergie fossile.
L’exemple du bois illustre, selon vous, ces multiples intrications entre les énergies.
Les énergies ne sont pas des entités isolées, elles forment un imbroglio très complexe et entrent en symbiose les unes avec les autres. Par exemple, l’Angleterre de 1900 utilisait beaucoup de bois pour étayer ses mines de charbon, elle en utilisait alors davantage qu’au XVIIIe siècle.
Autre exemple, on parle de l’arrivée du pétrole comme d’une transition énergétique. Or, dans les années 1930, Ford ou Renault ont besoin de 7 tonnes de charbon pour fabriquer une voiture, c’est-à-dire plus que la totalité du pétrole qu’elle consommera durant toute sa vie. Encore aujourd’hui, en Chine, produire une voiture requiert environ 2,5 tonnes de charbon. Quant aux véhicules électriques, la moitié roule en Chine – qui tire 60 % de son électricité du charbon. Pour le moment la voiture électrique a surtout opéré une petite transition du pétrole vers… le charbon. Ce qui d’ailleurs n’empêche pas que, même en Chine, une voiture électrique reste plus indiquée pour le climat qu’une voiture thermique. En revanche, il faut se garder de la présenter comme une solution. C’est seulement un moindre mal.
Pour en revenir à votre thèse, l’Europe a considérablement réduit sa consommation de charbon au siècle dernier. Ne peut-on pas dire qu’il y a eu des transitions partielles, par région ?
On peut effectivement parler de transition technologique, ou de transition partielle et régionalisée, je ne suis pas borné. Néanmoins, j’ajouterai deux choses. Premièrement, s’il est vrai que l’Europe consomme de moins en moins de charbon, la décrue remonte aux années 1960… et on en est encore à 300 millions de tonnes par an en 2023. Deuxièmement, la France ne consomme certes presque plus de charbon pour produire de l’électricité ; en revanche, elle importe massivement des produits fabriqués grâce à ce combustible. Certains travaux évaluent ces importations autour de 800 kg par an et par habitant.
Nous ne sommes pas une île. Dans un monde qui tourne au fossile, dire qu’un pays en serait sorti est très imprudent. L’exemple parfait est la Suisse. Ils sont très forts, les Suisses : hyper-riches et peu émetteurs de CO2 ; ils n’extraient plus de charbon depuis 1945. C’est sans compter Glencore, une entreprise helvète, leader mondial de l’extraction minière en général et du charbon en particulier, qui œuvre… à l’étranger. Trafigura, autre entreprise de ce pays, concentrerait entre ses mains 40 % du commerce international du charbon. Selon l’ONG suisse Public Eye, près d’un milliard de tonnes de charbon profiterait ainsi indirectement à l’économie suisse.

Pascal, dit « Johnny » (car il est fan du chanteur), tient une station-service près de Saulieu. Il s’en sort en livrant également du fioul.
Mais si la transition énergétique n’a jamais eu lieu, comment s’est-elle retrouvée dans tous les discours ?
La majorité des spécialistes de l’énergie ne raisonnaient pas en ces termes jusque dans les années 1970. La notion de transition est venue de savants atomistes qui ont anticipé l’épuisement des énergies fossiles et imaginé une transition inévitable sur plusieurs siècles vers l’atome. Une vraie transition pour le coup. L’inventeur de l’expression, le physicien Harrison Brown, est un ancien du projet de recherche américain sur la bombe atomique, le projet Manhattan. Il a recyclé un terme de physique nucléaire, la « transition énergétique », désignant au départ le changement d’état d’un électron, pour parler du futur de l’énergie.
Au milieu des années 1970, à la faveur du choc pétrolier, tout le monde s’est emparé de cette expression. Et, comme la question du changement climatique a émergé durant la même décennie, la transition énergétique est passée d’une crise à l’autre, du choc pétrolier à l’urgence climatique, mais les deux problèmes n’avaient rien à voir. L’imaginaire de la transition s’est ancré dans la question de l’épuisement des fossiles alors que le défi climatique est une tragédie de l’abondance : il faut arrêter les fossiles au moment où ils ne sont ni rares ni chers.
De là, l’imaginaire de la « transition » a pu s’imposer dans les esprits ?
Tout à fait. Au tournant des années 1970-1980, les climatologues qui ont fait émerger la question du changement climatique aux États-Unis ont expliqué qu’il ne fallait pas trop s’inquiéter, puisque des transitions énergétiques avaient déjà eu lieu. Roger Revelle, un scientifique qui avait écrit en 1957 un article clé sur l’effet de serre, a été entendu par le Sénat américain en 1979. Il a désamorcé sa propre alerte, en disant que ce n’était pas grave, car une transition énergétique prenait cinquante ans [soit le temps que les températures mettraient pour vraiment augmenter, ndlr]. En réalité, on ne sait absolument pas combien de temps une transition prend puisqu’il n’y en a encore jamais eu. C’était d’une légèreté scientifique et intellectuelle incroyable !
Je pense aussi à l’économiste William Nordhaus, qui a eu une grande influence sur les débuts du GIEC [le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, ndlr]. Il a obtenu le prix Nobel d’économie en 2008 pour ses travaux sur le rôle de l’innovation face au réchauffement climatique. En 1973, après le choc pétrolier, il a expliqué qu’il ne fallait pas se restreindre, car d’ici l’an 2000 le surgénérateur nucléaire comblerait nos besoins. En 1975, il a repris le même argument pour le réchauffement. Dès ses débuts, la discussion climatique a été accaparée par la figure de la nouvelle technologie salvatrice qui assurerait une « transition douce » – c’est l’expression employée – pour sortir des fossiles.
Le défi climatique est une tragédie de l’abondance : il faut arrêter les fossiles alors qu’ils ne sont ni rares ni chers.
Vous mentionnez le GIEC, que l’on voit aujourd’hui comme le champion du climat. Il n’a donc pas été étranger à la promotion de cet imaginaire de la transition ?
En effet. En 1985, le Programme des Nations unies pour l’environnement a donné son verdict : il ne fallait plus attendre, il fallait réduire les émissions de 25 % d’ici l’an 2000 et créer une taxe mondiale sur le CO2. Or, les Américains, premiers émetteurs mondiaux, n’étaient pas de cet avis. C’est dans ce contexte que les administrations Reagan et Thatcher ont décidé de créer le GIEC. Et, dans GIEC, c’est le « i » qui est important : il ne signifie pas « international » mais « intergouvernemental ». L’idée derrière ce choix, c’est qu’il ne fallait pas laisser des bureaucrates de l’ONU et quelques climatologues excités, proches des environnementalistes, dicter les termes du débat. Pour les fondateurs du GIEC, la transition, si elle était nécessaire, devait être décidée par les gouvernements, et ne pas brusquer les intérêts économiques. C’est là qu’est intervenu le groupe III du GIEC, consacré aux « solutions », dont les deux premiers dirigeants étaient ouvertement climatosceptiques. Robert Reinstein était même le négociateur américain au Sommet de la Terre à Rio, en 1992, ce qui a posé un sérieux problème de conflit d’intérêt.
C’est lors de ce sommet que George Bush père a eu ce mot sans appel : « Le mode de vie américain n’est pas négociable. »
Au moins, ça a le mérite d’être clair. Les États-Unis déclaraient ne vouloir ni dépenser d’argent ni s’engager sur des réductions d’émissions de CO2. Pour Rio, le directeur de cabinet de George Bush a transmis cette consigne à son négociateur, Reinstein, qui discutait beaucoup avec Nordhaus : « Jouez la carte de la technologie. » Autrement dit, faites le pari de l’innovation.
Cette carte de la technologie est-elle encore à l’œuvre aujourd’hui ?
Elle joue à fond. Le débat climatique est rempli de promesses technologiques. Prenez l’avion à hydrogène, qu’Airbus présente comme la mobilité décarbonée du futur. Les spécialistes savent qu’il faut maintenir l’hydrogène à –253 °C, dans un réservoir trois fois plus volumineux que celui d’un avion conventionnel, ce qui rend inconcevable sa généralisation.
L’autre technologie qui suscite des espoirs, c’est le nucléaire, dont vous parlez pourtant moins.
Le nucléaire est à la source de l’imaginaire de la transition. Il est aussi à la source de la science du réchauffement. Mais il est cher, complexe, lent à déployer et difficilement globalisable. Il nourrit beaucoup de fantasmes. C’est une solution très occidentalocentrée.

Que pensez-vous des technologies qui permettent de capturer le carbone pour l’enfouir sous terre ?
Ce qui me laisse pantois, c’est de voir combien le groupe III du GIEC donne du crédit à cette solution, mise en avant par les entreprises fossiles. Dans le dernier scénario en date, on aurait besoin, d’ici à 2100, de stocker entre 170 et 900 gigatonnes de CO2 sous le sol grâce aux bioénergies avec captage et stockage de dioxyde de carbone (les BECCS). Ce procédé consiste à brûler du bois [ou d’autres matières organiques, ndlr] dans une centrale pour générer de l’électricité tout en enfouissant sous le sol le carbone émis. Cette technologie ne se développe pas car elle n’est pas du tout rentable. Et, surtout, elle nécessiterait des surfaces phénoménales de plantations forestières. Dans le rapport de 2015 du GIEC, certains scénarios imaginent qu’il faudrait deux fois la superficie de l’Inde en plantations d’eucalyptus. C’est invraisemblable.
Vous donnez l’impression de vouloir désacraliser les inventeurs. D’où vous vient cette idée que les nouvelles technologies ont une influence marginale sur le monde matériel ?
Mon parcours a débuté dans un univers intellectuel très marqué par la figure du philosophe et sociologue Bruno Latour. Si j’ai fait de l’histoire des sciences, c’est en partie grâce à lui. Sa manière de faire de la recherche était très novatrice. Le problème de Latour est que l’on croit qu’il s’agit d’un penseur des techniques, alors qu’il est en fait un penseur de l’innovation. Dans son livre sur Pasteur, il décrit le scientifique comme un démiurge capable de transformer la société depuis son laboratoire. Sa démarche, que j’ai pu observer quand je travaillais avec lui à la direction scientifique de Sciences Po, témoigne d’une obsession pour l’innovation – institutionnelle ou cosmologique –, les nouveaux mots, les nouveaux imaginaires, les nouvelles techniques. Ne faut-il pas réfléchir exactement à l’inverse, réfléchir au fait que le monde ne change pas ?
Le fait que le monde ne change pas ? C’est-à-dire ?
En 2011, j’ai découvert le travail de l’historien anglais David Edgerton. Dans son livre The Shock of the Old [publié en 2006, ndlr], il montre que l’historiographie préfère raconter une époque par sa nouveauté, s’intéresser au dernier gadget plutôt qu’aux techniques en usage, celles qui font vraiment tourner le monde. L’histoire de la Seconde Guerre mondiale parle, par exemple, des divisions de blindés mais oublie qu’il y avait plus de chevaux dans l’armée allemande en 1942 qu’avec les troupes de Napoléon en 1815. Edgerton proposait une histoire vraiment nouvelle, c’était hyper-radical et très rafraîchissant. J’ai réalisé que personne n’en avait encore tiré les conclusions, pourtant évidentes, sur la question environnementale.
Il y a quelque chose d’un peu désespérant dans votre livre. Cela vous a d’ailleurs été reproché. Votre thèse ne présente-t-elle pas le risque de décourager les gens ?
Si le risque, c’est de décourager des gens qui pensent que les panneaux solaires et les éoliennes vont résoudre tous les problèmes, je pense que ça vaut le coup. C’est sûr que, grâce aux renouvelables, l’intensité carbone de l’économie [le rapport entre le PIB et la quantité de gaz à effet de serre émis, ndlr] peut diminuer. Il est possible que les pays riches réussissent à sortir la mobilité individuelle du pétrole, avec des voitures et des camions électriques. Mais il restera le transport maritime, la sidérurgie, le ciment, les routes, le plastique, l’aviation, l’agriculture…
Dès qu’il y a un bien matériel, il y a du CO2. Dans le salon où nous nous trouvons, est-ce qu’il y a un seul bien matériel qui n’ait pas émis du CO2 pour sa fabrication ou son transport ? Je ne décourage pas les gens, j’essaie au contraire de les secouer un peu ! Ce qu’il faut, c’est du discernement technologique. Il existe des technologies matures, susceptibles d’avoir un impact avant 2050, comme les panneaux solaires qui réduisent le facteur de charge des centrales électriques. Beaucoup d’autres auront très peu d’incidence dans les prochaines décennies, comme le captage et stockage de CO2, et tout ce qui tourne autour de l’hydrogène.
La solution qui réduit drastiquement les émissions de CO2 du transport aérien ? Ne pas prendre l’avion.
Il y a quand même de quoi se sentir impuissant.
Mais je pense qu’on est impuissants (rires). Il faut être un peu modeste. Est-il sain que les gens aient un sentiment de puissance face au défi climatique ? Est-il normal de croire qu’on peut changer entièrement les fondements du monde matériel en trente ans ? Peut-être faudrait-il un peu atterrir, non ?
À quoi ressemblerait-il, cet atterrissage ?
Quelle est la solution la plus économe et qui réduit drastiquement les émissions de CO2 du transport aérien ? C’est simple : ne pas prendre l’avion. Et ça vaut pour tout. La meilleure solution est de ne pas consommer. On pourrait imaginer un moratoire sur la construction de nouvelles routes, de nouveaux bâtiments, surtout dans les pays riches où il y en a déjà beaucoup. On pourrait limiter drastiquement la taille des voitures. On pourrait aussi déterminer, à l’échelle globale, les endroits où les activités émettant du CO2 contribuent le plus à augmenter le bien-être. Cela reviendrait à décroître dans les pays riches, pour laisser de la place aux autres dans l’atmosphère.
La route ou le BTP, ça ne peut pas se décarboner ?
Quelqu’un va vous dire qu’il a la technique. Très bien, mais est-ce qu’il peut la généraliser là, maintenant ? Il est difficile de se passer des voitures, vu la disposition des villes. Donc ne construisons plus que des petites voitures électriques qui n’avancent qu’à 40 à l’heure. Cela ralentirait tout le monde sans interdire de se déplacer. L’industrie automobile décroîtrait, exigerait moins de matière. Il serait aussi plus rapide d’électrifier l’ensemble du parc automobile, car il y aurait besoin de moins de batteries.
De mémoire d’historien, est-ce qu’une société a déjà décidé par elle-même de décroître ?
Non, jamais. C’est la modestie de l’histoire, on n’a aucun modèle auquel se référer pour une décroissance volontaire et concertée. Le problème, c’est que la transition nous a empêchés de parler de décroissance pendant cinquante ans. C’est un angle mort du débat, un sujet d’hurluberlus. Il faudrait faire des modélisations, des scénarios. Dans son dernier rapport, le groupe III du GIEC le dit noir sur blanc : aucun scénario de décroissance ne leur a été fourni. Qu’est-ce que les économistes attendent ?