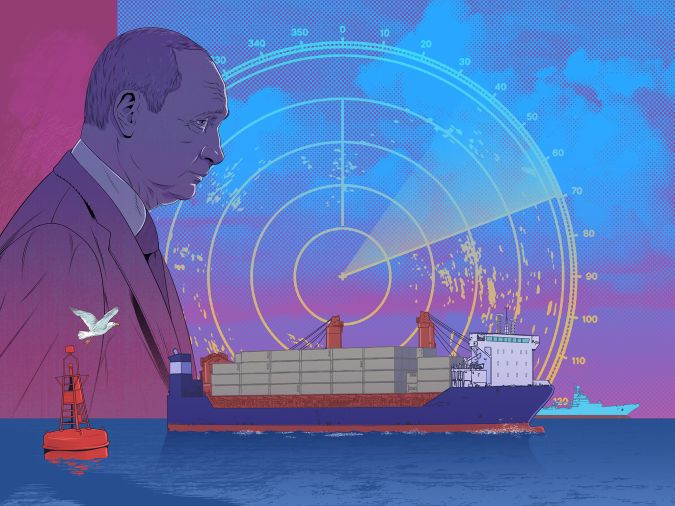Ce soir-là, j’enfile un costume et les chaussures qui vont avec. Mes responsables ont reçu une consigne de la part d’un client prestigieux : l’agent de sécurité doit bien présenter. La mission est au fin fond de la banlieue parisienne. En arrivant sur place, je regarde autour de moi : un château et des champs. Je suis au milieu de nulle part, tout seul, dans le froid et le noir. Le sol est boueux. Mais pourquoi ont-ils imposé une tenue correcte ? C’est quoi, ce bourbier ? J’ai la vingtaine à l’époque : à cet âge-là, on découvre les mauvaises surprises – le décalage entre la mission sur papier et la réalité du terrain. Dans ce vaste domaine – un ancien corps de ferme en Seine-et-Marne –, une grande marque a entreposé des vêtements de luxe, sous des tentes chauffées. Le lieu a été privatisé plusieurs jours pour des shootings. Je dois le surveiller jusqu’au petit matin.
À mon arrivée, je comprends vite que la nuit va être longue. Il n’y a aucune pièce, ni aucun local à ma disposition. Je dois rester à l’extérieur. Des questions de dignité se posent au premier coup d’œil : comment je fais pour aller aux toilettes ? Les températures sont glaciales. Je marche et tourne en rond toute la nuit. À part des bruits de vaches, c’est le silence. Et quand j’ai vraiment froid, je me réfugie dans ma voiture. Je démarre pour allumer le chauffage. Des vêtements ont le droit d’être à l’abri, mais pas l’être humain qui les surveille. Ça fait cogiter, non ?
Beaucoup s’imaginent que les agents de sécurité ne souffrent que physiquement. Les maux de dos, de mains et de doigts – en cas d’altercation. Mais c’est surtout le mental qu’il faut gérer, quand les minutes ont l’air de s’allonger. Quand tu débarques dans un endroit, que tu sens la galère et qu’il te reste dix heures à tirer. Pour tuer le temps, des collègues se sont mis à fumer, si ce n’est plus. Une cigarette te fait gagner cinq minutes. Ça n’a l’air de rien, comme ça, « cinq minutes ». Mais tu peux littéralement péter les plombs si ton collègue qui prend la relève a « cinq minutes » de retard après une nuit compliquée.
Baraqué, ponctuel et curieux
Moi, j’ai une chance : j’aime lire. C’est ce qui m’a sauvé de la clope, j’en suis persuadé. C’est ce qui m’a permis de tenir dans des bourbiers où tu ne captes pas – sans téléphone et sans wi-fi, certains peuvent devenir fous ! Dans ma boîte à gants, j’ai toujours deux ou trois bouquins. Des romans. Voyage au bout de la nuit de Céline, Le Nom de la rose d’Umberto Eco… Au château, ce soir-là, j’ai lu et gambergé en écoutant les vaches. Au petit matin, j’ai dit à mes responsables que je ne reviendrais pas la nuit d’après. Je pouvais me le permettre. La « sécu » est un petit monde, dans lequel j’ai toujours eu une bonne image. Donc du boulot assuré.
J’ai 34 ans. La moitié de ma vie, je l’ai passée dans ce milieu. Je suis devenu agent de sécurité alors que j’étais encore au lycée. À Bobigny, où j’ai grandi, j’avais ma réputation de gars costaud et solide. [Rires.] Des anciens de chez moi avaient monté leur société et cherchaient des gens fiables. Mon prénom leur a été soufflé. Au départ, ils avaient des contrats avec la ville pour encadrer des événements. Des fêtes de quartier, du cinéma en plein air, des petits concerts. Ils m’ont proposé de bosser un peu, surtout les étés. J’étais encore en cours, et c’était un bon plan : quand d’autres prenaient des chemins illicites pour se faire des sous, moi j’en gagnais proprement. Certains de ces anciens qui me faisaient bosser étaient allés à l’école avec ma mère, ce qui a rassuré mes parents.

Je suis resté dix ans dans cette boîte. Nous étions spécialisés dans l’événementiel. Rapidement, on m’a confié des missions plus importantes et plus huppées dans toute la région. Des concerts, des soirées privées, des événements sportifs. J’étais baraqué, ponctuel et curieux, je m’intéressais à la façon dont l’entreprise tournait. Et j’ai commencé à rencontrer du beau monde. Des artistes, des acteurs, des athlètes. Des clients riches pour qui tu es invisible ; des pointures du cinéma qui viennent te voir personnellement pour savoir si tu ne manques de rien ; des « noms » qui te méprisent à moitié et finissent par te regarder avec des cœurs dans les yeux quand ça dégénère.
Pendant cinq ou six ans, j’ai énormément travaillé la nuit. Des bourbiers, mais pas que. Il y a eu des fous rires avec des collègues de 50 ans, des discussions profondes sur la vie, des plans tranquilles aussi. Pendant des mois, j’ai gardé un bâtiment administratif en Seine-Saint-Denis. J’arrivais en début de soirée. Un petit local avait été mis à ma disposition. J’allumais de l’encens, posais un bouquin sur la table, enclenchais une série sur mon téléphone. Et mettais de la musique classique. Ça adoucissait l’obscurité, qui peut te rendre fou, irascible. Ce petit confort favorisait ma concentration. À force, j’étais devenu un repère pour les employés qui finissaient tard. « Souleiman, ton encens est un signal pour nous, ça veut dire qu’il faut vraiment partir. »
Certains sont étonnés de voir un vigile au gros gabarit, typé maghrébin, bien s’exprimer. « Merde, il écrit des SMS sans faire de fautes d’orthographe ! »
Pour être honnête, c’est la liberté d’organiser mon emploi du temps qui m’a poussé à continuer dans la « sécu » après le lycée. Cette liberté m’a permis de passer une licence d’arabe et de faire de la plongée – ma passion. Mon bagage scolaire brouille les pistes aujourd’hui. Certains clients sont étonnés de voir un vigile au gros gabarit, typé maghrébin, bien s’exprimer. « Merde, il écrit des SMS sans faire de fautes d’orthographe ! » Ça m’a permis aussi de filer du jour au lendemain si j’en avais envie. Je pouvais enchaîner les heures du lundi au dimanche – j’acceptais en plus des missions de gardiennage – et dire : « Voilà, j’ai fait 200 ou 300 heures ce mois-ci, je suis indisponible trois semaines, je pars quelque part ».
Ça me rappelle une virée avec mon père. On a pris la voiture et on est allés tous les deux en Suède, où nous avons de la famille. En duo. En Algérie, il avait suivi des études de médecine. En arrivant en France, il fallait passer des équivalences. C’était décourageant. Il était devenu électricien et bossait sur les chantiers. Avant de retourner à la fac. Tout ça pour dire qu’à la maison, nous avons, mes deux sœurs et moi, été éduqués avec des livres – toutes les deux ont d’ailleurs fait de longues études.
Quand j’ai débuté, « la sécurité » n’avait pas la même connotation péjorative qu’aujourd’hui, avec toutes les dérives médiatisées sur les contrats au noir, les mecs violents ou les vigiles endormis sur leur chaise. C’était un métier plus respecté – enfin, je crois. L’époque était différente : nos interventions n’étaient pas filmées. Cet aspect a d’ailleurs profondément transformé le job : tu sais désormais que tu peux finir sur Instagram en trois secondes.
La bouche reste la meilleure arme
Bien sûr que des gars franchissent les limites ! Mais le public n’a aucune idée des coulisses et de la pression pesant sur les gens réglos. Ta dignité profonde peut être malmenée des dizaines et des dizaines de fois au cours d’une soirée – ce que les vidéos ne montrent pas. On t’insulte, ta famille et toi, pendant un quart d’heure d’affilée, on te jette une clope à la figure, on te menace… Au début de la pandémie, quand la parano était à son paroxysme, je me souviens d’un collègue qui s’est fait cracher dessus par une fille. « Tiens, j’ai le Covid ! » Qu’est-ce que tu fais dans ces cas-là ? L’agent de sécurité marche constamment sur un fil : s’il craque, il perd sa carte professionnelle et bousille sa carrière. Mais la fille qui crache, que risque-t-elle ?
Des gens sortent parfois de soirée heureux et euphoriques. Sans savoir que les videurs se sont bagarrés à l’entrée avec des dingues venus pour tout casser. En oubliant qu’une embrouille futile peut dégénérer en un claquement de doigts en fusillade. Et là encore, la « sécu » se retrouve en première ligne. En dix-huit ans de carrière, j’ai retenu une leçon : la bouche reste la meilleure arme. Il m’est arrivé de me répéter pendant quarante-cinq minutes avec un type alcoolisé. C’est lourd, très lourd, mais ça fait partie du job. Et ça permet d’éviter un scénario de violence dont tu ne connais pas la fin. Tu as tout intérêt à ne pas dépasser les limites dans tes interventions. Car tu peux recroiser « ta victime » dans la rue. Et là, tu es tout seul, tu n’as plus ton équipe. Si tu as déconné, je suis certain que tu récolteras ce que tu as semé.
« Tu as gagné, je suis une merde »
Un jour, j’assurais la « sécu » d’une soirée avec un collègue albanais. Je n’avais pas encore roulé ma bosse. Un type charismatique, balafré sur le visage, taiseux, qui pulvériserait n’importe qui. Il avait connu la guerre en Yougoslavie. Là, un gars qui voulait entrer le provoque vraiment. L’Albanais ouvre alors la bouche : « Tu as gagné, je suis une merde, et c’est toi le champion, tu as raison. » Le type en face se fige. Il ne s’attendait pas à ça. La tension était redescendue. Et c’était fini. J’en ai fait une philosophie. De plus en plus, je réponds par le sourire aux insultes et aux regards de travers. À 20 ans, j’aurais foncé tête baissée. Là, je m’amuse à désarçonner les plus irrespectueux. Ils ne comprennent pas. « Il sourit, c’est étrange, ça doit cacher quelque chose. » Parfois ils s’excusent. Ce n’était que du théâtre.
Au fil des années, ton regard s’aiguise, ton instinct aussi. De loin, je peux quasiment deviner à qui j’ai affaire. À la démarche, aux mimiques, à la manière de s’approcher, je peux dresser un portrait-robot. Ça me donne un temps d’avance. J’ai appris que la malice humaine n’avait aucune limite : pour entrer dans une soirée, des femmes et des hommes sont capables de tous les mensonges, comme si leur vie en dépendait. Dans l’événementiel, on jongle entre les postures à une vitesse folle. Un coup, tu souris, et quelques secondes plus tard, ton visage se ferme. Ainsi de suite.
Il ne suffit pas d’avoir des costauds sous la main. Il faut aussi des diplomates, qui savent désamorcer un malentendu à la racine.
Il y a quatre ans, j’ai lancé ma propre boîte – une dizaine d’employés réguliers. Toujours dans l’événementiel. J’ai acquis assez d’expérience, y compris dans l’encadrement. Et puis, j’ai un carnet d’adresses. En tant que patron, j’ai découvert la paperasse et expérimenté les coulisses : des clients proposent des tarifs tellement bas que tu te retrouves dans l’impossibilité de payer dignement tes employés. À moins de faire du noir, de ruser et de faire appel à de pauvres gens, qui parlent à peine le français… Je me refuse à ça. C’est mathématique : moins tu paies, moins le service est de qualité – sur le long terme, la compétence coûte moins cher que l’incompétence. Au début de ma carrière, je me suis fixé un barème : jamais de mission en dessous de 10 euros nets de l’heure.
De plus en plus, des gens postulent avec la conviction que c’est une planque. Des sous, sans rien faire. J’ai vu des types chargés de la sécurité d’un site débarquer en tongs et short de cycliste, avec une demi-heure de retard. Comme si c’était normal. J’ai arrêté de bosser avec un gars qui n’avait qu’une seule mission : empêcher des voitures de se garer dans un coin de parking. Ce qu’il n’a pas fait. Pour se justifier, il m’a sorti cette phrase légendaire : « Les gens ne voulaient pas m’écouter, je ne vais pas me casser la tête avec eux. » Alors pourquoi perçois-tu un salaire, mon ami ? [Silence.]
La gestion humaine est la chose la plus compliquée. Tu dois tout prendre en compte. Celui qui traverse une mauvaise passe dans sa vie, tu ne le postes pas n’importe où : c’est une grenade dégoupillée. Ça, tu dois le sentir et l’anticiper. Sur certains événements, tu dois constituer une équipe de gars complémentaires. Certains pensent à tort qu’il suffit d’avoir des costauds sous la main. C’est faux. Tu as besoin de gros bras impossibles à impressionner, mais aussi de diplomates, détendus et compréhensifs, qui savent désamorcer un malentendu à la racine.
Un LinkedIn de la rue
De mon côté, je continue d’être sur le terrain. Je supervise mes gars sur des événements importants – ils représentent l’image de ma société. Et je travaille à titre personnel avec des boîtes de production, quand elles partent tourner dans des endroits compliqués. Je me suis retrouvé il y a quelques mois en Colombie pour des repérages – une série en cours. En France, j’ai aussi accompagné des équipes de tournage dans des quartiers difficiles. Parce que j’ai mon répertoire. Dans la « sécu », j’ai croisé des gars de toutes les cités et de tous les départements – je me suis fabriqué une sorte de LinkedIn de la rue. [Rires.] Alors, la société de production m’envoie négocier avec « les grosses têtes ». Il y a un principe de réalité : sans eux, impossible d’avoir des garanties totales de sécurité si des caméras s’installent.
Je prends du plaisir à les écouter me raconter la géopolitique du lieu, les embrouilles, les rivalités, les légendes, les événements marquants – c’est comme si j’assistais à un cours d’histoire en plein air. Depuis l’hiver, je passe aussi des diplômes pour porter une arme et ajouter une ligne à mon CV : la protection rapprochée. Ce sont des missions très bien payées, qui te permettent de progresser. Pourquoi pas ? Je perfectionne mon anglais. Qui sait ? L’étranger me tente – ce serait une étape supplémentaire.
Dernièrement, je me suis fait la remarque : je ne m’énerve quasiment plus. À force de me frotter à toutes les gammes d’humains, je suis devenu un monstre de patience. Avec ma famille, mes enfants, j’ai un recul incroyable sur les choses. [Silence.] Tu vois, tu as toujours des excités qui te font un doigt sur la route et te sortent la pire insulte possible… Ça ne me fait plus aucun effet, comme si mon égo était une porte blindée. Je n’ai pas cinq minutes à perdre pour une embrouille avec un inconnu. J’en ai fait l’expérience : c’est beaucoup, cinq minutes.