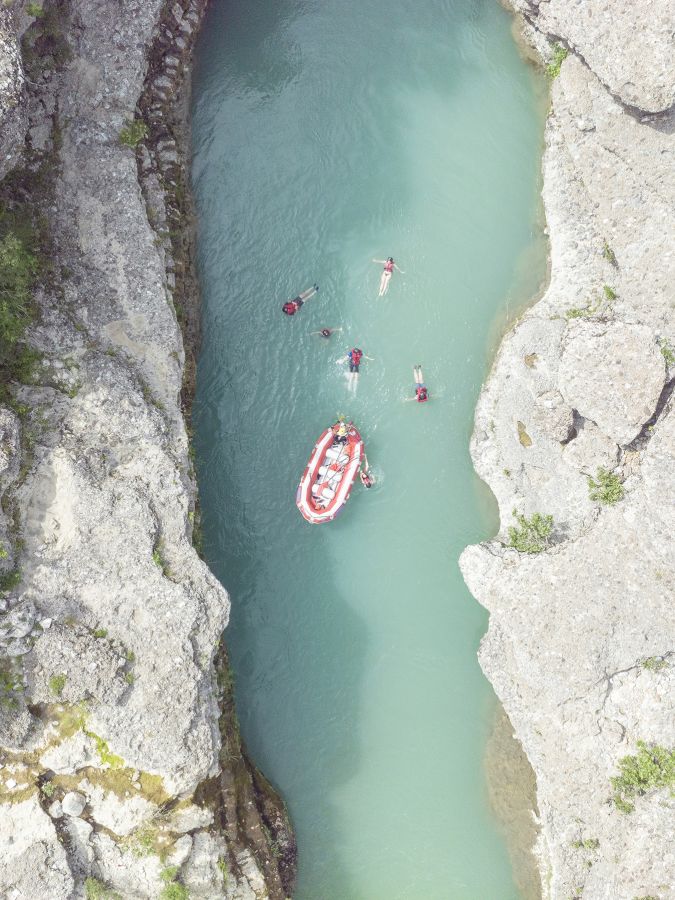En hausse ces dernières années, l’hydroélectricité représente 11 % de la production française d’électricité, la plaçant en seconde position, après le nucléaire. Peut-on parler d’un renouveau ?
On a tendance à surévaluer ce renouveau. Il s’agit plutôt d’un regain d’intérêt assez médiatisé, qui remonte à la loi sur la transition énergétique de 2015, favorisant l’investissement dans les énergies renouvelables, notamment avec des incitations financières. Mais, depuis 2010, moins d’une cinquantaine d’unités de production, des petites centrales, ont été créées. Ce renouveau est forcément modeste, car 90 % du potentiel en France est déjà exploité. Les prévisions du gouvernement indiquent par ailleurs que 60 % des gains de production seront dus à la rénovation d’installations existantes, le reste à des installations sur des cours d’eau non aménagés jusqu’ici. Or, les petites unités hydroélectriques représentent seulement 1 % de l’électricité produite en France, soit l’équivalent de la production d’un réacteur nucléaire.
Les centrales bâties aujourd’hui sont de petite taille, comme au début de la production d’hydroélectricité.
Dans les années 1880, les premières installations étaient très modestes, elles servaient à alimenter un village, une usine… Une dizaine à une centaine d’ampoules ! Il s’agissait de systèmes de conduite forcée : l’eau était canalisée à des endroits où le débit était important. Progressivement, les installations se sont développées dans les Alpes, pour alimenter les usines métallurgiques et chimiques. Dans les Pyrénées, des essais d’électrification du train ont été menés grâce à l’énergie de l’eau. Le développement de l’hydroélectricité s’est poursuivi dans le Massif central et la vallée de la Loire – qui, en raison de sa proximité avec Paris, a commencé à alimenter la capitale. L’hydroélectricité est alors venue concurrencer le gaz pour l’éclairage public.
Comment l’hydroélectricité était-elle perçue à ses débuts ? Est-ce que l’enjeu environnemental existait alors ?
À la fin du XIXe siècle, l’hydraulique est présentée comme une technologie sûre et moderne, en opposition au gaz qui a causé des drames, comme l’incendie de l’Opéra-comique à Paris en 1887. À l’époque, des ingénieurs font le tour de France pour effectuer des démonstrations dans les villages, convaincre les maires d’essayer l’hydroélectricité. L’expression « houille blanche » a d’ailleurs été inventée par un ingénieur de l’époque, Marcel Deprez, pour désigner cette nouvelle source d’énergie.
Certes, ces ingénieurs appartiennent à des compagnies privées, derrière lesquelles se trouvent parfois de gros investisseurs, comme Rothschild. Mais dès le début, des préoccupations environnementales s’expriment. En 1899, dans le Doubs, le projet d’installation d’une conduite forcée sur une chute d’eau remarquable, la source du Lison, fait naître des oppositions. Si à cette époque les gens ne pensent pas à la décarbonation de l’économie, ils ont déjà conscience que l’industrialisation a un impact sur l’environnement, et que celui-ci n’est pas forcément positif. Ces protestations n’ont certes pas le même poids qu’aujourd’hui, mais elles vont amener un député de la région, Charles Beauquier, à proposer une loi de protection du patrimoine paysager, la première du genre. Ce texte a eu un effet mitigé sur la préservation du paysage, mais il a permis que la source du Lison ne soit pas aménagée.
Après la Seconde Guerre mondiale, l’hydroélectricité se développe avec la construction des grands barrages. Ces projets monumentaux s’accompagnent-ils de résistances, sur le terrain ou dans la sphère politique nationale ?
Dans la première moitié du XXe siècle, l’électricité produite grâce à l’eau s’additionne à celle produite par le charbon. Cette complémentarité se renforce avec l’interconnexion des réseaux entre les deux guerres – auparavant, chaque réseau alimentait un village, une zone, une ville. À partir de 1946, on assiste à la réalisation de grands aménagements nationaux, pour exploiter tout le potentiel hydroélectrique du pays.
La construction des grands barrages jusqu’à la fin des années 1960 a suscité des contestations locales de deux types. Dans la continuité de ce qu’on observe durant les périodes précédentes, il y a d’abord des mobilisations pour la préservation des paysages, en particulier dans les Pyrénées où le tourisme de montagne est une ressource importante. Ensuite, on assiste à la résistance des populations dont le lieu de vie ou l’activité professionnelle est menacée – des bergers notamment. Dans les Alpes, plusieurs dizaines de hameaux sont engloutis par ces chantiers. À Tignes, la construction du barrage entre 1946 et 1952 est menée sous la protection des CRS, à la suite de la contestation du projet par les habitants.
Mais l’hydroélectricité est globalement perçue comme une nécessité et un progrès, dans un contexte où la France dispose de faibles ressources fossiles, et voit décliner sa ressource en charbon. La priorité est alors d’assurer l’indépendance énergétique du pays et de favoriser son industrie. À côté des stocks de pétrole, la France anticipe de potentielles privations autour du couple charbon-hydroélectricité puis, à partir des années 1970, du duo nucléaire-hydroélectricité. Jusqu’à cette période, on ne peut pas encore parler d’émergence d’une écologie politique.
Un événement charnière va-t-il faire basculer la contestation environnementale des projets énergétiques vers le terrain politique ?
Il s’agit plutôt d’un glissement, à partir des années 1970, qui conduit progressivement à une remise en cause plus radicale de la civilisation industrielle. Une hypothèse est que, jusqu’alors, les militants préoccupés par l’environnement considéraient que les conséquences négatives de l’industrialisation étaient le fait de l’avarice et de l’insensibilité des patrons capitalistes, et donc qu’une industrie respectueuse de l’environnement était possible. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Le potentiel hydroélectrique du pays étant presque complètement exploité, l’essentiel de la contestation se porte sur des nouveaux projets, de plus grande envergure : en particulier, les réacteurs nucléaires et le gaz de schiste.