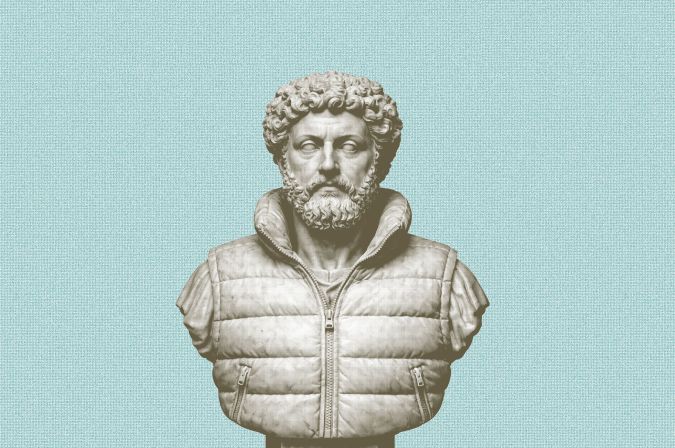Quelques étudiants discutent sur la pelouse. On s’installe au soleil en ce printemps 2021, sur un banc brinquebalant du campus de l’université Bordeaux-Montaigne, dont Barbara Stiegler dit qu’elle est sa « maison ». Chignon lâche, débit rapide et précis, la philosophe fait défiler sur son portable les photos prises quand elle manifestait avec les « gilets jaunes » à l’automne 2018. À 50 ans, l’intellectuelle a opéré la jonction entre philosophie et militantisme. Son essai polémique De la démocratie en Pandémie (éd. Tracts Gallimard, 2021) s’est déjà vendu à plus de 75 000 exemplaires. Un réquisitoire dans lequel elle accuse le gouvernement de « s’engouffrer dans les brèches » ouvertes par la crise sanitaire pour réduire les libertés.
À l’université, la professeure de philo refuse d’enseigner derrière un écran et s’est battue pour la réouverture d’un amphi – dans le respect du droit. Elle estime que ses étudiants ont besoin d’« un vrai lieu », que c’est au contact les uns des autres qu’on apprend à penser, et non dans un « espace numérique de travail ». L’amphi lui a été accordé, les deux tiers des sièges condamnés, parsemés de flacons de gel hydroalcoolique. La fille du philosophe Bernard Stiegler interroge comme lui les mutations numériques, révèle le rapport entre les cours en visio et les idées néolibérales. Son père a mis fin à ses jours en août 2020. De cela, la fille aînée n’a nulle envie de parler.
Mais elle évoque volontiers les souvenirs d’une enfance atypique. Avant de diriger les programmes de recherches au Collège international de philosophie, Bernard Stiegler avait vécu de boulots divers puis passé cinq ans en prison, pour braquage. De sa petite enfance, Barbara Stiegler se rappelle les conversations animées des adultes sur la politique et la philosophie, la vie dans une ferme, une réserve de rêveries pour une femme qui construit son œuvre sur le vivant et le soin, dans un souci constant d’émancipation.
« Ceci n’est pas une pandémie », écrivez-vous. Alors, qu’est-ce que c’est ?
Barbara Stiegler : Comme l’écrit la revue scientifique britannique The Lancet, le mot « pandémie » est trompeur. Il suggère que nous serions tous, partout et à tout moment, en danger de mort face à ce virus. On sait que, dans l’immense majorité des cas, le coronavirus ne tue pas les personnes en bonne santé. Non, ce qui le rend redoutable, c’est l’environnement social et sanitaire dans lequel il se propage. Il fonctionne comme un révélateur du délabrement de nos systèmes de soin, essorés par le souci de rentabilité. Je préfère le mot « syndémie » : une épidémie complexe dont la gravité dépend de l’état de notre système de santé, de notre rapport au vieillissement, de notre système de production et de consommation, de l’augmentation des maladies chroniques, de la pollution de l’air, de notre rapport aux animaux, au vivant… Le Covid-19 prospère dans les environnements dégradés par la crise écologique. Nous ne vivons pas qu’une crise sanitaire.
Un an avant le début de cette crise, vous manifestiez avec les « gilets jaunes ». Quand avez-vous commencé à militer ?
Une dizaine d’années plus tôt, sur ce campus de l’université Bordeaux-Montaigne. On est en 2009, sous la présidence Sarkozy, je suis maître de conférences depuis trois ans, après avoir enchaîné les postes précaires. Enfin stabilisée, j’adhère au Snesup, syndicat marqué à gauche. Je m’engage contre la réforme de l’université, apprends à organiser des assemblées générales. À l’automne 2018, devenue professeure des universités et responsable du master Soin, éthique et santé, je m’apprête à publier le résultat d’une enquête sur le néolibéralisme. Et surviennent ces manifestations incroyables qui rassemblent des artisans, des aides-soignantes, des gens dont on disait jusqu’alors qu’ils ne s’intéressaient pas à la vie publique. Fascinée, je passe mes soirées devant les chaînes d’information en continu. Je me sens proche des « gilets jaunes », moi qui circule dans une diesel recalée au contrôle technique, et qui ai du mal à nous loger à Bordeaux, mes enfants et moi, avec mon salaire d’universitaire.
Un salaire au-dessus de la moyenne des « gilets jaunes », quand même…
Beaucoup de gens ont en tête l’image des universitaires d’antan, qui gagnaient confortablement leur vie. Mais depuis une quarantaine d’années, sous l’effet des coupes budgétaires et de la hausse de l’immobilier dans les métropoles, la profession s’est paupérisée. Si on parvient à devenir professeur, comme moi, à plus de 45 ans, on gagne 3 000 euros. C’est peu pour vivre en ville, surtout si l’on n’a qu’un salaire et plusieurs enfants à charge.
Mais le revenu médian en France, c’est un peu moins de 1 800 euros…
Vous savez, dans les cortèges de « gilets jaunes », il y a des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, mais aussi beaucoup de gens des classes moyennes qui ont du mal à boucler leurs fins de mois. Parmi les universitaires, ceux de mon âge et surtout les plus jeunes, mais aussi tous ceux qui, comme moi, n’ont pas hérité d’un patrimoine, ont du mal à se loger et contractent des dettes, mais certains persistent à se voir comme des privilégiés. Il y a là un déni de réalité, une sorte de fausse conscience. À l’automne 2018, je ne suis pas dans le déni. Je suis en colère contre la salve de mesures punitives qui sont imposées aux automobilistes, comme la limitation de vitesse à 80 kilomètres/heure, parce qu’elles relèvent de l’injonction contradictoire : soyez mobiles pour aller travailler, mais n’utilisez pas votre voiture, c’est dangereux et ça pollue ! J’ai longtemps vécu à la campagne, je n’aime pas cette écologie punitive qui frappe les automobilistes éloignés des centres-villes mais épargne les avions et les porte-conteneurs.
Que faites-vous alors ?
Dans ma voiture, j’ai un gilet jaune. J’écris dessus « Taxe les riches, ça refroidira la planète », et vais manifester le 1er décembre 2018 lors d’un déplacement à Paris. Devant l’incendie des sapins de Noël de la place Vendôme, je me demande ce que je suis en train de vivre [elle montre des photos sur son téléphone : on aperçoit l’éclat des flammes, la fumée, les banderoles, ndlr]. Je suis frappée par le mélange social : infirmières, plombiers, journalistes, médecins… Je parle à plein de gens, je suis émue de voir des hommes et des femmes réputés apathiques s’emparer de l’espace public, construire des agoras. De retour à Bordeaux, je rejoins les cortèges du samedi. Le préfet de la Gironde, Didier Lallement, mène une répression hyperviolente. Je suis gazée à plusieurs reprises, j’ai peur d’être blessée. Je mens à mes enfants, je ne leur dis pas que je vais manifester. Je ne le confie qu’à quelques amis proches.
Pourquoi vous cacher ?
En janvier 2019, je publie chez Gallimard « Il faut s’adapter », Sur un nouvel impératif politique, un essai philosophique sur le néolibéralisme. Et je ne vois pas comment assumer le statut d’autrice Gallimard en gilet jaune ! Des journalistes m’interrogent sur mon livre et me demandent ce que je pense du mouvement social en cours. Je réponds que je le trouve légitime… sans dire que j’enfile mon gilet jaune.
Chercher à lutter à l’échelle mondiale contre le grand capital, c’est paralysant. J’ai mis longtemps à comprendre que chacun peut résister là où il se trouve.
Puis vous révélez votre engagement.
Début décembre 2019, Emmanuel Laurentin, producteur sur France Culture, m’invite à parler de la réforme des retraites, qui suscite beaucoup de manifestations. Je m’apprête à refuser, mais sur le campus, un ami très cher me convainc : dans la logique néolibérale, la retraite est un archaïsme. Or c’est un temps essentiel, retiré de la compétition, pour prendre soin de soi et des autres. L’hôpital, l’université, l’école ont besoin, eux aussi, d’être soustraits à la compétition. Dès lors, je bascule. À la radio, j’assume ma position. À la fac, j’organise un petit collectif de lutte avec quelques collègues. J’arpente Bordeaux pour rencontrer d’autres collectifs d’universitaires, d’étudiants, de soignants, de gens de la culture… Des liens se nouent. Je le raconte dans Du cap aux grèves (éd. Verdier, 2020). On organise des manifestations pour alerter sur la situation des étudiants. On défend les formations en sciences humaines menacées par les coupes budgétaires. On fait circuler des pétitions, on contacte les médias, on interpelle les responsables locaux. Sans ces collectifs, je ne survivrais pas ! Chercher à lutter à l’échelle mondiale contre le grand capital, c’est paralysant. J’ai mis longtemps à comprendre que chacun peut résister là où il se trouve.
Concrètement, comment agir ?
Déjà, en n’agissant pas contre ses propres convictions. Par exemple, j’estime que les cours en visio sont des cours « congelés », pas de vrais cours. Alors dès le début de la crise sanitaire, j’explore d’autres pistes. Lors du premier confinement, je rédige mes cours comme de petits manuels, j’échange avec mes étudiants par e-mail et par téléphone. En juin, les restaurants et les cafés rouvrent, pas les universités, alors j’organise des sessions avec mes étudiants dans un restaurant marocain proche du campus. On avait besoin de se retrouver. Deuxième confinement, les universités ouvrent puis referment… mais pas complètement. Je fais venir les étudiants à la fac par groupes de deux ou trois, dans le cadre du « soutien ». Un décret le permet – dans un État de droit, il faut toujours s’appuyer sur le droit, c’est un outil de combat. En février, je récupère un amphi, que nous occupons au tiers de sa capacité. Une victoire ! Un conseil : ne pas rester seul, toujours lutter à plusieurs. Une petite dizaine d’amis-alliés suffisent.
En quoi les cours en visio posent-ils problème ?
L’enseignant parle à une machine, chacun reste seul. C’est la vision néolibérale de l’éducation : chaque famille, en compétition avec toutes les autres, pousse ses enfants à accumuler le plus de « capital humain » monnayable sur le marché du travail. Un cours à l’université, ce n’est pas un contenu qu’on déroule, c’est un collectif de travail. Sur le visage de mes étudiants, je lis leurs réactions : intérêt, incompréhension, ennui, surprise… Ça permet d’ajuster le propos, de penser mieux. Des liens se créent entre les étudiants parce qu’ils partagent une expérience intellectuelle. Dans cette atmosphère amicale, ils n’ont pas peur d’élever des objections, de sorte que je peaufine encore mon argumentation. Un bon cours est celui dont tout le monde sort changé, avec de nouvelles idées, y compris l’enseignant. Dans le cadre du master Soin, éthique et santé, j’apprends plein de choses de mes étudiants, qu’ils soient médecins ou infirmiers. Eux pensent leur expérience quotidienne, parfois éprouvante. Moi, je saisis mieux, grâce à eux, ce qui se joue à l’hôpital et dans l’ensemble des institutions de santé.
Qu’est-ce qui s’y joue ?
Par exemple, la suppression des lits, qui continue malgré la crise sanitaire. L’objectif, c’est de « faire du flux », facturer le maximum d’actes médicaux à haute valeur ajoutée. Parallèlement, on réduit les moyens attribués aux soins de base et à la recherche fondamentale. Sous pression, les soignants ont de moins en moins le temps d’un dialogue ou d’un geste humain avec les patients. Alors que le gouvernement, selon sa ligne néolibérale, injecte des milliards d’euros dans de grandes entreprises qui n’ont pas besoin de cet argent et qui licencient.
D’où vient votre passion pour la politique ?
De l’enfance. Je suis née en banlieue parisienne, à Sarcelles, ville nouvelle utopique marquée par le brassage social. Mon père venait d’une famille modeste d’employés et d’ouvriers. Ma mère était la fille de rapatriés d’Algérie, modestes eux aussi. Mes parents se sont rencontrés à Sarcelles, très jeunes. Mon père tractait pour Lutte ouvrière, ses frères étaient au Parti communiste. Ensuite mon père a lui aussi adhéré au PCF, puis l’a quitté. L’un de mes oncles était responsable de la bibliothèque municipale et jouait un rôle actif dans la vie politique locale. Quand mes parents avaient 20 ans, ils n’avaient ni argent ni statut social et ils devaient s’occuper de moi, alors âgée de 1 an.
Ils sont partis dans le village de mes grands-parents maternels dans le Lot-et-Garonne. Ils ont loué une petite ferme où ils recevaient beaucoup. Dans la famille, on parlait politique. Mes parents, mes oncles et leurs amis discutaient jusque tard dans la nuit, en fumant, en buvant, c’était véhément… Je n’y comprenais pas grand-chose, mais j’aimais ces échanges pleins de vie et de passion. Jusqu’à 6 ans, j’allais très peu à l’école, je vivais entourée d’adultes qui discutaient d’enjeux qui me paraissaient immenses. Et j’étais au contact permanent d’une nature vivante qui ouvrait elle aussi autour de moi de vastes horizons, que je ressentais comme cosmiques. À la ferme, je cohabitais avec des chèvres, des cochons, des poules, des chiens, même un singe. À deux pas de ma maison, je m’étais approprié une petite colline sauvage, un petit monde miniature. Je garde de tout cela un souvenir merveilleux, celui d’un petit paradis perdu.
Puis mes parents se sont installés à Toulouse, où ils ont ouvert un restaurant. Ensuite, ils se sont séparés. Ma mère nous a emmenés, mon frère et moi, vivre en banlieue parisienne, à Gif-sur-Yvette, où nous découvrions soudain le confort moderne, avec un poste de télévision. À 8 ou 9 ans, je regardais des émissions politiques comme Droit de réponse ou L’Heure de vérité. Ça m’intéressait beaucoup, même si les hommes politiques me paraissaient tous catastrophiques… En 1983, j’avais 12 ans quand le gouvernement socialiste a opéré le « tournant de la rigueur » [en faveur de la construction européenne, au détriment des politiques sociales, ndlr]. Moi, je n’étais pas d’accord !
Vous êtes philosophe comme votre père, Bernard Stiegler. Comment avez-vous choisi cette voie ?
Enfant, je m’intéressais à la biologie. À la fin des années 1970, le nouveau compagnon de ma mère, chercheur au CNRS, étudie la photosynthèse, et moi, écolière, je veux être « chercheuse en sciences naturelles » [sourire]. Je dessine des schémas sur la reproduction des fougères, je cueille des champignons, je me fais offrir un microscope. Déjà, j’aime enseigner… à mon petit frère ! Mais au collège, je suis très déçue par l’apprentissage des sciences, une vraie souffrance.
Quand vous avez 7 ans, votre père est incarcéré.
Jusqu’à mes 12 ans, il est en prison dans le Sud-Ouest. Mon frère et moi le voyons rarement, c’est loin et les visites sont contingentées. Mais nous lui écrivons chaque semaine. Lui aussi nous écrit beaucoup. C’est en prison que mon père se tourne vers la philosophie [il entretient une correspondance avec Jacques Derrida, son directeur de thèse, ndlr]. Après sa libération, il se remarie avec une philosophe. Leurs discussions me paraissent passionnantes mais énigmatiques. Au collège, je sèche les cours, j’ai de mauvaises notes, je m’ennuie. Je me sens enfermée dans le présent, alors je me plonge dans le XIXe siècle et le tout début du XXe siècle.
Adolescente, j’ai besoin d’inactualité, je lis Proust et me prends de passion pour le cinéma de Visconti. Tous racontent une modernité qui ne va pas bien, ça fait écho en moi. J’écris de la poésie, les études de lettres me tentent, mais je trouve que les cours de français consistent plus à commenter qu’à créer. Après le bac, j’entre au lycée Balzac, à Paris, dans une petite prépa littéraire, une hypokhâgne mal cotée où je découvre de la part des enseignants une exigence intellectuelle extraordinairement stimulante. Ça me passionne, j’ai d’excellents résultats. L’année suivante, j’entre en khâgne au lycée Henri-IV, où je rencontre un professeur de philosophie marquant, Pierre Jacerme. Là, je me dis : la philosophie, finalement, c’est pour moi.
Ça me rouvre ces horizons immenses qui ont tant marqué ma petite enfance. Non seulement dans l’espace mais dans le temps, parce qu’en philosophie on retrace l’histoire des concepts, on en fait la généalogie. Je découvre Nietzsche, cet extraordinaire clinicien de la modernité en crise. Et Marx, bien sûr. Je leur consacre mon mémoire de maîtrise, parce que les auteurs du passé aident à résister. C’est décalé d’écrire sur Nietzsche, Marx et le capitalisme dans les années 1990, quand tout le monde croit à la « fin de l’histoire », et c’est pour cela précisément que je choisis de les lire, pour leur inactualité.
C’est quoi, ce gouvernement dit néolibéral qui passe son temps à nous dicter ce qu’on doit faire à l’université, à l’hôpital, dans les tribunaux ?
Vous écrivez sur le néolibéralisme. Comment vous êtes-vous intéressée à ce sujet très actuel ?
Ça remonte à mon entrée dans la lutte politique, en 2009. À l’époque, les enseignants-chercheurs protestent contre la loi sur la réforme de l’université, qui rend les présidents d’université « autonomes », l’œil rivé sur les classements internationaux et les dépenses. Comme, parallèlement, l’État réduit les moyens, cette fausse autonomie les conduit à économiser sur tout, tandis que les chercheurs passent la moitié de leur temps à chercher des financements pour leurs projets. Pour la première fois de ma vie, je m’implique complètement dans un mouvement social. Dans les assemblées générales, j’entends des slogans contre le néolibéralisme. Au même moment, magistrats, avocats, médecins hospitaliers font grève et descendent dans la rue contre des réformes. Jusqu’alors, je crois, comme beaucoup de gens, que la ligne néolibérale consiste à « laisser faire ». Mais dès lors, je me pose la question : c’est quoi, ce gouvernement dit néolibéral qui passe son temps à nous dicter ce qu’on doit faire à l’université, à l’hôpital, dans les tribunaux ? Qu’est-ce au juste que le néolibéralisme ? Je me lance dans une sorte d’enquête policière.
Que découvrez-vous ?
L’œuvre d’un intellectuel américain un peu oublié, Walter Lippmann, mort au début des années 1970. Diplomate, journaliste et essayiste, il exerce une influence considérable sur le débat d’idées des années 1920 et 1930. En 1938, il est l’invité d’honneur d’un grand colloque qui se tient à Paris sur le néolibéralisme – le terme est nouveau à l’époque. Il rassemble des économistes et des philosophes en rupture par rapport aux libéraux classiques, ceux pour qui l’État devrait « laisser faire » le marché. Les néolibéraux, eux, ont connu la Grande Dépression de 1929. Pour eux, le laisser-faire est une impasse. Avec Lippmann, ils défendent le retour invasif de l’État dans toutes les sphères de la vie sociale – le droit, la protection sociale, l’éducation – pour assurer le fonctionnement optimal du marché, ce que le projet de traité constitutionnel européen appellera la concurrence libre et non faussée. Ce retour néolibéral de l’État, redéfini comme architecte du marché, Michel Foucault l’a montré dès les années 1970 dans ses cours au Collège de France. Mais il est mort en 1984. Moi, née en 1971, j’ai assisté au déploiement du néolibéralisme en Europe. Y compris en France, avec les réformes des retraites, du droit du travail, de la santé, de l’assurance chômage, de l’éducation… Alors j’ai eu le temps de percevoir autre chose, notamment dans le rapport à la vie, à l’évolution et au gouvernement des vivants. En lisant Walter Lippmann, je suis tombée sur Darwin.
Darwin ? Est-il d’actualité ?
Ses idées saturent notre époque. Il suffit de prêter attention aux mots : « l’évolution », dit-on, réclame des « mutations » qui doivent permettre de « survivre » et de « s’adapter » à un nouvel « environnement ». Avez-vous remarqué que nous avons tout le temps le sentiment d’être dépassés, en retard ? « Il faut s’adapter » est devenu le nouvel impératif. Pourquoi cette colonisation du champ économique, politique et social par le lexique biologique de l’évolution ? Les premiers néolibéraux ont lu Darwin. Lippmann est marqué par la théorie de l’évolution des espèces. Pour lui, l’humanité a été habituée depuis ses origines à un environnement stable, celui des communautés villageoises ou des cités-États. Du fait de cette lente évolution, l’espèce humaine se retrouve d’après lui « inadaptée » au grand marché capitaliste mondialisé, ouvert et fluctuant.
Ce « retard » exige en réponse une politique ambitieuse, notamment en matière de santé et d’éducation. Puisque la population est naturellement irrationnelle et conservatrice, estime Lippmann, les autorités doivent la prendre en main. Depuis une quarantaine d’années, un peu partout dans le monde, les gouvernements néolibéraux – y compris quand ils sont sociaux-démocrates – imposent aux peuples des « réformes » profondes pour que chacun reste « dans la course ». Ils façonnent notre vie au nom d’une « égalité des chances » dans la compétition générale. Résultat : chacun de nous peut se montrer néolibéral sans le savoir. L’enseignant qui met en œuvre des dispositifs pour améliorer « l’agilité » de ses étudiants sur le marché du travail croit sincèrement agir en pédagogue progressiste. Mais il contribue à former de futurs salariés malléables destinés à être mis en concurrence les uns avec les autres. Dans « Il faut s’adapter », Sur un nouvel impératif politique, je prends clairement parti contre ce modèle éducatif promu par Lippmann.
Pourquoi ?
Parce que le néolibéralisme n’est pas démocratique et c’est ce qui détermine sa conception de l’éducation. Lippmann assigne à l’humanité un cap ultime qu’il appelle « la grande société », c’est-à-dire le grand marché capitaliste mondialisé. Cet objectif très inégalitaire mériterait discussion, non ? Or Lippmann et les dirigeants néolibéraux n’admettent pas la discussion car ils prétendent connaître le sens de l’histoire. À ceux qui contestent leurs politiques, ils opposent systématiquement la « pédagogie », comme si le désaccord marquait une forme d’immaturité. Lippmann ne conçoit pas de conflit fécond, alors il veut « fabriquer le consentement » des masses par la communication politique. Il est l’inventeur de cette formule, en 1922.
On entend souvent que, depuis la chute de l’Union soviétique, c’en serait fini des « grands récits » sur l’histoire humaine. C’est faux : le néolibéralisme offre à son tour un « grand récit », radical et autoritaire de surcroît. Comme en Union soviétique, une sorte de mise en scène vise à masquer l’écart entre récit et réalité. Je le vois à l’université. Pendant l’épidémie, la communication officielle affirmait « l’université fonctionne, tout va bien », alors que les étudiants trichaient aux examens en ligne et décrochaient de leurs cours sur Zoom.
Donc « s’adapter », vous êtes contre ?
Non, bien sûr, mais qu’entend-on par là au juste ? Dans L’Origine des espèces, Darwin explique que la vie ne poursuit pas de but fixé par avance, mais foisonne, bifurque, invente. Les êtres vivants ne se contentent pas de s’adapter à leur environnement, ils le façonnent en fonction de leurs besoins de façon imprévisible et créative. Évoluer, c’est aussi changer le monde. C’est ce que montre le philosophe John Dewey, l’un des plus grands penseurs américains du XXe siècle. Lecteur de Darwin lui aussi, Dewey en tire des conclusions opposées à celles de Lippmann avec qui il a beaucoup débattu. Pour faire face à une situation nouvelle, il mise sur l’intelligence collective et la délibération démocratique. Il conçoit la vie comme une tension permanente entre changement et conservation. Le désir humain de stabilité ne lui apparaît pas comme un défaut à combattre. Dewey ne croit pas davantage que Darwin à un but transcendant, fixé d’avance, vers lequel il faudrait aller absolument. Les néolibéraux préfèrent ignorer cette lecture de Darwin. Pourtant, le cap qu’ils se sont fixé creuse les inégalités et détruit le vivant par la surexploitation des ressources.
Vous avez réussi Normale sup, l’agrégation, vous êtes professeure d’université. Vous êtes « adaptée » ?
Très ! Je suis une bête à concours, la compétition me réussit. Je peux me lier avec des gens de tous horizons. J’ai traversé des milieux sociaux très différents, j’ai appris à m’adapter partout. Et si ça consiste à inventer de nouvelles manières de travailler et de nouveaux liens, oui, je suis adaptée ! Mais si, comme le croient les néolibéraux, l’adaptation revient à se soumettre à un ordre imposé, au risque de la dépression ou du burn out, alors je suis rebelle. Inadaptée.