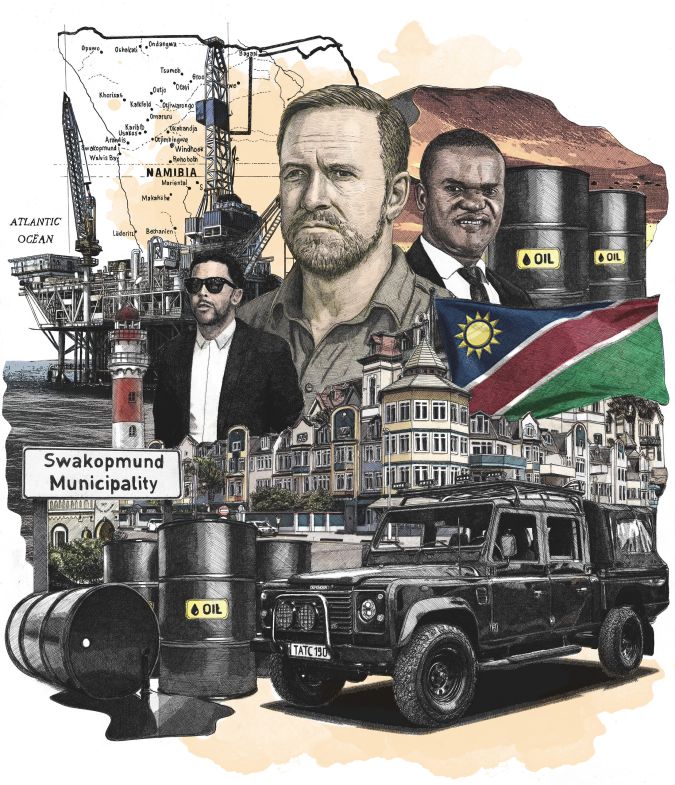La genèse

Gaël Faye
Au mois d’avril 1994, une grande partie de ma famille maternelle fut assassinée durant le génocide contre les Tutsi du Rwanda. Bien qu’elle ne s’exprimât que très peu sur ce sujet, ma mère insistait pour que ses enfants l’accompagnent chaque mois d’avril aux veillées de commémorations organisées à Paris. Durant ces soirées, j’ai été confronté pour la première fois à cette forme de prise de parole qu’est le témoignage du survivant. Ces récits de l’horreur constituèrent mon entrée en matière dans la réalité brutale du génocide. J’ai alors éprouvé l’envie de m’engager d’abord dans des associations de mémoire, puis au sein du Collectif des parties civiles pour le Rwanda (CPCR), dont l’objectif premier est de déférer devant la justice française les personnes accusées de génocide qui ont trouvé un accueil sur le sol français.
Au printemps 2021, soit vingt-sept ans après les faits, le rapport Duclert et le discours du président Emmanuel Macron à Kigali permirent enfin une reconnaissance des « responsabilités » de la France au Rwanda. J’ai vécu ces deux événements de façon mitigée. D’une part, j’ai accueilli avec soulagement la fin d’un long déni des autorités françaises, d’autre part j’ai ressenti un profond malaise à l’écoute de certaines phrases du président ayant pour effet d’exonérer les soldats français en leur offrant un rôle exemplaire : « Ces soldats qui ont eux aussi vu de leurs yeux l’innommable, pansé des blessures, et étouffé leurs larmes. » Des formules que je trouvais déplacées et choquantes quand, au même moment, une plainte pour viols sur des jeunes femmes tutsi durant l’opération Turquoise est à l’instruction à Paris depuis plus de dix ans.
Lorsque Michael m’a appris qu’il avait retrouvé les plaignantes au Rwanda, nous avons tout de suite saisi l’importance de donner un visage et un nom à ces femmes oubliées par la justice, par les historiens et par la parole politique. Il était urgent de les faire exister afin de continuer d’interroger les responsabilités de la France au Rwanda.
Michael Sztanke
Autour de la table du dimanche, pendant près de vingt ans, entre la carpe farcie et le foie haché, dans le 20e arrondissement de Paris, ma grand-mère Jenny a toujours souhaité parler : « Il faut raconter la Shoah », répétait-elle. Jenny, juive allemande d’origine polonaise, déportée et rescapée des camps de la mort nazis (ghetto de ŁÓdź, Dachau, Bergen-Belsen) a souvent témoigné. Le récit de son expérience et de l’indicible a marqué ma vie.
Le génocide des Tutsi m’est apparu comme un miroir, un appel à ma propre expérience et surtout à ma mémoire familiale. C’est en lisant Auschwitz et après, l’ouvrage de l’écrivaine et déportée Charlotte Delbo, que j’ai compris pourquoi l’histoire du Rwanda avait cette résonance singulière. Le témoignage d’une expérience extrême est à chaque fois unique, mais la question qu’elle pose tout au long de son livre, « comment nous croire, nous, les survivants ? », m’a longtemps perturbé. Écouter les rescapés du génocide des Tutsi au Rwanda, c’est interroger leur mémoire et en comprendre les contours, parfois les failles. C’est aussi accepter de longs récits sur une crête, celle de la mémoire mouvante propre au survivant du génocide.
Je suis parti au Rwanda avec l’idée d’écouter, jamais celle de comprendre. Je sais, depuis le récit de Jenny, qu’il n’est pas possible de comprendre une personne qui a vécu la limite de la survie, un génocide. Dans le rapport de la commission Duclert remis au président Emmanuel Macron en 2021, 215 pages sont consacrées à l’opération Turquoise. Il n’y figure aucune mention, aucun commentaire ou analyse, sur le comportement des soldats durant leur mission dans les deux camps de réfugiés de Nyarushishi et de Murambi. Pourquoi ? Il semblerait que les historiens n’aient pas eu accès aux archives concernées. C’est un manque important, l’angle mort du rapport. Ces questions m’ont conduit à proposer à Gaël de raconter et de faire connaître cette histoire.
Le voyage

Cette histoire commence au printemps 1994 – et sans doute bien avant –, dans le déchaînement de violence qui s’abat sur les collines rwandaises. Concessa Musabiynama, Marie-Jeanne Muraketete et Prisca Mushimiyimana affirment avoir été violées par des militaires français de l’opération Turquoise. Violées parce que Tutsi, précisent-elles. Elles ont déposé plainte auprès de la justice française en 2009 et en 2012.
Après des semaines de discussions, Marie-Jeanne a proposé à Dida, notre productrice à Kigali, de se rendre à Nyarushishi, pour montrer à sa fille de 21 ans, Jeannette, la région où elle a grandi et souffert. Concessa, originaire de Cyangugu (près de Nyarushishi), a longuement échangé avec son amie et confidente Jacqueline. Elles ont pris la décision de faire le voyage avec Marie-Jeanne et Jeannette. Délice, la fille de Concessa, 23 ans, a souhaité accompagner sa mère dont elle ignore jusqu’à aujourd’hui l’histoire. Nous avons proposé ce voyage à Prisca, originaire de Butare, qui a aussi déposé plainte pour viol pendant l’opération Turquoise. Ces femmes n’étaient jamais retournées sur les lieux de leur calvaire.
Le camp de Murambi est tristement connu pour avoir été le lieu d’un massacre de 50 000 Tutsi en avril 1994 dans l’ancienne école technique de la ville, deux semaines à peine après le déclenchement du génocide.
À Nyarushishi, les collines sur lesquelles étaient posées les milliers de tentes bleu et blanc du camp de réfugiés (entre 8 000 et 10 000 Tutsi s’y étaient entassés) ont laissé place à la nature et à quelques maisons formant un modeste village. En surplomb, un mémorial du génocide comme il en existe des centaines à travers le pays. Autour, à perte de vue, les collines de thé au vert fluorescent.
Quand notre minibus, après une journée de route et une nuit de repos, s’est mis à serpenter sur les pistes ocre en lacets des collines de Nyarushishi, nous avons observé discrètement les femmes. Après un moment de silence, les yeux rivés de part et d’autre des vitres, Marie-Jeanne s’est souvenue à voix haute, interpellant Concessa, Prisca et Jacqueline.
« Il y avait une barrière ici aussi. Jacqueline, tu te souviens qu’il y avait une barrière sur ces deux routes ? Tous ceux qui tentaient de passer se faisaient tuer à la machette, oh Seigneur ! Les miliciens étaient nombreux, si nombreux ! Il y en avait partout. Cet endroit a donné lieu aux pires horreurs. Personne ne pouvait dépasser cette barrière, même pour aller chercher du bois. Oui, la barrière était juste là pour nous empêcher d’aller chercher du bois. Si tu voulais sortir du camp […], c’était à tes risques et périls. Ce sont des bus publics qui nous ont transportés du stade au camp de Nyarushishi. Le transport était organisé par la Croix-Rouge. En juin, les soldats français sont arrivés en uniforme. Le camp était immense. Il n’y avait qu’une seule maison entourée de forêts. J’ai fait partie des premiers à quitter le stade où l’on était réfugiés pour arriver au camp. Les Français étaient présents. Ils étaient là pour notre protection, avec la Croix-Rouge qui distribuait de la nourriture, des couvertures et des casseroles. Ils s’occupaient des morts du choléra. »

Le 22 juin 1994, la France obtient un mandat de l’ONU pour le déploiement de soldats au Rwanda dans le cadre d’une mission dite humanitaire, l’opération « Turquoise ». Les soldats, une trentaine de légionnaires de la 1re compagnie du 2e régiment étranger d’infanterie (REI), s’installent sur les hauteurs des collines de Nyarushishi, près d’une bâtisse coloniale blanche appelée la « maison de Marcel », du nom d’un Belge ayant résidé là autrefois. Leur mission consiste à protéger les rescapés du génocide, en assurant leur sécurité face aux incursions quotidiennes des miliciens interahamwe.
Lorsque nous sommes descendus du bus, dans un nouveau silence qui masquait mal l’émotion et la douleur du retour sur ce lieu, Marie-Jeanne est seule à s’acheminer d’un pas résolu en direction d’une forêt en contrebas, à la recherche d’un endroit précis. Nous la suivons sans comprendre exactement vers où elle se dirige. Rejointe par Délice, la fille de Concessa, elle s’arrête soudainement. Marie-Jeanne pensait probablement à ce lieu ces dernières semaines, peut-être même ces dernières années. Sa voix se brise. « C’est là, dans cette tranchée, qu’ils m’ont traînée. Les Français m’ont vue alors que je ramassais du bois. Ils ont couru derrière moi, j’avais mon bébé dans le dos. En bas, il y avait des tranchées que les soldats avaient creusées. Ils m’ont violée. Je suis restée dans cette tranchée pendant trois jours. J’ai été découverte par d’autres réfugiés qui cherchaient du bois. Ils m’ont fait sortir avec mon enfant. Puis des Blancs de la Croix-Rouge m’ont emmenée me faire soigner avec mon enfant. Je saignais et je n’arrivais plus à refermer mes jambes. » Face à nous, une rangée de grands eucalyptus s’agitent, balancés par un vent puissant annonçant l’arrivée prochaine d’un orage. Dans notre dos, des centaines d’arbres ont été coupés à la scie par des bûcherons laissant la colline à nu, offrant un paysage désolé. Marie-Jeanne, Concessa et Jacqueline se recueillent.
Nous avons poursuivi notre voyage vers Murambi. Prisca avait fait part à Concessa, Marie-Jeanne et Jacqueline de son refus de s’y rendre. Elle voulait rester dans le bus pendant la visite du mémorial de Murambi. Elle a fini par descendre du bus. Secouée par l’émotion, elle s’est assise avant même de rentrer sur le site. Seule, elle n’aurait probablement pas tenu. Toutes l’ont entourée, rassurée, consolée. Ce fut, entre ces femmes, un moment de communion dans une tristesse indescriptible.
Prisca, 47 ans, sans travail, vit avec son fils de 8 ans dans un grand dénuement à la périphérie de la ville de Butare. Par pudeur, elle n’a jamais souhaité que l’on se rende chez elle. À l’intérieur du mémorial de Murambi, les baraquements, ceux qui ont accueilli des milliers de réfugiés, s’alignent les uns derrière les autres. L’armée française s’y est installée en juillet 1994 pour sécuriser le lieu en proie à des incursions de miliciens hutu. Le génocide touchait à sa fin. « Il y avait des tranchées partout, tout autour du camp. Tous les bâtiments étaient pleins de réfugiés. On y emmenait beaucoup de blessés découpés à la machette, qui avaient perdu leur bras ou un autre membre. Et on les entassait dans les salles. On nous avait répartis par âge dans des salles de classe du camp. Salle 1, salle 2, salle 3 et ainsi de suite. Ils passaient dans les salles et choisissaient celles qu’ils voulaient. Ils nous appelaient : “Les Tutsi, venez par là !” Et on s’exécutait. Puis le moment est venu où les Français ont pris des femmes pour aller coucher avec elles. Rien ne se faisait à l’extérieur. Ils nous conduisaient dans une salle à côté de leur campement, pour nous y violer. Ils nous ordonnaient de nous mettre à quatre pattes ou de mettre les jambes en l’air. Et on s’exécutait. »
En 2004, dix ans après la fin de la tragédie, Ibuka, l’association des rescapés du génocide des Tutsi, a pris connaissance de témoignages de femmes qui affirmaient avoir été victimes de violences physiques et sexuelles de la part de militaires français de l’opération « Turquoise ». Ces femmes ont alors souhaité porter plainte contre les auteurs de ces sévices.
Pourquoi ? La crainte de la prescription a pu être un élément déclencheur porté à la connaissance des plaignantes. Mais n’est-ce pas simplement une normalité de demander justice, et peu importe quand la demande est formulée devant la justice ?
Une commission citoyenne composée de l’ancien médecin humanitaire au Rwanda, Annie Faure, et de l’écrivain et survivant Vénuste Kahimaye a recueilli alors ces plaintes et les a portées à la connaissance d’avocats à Paris. Celles-ci ont fini par être reconnues en 2010 par le parquet et ont donné lieu à l’ouverture d’une instruction auprès du tribunal aux armées de Paris. Elles ont été ensuite requalifiées au pôle génocide et crime contre l’humanité du tribunal de grande instance (TGI) de Paris. Dans le cas d’un génocide, il n’y a pas de prescription. Concessa et Marie-Jeanne nous ont toutes les deux raconté qu’elles avaient été stigmatisées et désignées comme Tutsi par plusieurs soldats français. L’appellation même de Tutsi faisait partie selon elles du quotidien du camp de réfugiés de Nyarushishi.
Concessa a été entendue à Paris en décembre 2011 par le juge Frédéric Digne en présence de l’avocate Laure Heinich-Luijer, au tribunal aux armées de Paris.
Marie-Jeanne a été auditionnée deux années plus tard, en novembre 2013, au Rwanda dans le cadre d’une commission rogatoire internationale. Cette première audition de Marie-Jeanne a été conduite par Emmanuelle Ducos, alors vice-présidente du TGI, chargée de l’instruction.
Les témoignages

La maison blanche est encore debout. Elle ne passe pas inaperçue dans le paysage, perchée au sommet de la colline. La vieille bâtisse coloniale est devenue une école. Le directeur nous l’a ouverte. Nous avons mené nos entretiens dans son bureau. Elles et nous, face à face pour ces entretiens. Nous sommes dans deux mondes que tout sépare, rien ne peut combler l’écart de nos vécus, même pas l’imagination. Vingt-huit ans après le dernier génocide du xxe siècle, rien n’est terminé. Pour les survivantes face à nous, il y a un début au génocide, une date, celle du 7 avril, mais il n’y a pas de fin à proprement parler. Le deuil est interminable, le traumatisme, infini, les survivantes, inconsolables. « Nous avons vécu, nous sommes morts, nous avons survécu, puis nous devons vivre. » Ces paroles d’Esther Mujawayo, sociologue et psychothérapeute, rescapée du génocide des Tutsi au Rwanda (et autrice de SurVivantes, éd. de l’Aube, 2004), nous montrent qu’il est impossible d’établir une temporalité. Le temps des survivants n’est plus celui des vivants.
Marcher sans s’arrêter, se cacher dans les marais, faire le mort sous un amas de cadavres, assister au meurtre de ses proches, à l’humiliation, à la destruction de la filiation, auxquels il faut ajouter la perte de dignité : le viol. Marie-Jeanne a démarré son récit par un souvenir, celui de son entrée en classe de primaire : « J’ai commencé l’école à 7 ans. Trois mois après la rentrée, l’instituteur a fait l’appel en classe. Il nous a demandé de nous lever. “Toi, la fille d’untel, mets-toi de ce côté. Toi, le fils d’untel, tu vas de l’autre côté !” Il connaissait tous les parents. Il séparait les élèves tutsi des élèves hutu. Nous n’étions que des enfants, nous ne comprenions pas. Mais eux savaient. En classe, il privilégiait toujours les enfants hutu. Si l’un des élèves tutsi avait le malheur de faire du bruit, il était sévèrement puni. » Elle a choisi de raconter l’origine du mal : la ségrégation.

Concessa a entamé son récit par un souvenir similaire de ségrégation. « Avant que le génocide commence, il s’est passé une chose inhabituelle. Les autorités marquaient nos portes et prétendaient que c’était un recensement. Telle maison était marquée, comme celle de Sebahinzi, un agriculteur, donc un Hutu. Plus loin, une autre était marquée, Sebatunzi, un éleveur, donc un Tutsi. Ils écrivaient Sebatunzi, éleveur, ou tout simplement Tutsi. » Être vivante, pour Concessa, c’est témoigner. C’est donc se confronter au passé. C’est retraverser la nuit noire face aux incompréhensions et à l’incrédulité de ses interlocuteurs. Quand Concessa raconte un premier viol par un médecin hutu devenu un tueur, elle nous dit combien, après ce traumatisme, il n’y a pas de retour à la normale.
« Nous changions de cachette chaque nuit. J’ai croisé un homme qui travaillait à l’hôpital. Il s’appelait Jean-Marie. Il était avec quatre autres miliciens hutu. Il s’est allongé sur moi en me disant qu’il allait me faire des choses que je n’oublierais jamais. Il a sorti de la poche de sa salopette une barre de fer, il me l’a enfoncée entre les jambes, j’ai serré mes cuisses. Je continuais à serrer les jambes de douleur. Les autres miliciens lui ont dit que c’était bien trop cruel. Que s’il était incapable de me pénétrer avec son sexe, il valait mieux me laisser. » Ainsi, durant ce génocide, des femmes tutsi étaient éventrées, des bébés arrachés du corps maternel et exposés aux yeux de tous. Les femmes étaient violées à coups de pieux et de crucifix. Rien n’était caché, tout était exposé publiquement, il s’agissait de regarder ce qu’on n’a jamais vu, le sexe, le trou d’où l’on vient.
Le viol par les miliciens hutu a constitué une manière spécifique d’avilir et d’exterminer la communauté tutsi pendant le génocide. Après ce viol, Concessa marche pour échapper aux tueurs. Miraculeusement, elle croise des miliciens et des gendarmes à qui elle explique que son fils est celui d’un gendarme hutu. Elle ment et réussi à convaincre des tueurs de la laisser partir. Elle finit par rejoindre le stade de Cyangugu où sont réfugiés des Tutsi encerclés par des miliciens. Des bus publics escortés par la Croix-Rouge viennent chercher des réfugiés pour les emmener dans le camp de Nyarushishi.
Concessa poursuit son récit : « Les Français savaient identifier les tentes et leurs occupants. Ils s’intéressaient à celles occupées par les belles filles. On les entendait passer à côté de nos tentes, accompagnés de leurs traducteurs. Tu entendais parfois : “Concessa habite ici, Jacqueline habite là-bas”, et ainsi de suite. La nuit, pendant qu’on dormait, ils circulaient dans les allées avec leurs traducteurs. Après t’être couchée, parfois tu entendais quelqu’un toquer sur ta tente. Et quand tu te levais, tu te retrouvais face à face avec un soldat français armé d’un fusil. Il te faisait signe de te lever. Nous, nous avions peur. Un soldat armé au-dessus de ton lit. Il y en a un qui a levé la couverture, m’a pris la main et m’a sortie de la tente. Je me suis retrouvée avec trois autres militaires qui attendaient dehors. Et là, ils m’ont emmenée. J’ai été plaquée au sol par l’un d’entre eux. Ils prenaient des photos, et les photos sortaient instantanément de l’appareil. Un soldat me photographiait nue, et un autre était en train de me violer. Ça ne s’arrêtait pas ; le lendemain, ça recommençait. »
La transmission

Rencontrer Jeannette et Délice fut troublant. À vingt-sept ans d’intervalle, elles nous renvoyaient une image en miroir de leur mère, de ce qu’elles étaient ou qu’elles auraient pu être. Comme plus de 60 % des Rwandais aujourd’hui, Jeannette et Délice sont nées après le génocide. Pour cette seconde génération qui n’a pas vécu la persécution, l’expérience génocidaire est un héritage auquel elle ne peut échapper. Pour autant, la transmission s’effectue différemment dans chaque famille. Entre Concessa et Délice, il y a une incapacité de la mère à parler de son histoire à sa fille :
« En principe, mes enfants devraient connaître la vérité. Mais il est difficile d’aborder le viol avec eux. C’est très compliqué, je ne sais pas par où commencer. C’est un sentiment de honte que l’on ressent. Dire à ses enfants qu’on a été violée par plusieurs hommes… Ils pourraient penser que je suis une espèce d’animal. J’ai peur de leur réaction. »
Peur d’autant plus justifiée que Concessa a déjà subi un abandon pour avoir raconté son histoire : « Le père de mes enfants m’a quittée quand il a su que j’avais été violée par des militaires français. Il m’a reproché de le lui avoir longtemps caché. Il n’a pas supporté que cela se sache autour de nous. Il m’a dit : “Reste avec tes histoires de Français !” Et il est parti. Je vis avec cette peine. »
De son côté, Délice cherche à connaître l’histoire de sa mère. C’est elle qui a souhaité l’accompagner à Nyarushishi et, pendant le voyage, elle semblait particulièrement attentive à la parole des autres femmes, comme une tentative d’en savoir plus sur elle-même : « Ma mère n’est pas le genre de personne à qui je peux parler facilement du passé. Ceux qui ont vécu cette époque ont vraiment souffert, et je ne peux pas lui demander : “Chez toi, vous étiez combien ? Comment sont morts ?” Les victimes se referment vite sur elles-mêmes. Les survivants du génocide sont traumatisés. Ils gardent leurs émotions pour eux. Quand elle en parle avec ses amies, j’en profite pour apprendre des choses. Elle s’ouvrira à moi quand elle se sentira prête. Il ne faut pas la brusquer. C’est déjà bien qu’elle m’ait laissée voir le lieu de son calvaire. »

À l’inverse, Marie-Jeanne transmet son histoire à sa fille et souhaite retourner à Nyarushishi pour y emmener Jeannette. Lors du voyage, Jeannette est plus en retrait, décide de ne pas suivre sa mère lorsque celle-ci se dirige vers la forêt, sur les lieux de son viol, laissant la place à Délice, qui soutiendra Marie-Jeanne lors de son témoignage devant la caméra. Après le voyage, une fois de retour à Kigali, Jeannette se confiera à nous :
« J’ai enfin vu cet endroit dont elle me parlait. J’ai enfin pu mettre des images sur tout ce qu’elle m’a raconté. Quand elle m’en parlait, je pensais parfois qu’elle exagérait. En me rendant sur place, j’étais tellement émue que j’ai compris toute sa souffrance. Avant, c’était difficile pour nous de vivre avec ses blessures. Chaque année, quand les commémorations approchaient, elle ne nous parlait pas, ne s’occupait plus de nous. Elle pouvait rester au lit pendant des jours, sans nous adresser la parole et sans manger. Avec le temps, elle a accepté de vivre avec ce passé. Elle nous parle. Je suis contente d’avoir fait ce voyage. »
Face à l’interminable deuil de leur mère, ces jeunes femmes tentent de trouver leur place et leur propre mode d’expression. Avant notre départ, Jeannette a tenu à nous lire une lettre destinée à sa mère : « Maman, je t’écris pour te remercier. Tu n’as jamais cessé de t’occuper de moi. Je suis très fière de t’avoir pour mère. Je te confie à Dieu, lui seul peut te redonner la joie de vivre. Tu as mené beaucoup de combats pour moi. Je le sais, et je t’en suis reconnaissante. »
Jeannette et Délice sont nées dans un pays en cendres et sans repère. Peuvent-elles croire au slogan « plus jamais ça », tant de fois répété avant le génocide des Tutsi ? Aujourd’hui, elles sont devenues, malgré elles, dépositaires du traumatisme de leur mère.
Et maintenant…

On dit que libérer la parole des victimes permet de faire en sorte que la honte change de camp. Lorsque nous avons rencontré les femmes, elles souhaitaient rester anonymes, car apparaître à l’image comportait le risque de subir une réprobation sociale. Après plusieurs mois de discussions, une confiance s’est instaurée entre elles et nous. Faisant preuve d’un courage extraordinaire, elles ont accepté de témoigner à visage découvert et d’assumer le regard de leurs familles, de leurs voisins, de la société et, par-dessus tout, de leurs bourreaux. Durant le tournage du film, il nous est apparu que, pour la victime, la parole était essentielle pour atténuer une solitude pesante. Au terme de notre voyage, chacune a témoigné avoir ressenti un soulagement à partager son histoire et à écouter celle des autres.
Nous avons également pris conscience qu’à travers leurs parcours, ces femmes nous offraient une compréhension précise des mécanismes génocidaires, avec leur mise en place, leur exécution et leurs répercussions dans le présent. En ce sens, elles nous ont offert des témoignages pour l’histoire, précieux pour les générations futures.
Aujourd’hui, Prisca, Concessa et Marie-Jeanne poursuivent leur vie, élevant seules leurs enfants dans des conditions précaires. Lorsqu’on leur parle d’un procès, elles disent l’attendre sans trop y croire. Plus de dix ans que l’instruction est au point mort au TGI de Paris, et le récent rapprochement diplomatique entre la France et le Rwanda n’y a pour l’instant rien changé.
Avec ce film, nous voulions donner un visage humain à ces femmes, rappeler au monde qu’elles existent, les sortir d’un anonymat qui semble arranger notre conscience de citoyens français. Lors du tournage, nous avons souvent ressenti un profond malaise, car non seulement nos politiques se sont compromis au Rwanda en collaborant avec un régime génocidaire, mais ce que nous révélaient ces femmes à propos des soldats français s’apparentait à des accusations de viols systématiques, reconnus comme crime contre l’humanité selon l’article 3 du statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda.
On sait précisément aujourd’hui (grâce aux notes diplomatiques, aux notes de la direction des renseignements militaires et de la direction générale de la sécurité intérieure) que la feuille de route donnée aux responsables militaires nommait clairement le Tutsi comme l’ennemi, en faisant volontairement ou non la confusion entre l’organisation du Front patriotique rwandais (FPR) exilé en Ouganda et les Tutsi. C’est dans ce contexte que se déroulent les faits que dénoncent Prisca, Marie-Jeanne et Concessa.
En ce sens, notre film est aussi une demande de justice, un appel urgent à la tenue d’un procès pour que nos compatriotes connaissent la vérité sur le rôle et le comportement de leur armée durant l’opération « Turquoise ». Déjà interrogés, des responsables militaires ont répété qu’il n’y a jamais eu de viols de Rwandaises par des militaires lors de cette opération et que, au pire, « un soldat a peut-être déconné ». Les faits sont trop graves pour que nous attendions encore. Concessa exprime le mieux ce sentiment : « Seule la justice peut m’aider à surmonter ma douleur et à reconnaître officiellement ma souffrance. Quand j’y pense, ça me fait mal au cœur. Je ne comprends pas pourquoi il ne se passe toujours rien, alors qu’il y a encore des témoins. Les témoins directs existent. »
Le film Le Silence des mots est toujours visible sur arte.tv.