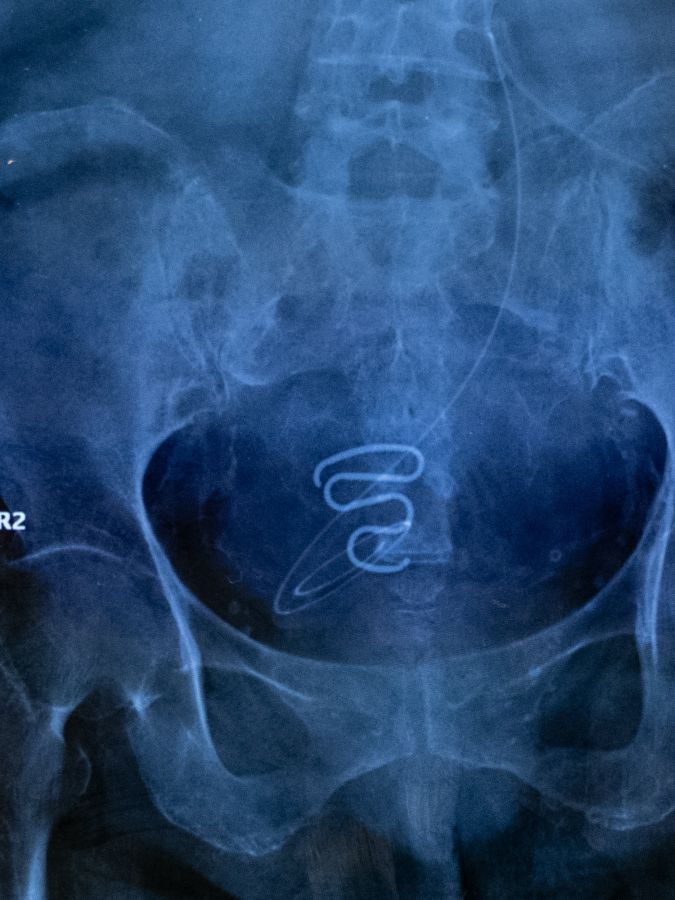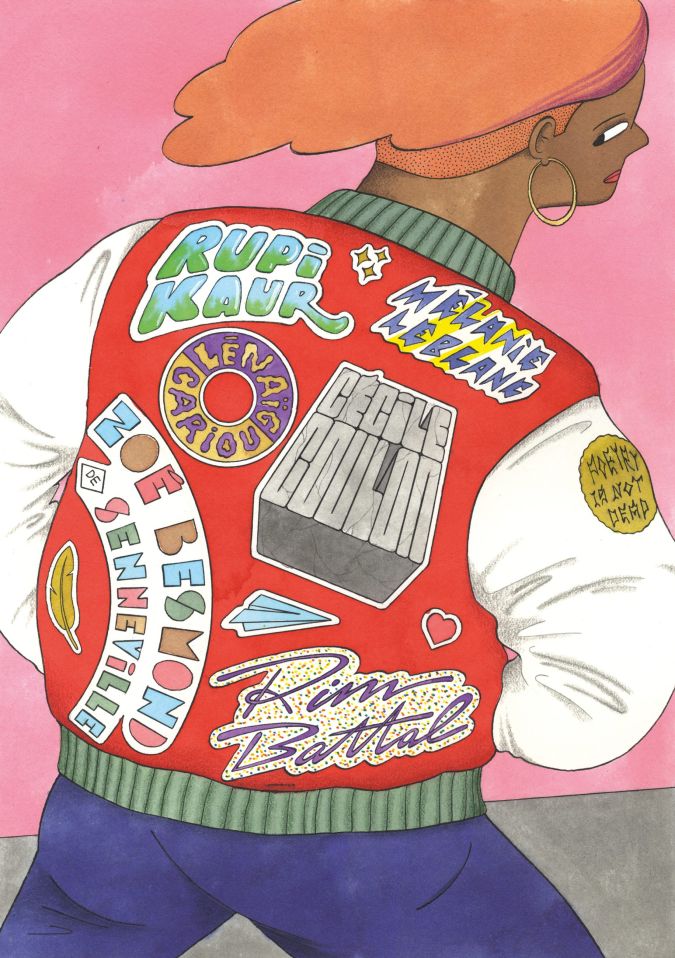C’est une des intellectuelles françaises contemporaines les plus admirées et les plus écoutées. Son mari, Robert Badinter, est entré dans l’histoire en faisant voter l’abrogation de la peine de mort en 1981. Elle est la principale actionnaire du troisième groupe de communication du monde, Publicis. Quatorzième fortune de France, elle vient de rejoindre le club des milliardaires en dollars.
Pas le profil type de la rebelle, plutôt une femme au cœur du pouvoir. Mais aussi une institution respectée, ce que résume la romancière Christine Angot : « Élisabeth Badinter ? C’est Madame Propre. »
Sur le voile, la prostitution, la parité ou la maternité, sa voix porte. Elle défend inlassablement les valeurs républicaines, universalistes et laïques, sans crainte de déplaire, au point de se considérer À contre-courant, selon le titre d’un beau portrait télévisé réalisé par Olivier Peyon. Intellectuelle, femme de convictions, elle refuse d’apparaître dans le Who’s who – « trop élitiste », a-t-elle déclaré au Herald Tribune. Elle est pourtant dans la lignée d’une élite bien française.
D’abord, ce sont des yeux, d’un bleu limpide, un regard à la fois attentif, aigu, et lointain – comme protégé par un voile de transparence. Transparent aussi, d’une neutralité cossue, le vaste hall d’entrée de l’appartement familial. L’accueil d’un cabinet dentaire chic, n’était, à bien y regarder, les prestigieuses signatures de peintres contemporains au bas des tableaux. Une manière non ostentatoire d’être riche, dit avec admiration son amie, la philosophe Élisabeth de Fontenay. Ou plutôt la vraie richesse, celle qui n’a rien à prouver, rien à montrer ? Chez les Badinter, le décor, le matériel, cela n’a pas beaucoup d’importance – pas plus que les mondanités et les plaisirs de la gastronomie. La frugalité de leur table semble avoir marqué ceux qui l’ont pratiquée…
Je suis horrifiée par la mixité du personnel et des idées, l’étalage du moi, la transparence.
Élisabeth Badinter
On me l’avait dit : « Si tu es sérieuse et déterminée, elle te parlera. » Après des mois d’un examen de passage courtois mais serré, épreuves écrites et orales comprises, Élisabeth Badinter accepte l’idée d’un portrait intellectuel. Intellectuel stricto sensu, pas question d’aller plus loin.
L’un des slogans les plus marquants des féministes de sa génération était : « Le privé est politique. » Elle trouve la formule dévoyée : « Je suis horrifiée par la mixité du personnel et des idées, l’étalage du moi, la transparence. » Elle, qui a consacré trois épais volumes à la psychologie des philosophes du XVIIIe siècle, tient à laisser la sienne de côté. Elle en est convaincue : « L’expression des idées suffit. » Quand elle s’étonne de ne pas avoir été interrogée sur son mari, c’est pour ajouter aussitôt qu’elle n’aurait pas répondu à mes questions.
La ligne de démarcation ? Publicis. Le groupe « relève de ma vie privée et n’a rien à voir avec mon activité intellectuelle », m’écrit-elle, lapidaire. Pas question de frayer en territoire interdit, donc. Inutile aussi d’espérer rencontrer Maurice Lévy, le PDG de Publicis depuis 1987, avec lequel Élisabeth Badinter collabore directement depuis qu’elle préside le conseil de surveillance de l’entreprise. Le verdict implacable de la patronne annule l’accord de principe qu’il avait donné à une demande de rendez-vous.
Loin, très loin de la femme d’affaires
Vie privée, hors champ intellectuel, le troisième groupe de communication du monde ? Une société présente dans 109 pays, comptant près de 54 000 collaborateurs ? Qui intervient dans le numérique, la publicité, la communication institutionnelle, l’événementiel, l’achat d’espace média et la communication spécialisée ? Une société rentable, dont en 2011 le résultat net était en progression de 14 % ? Et qui, cette même année, a rapporté 14 millions d’euros de dividendes à la famille Badinter ? De cela, elle ne veut pas parler. Élisabeth Badinter n’est pas Publicis, Publicis n’est pas Élisabeth Badinter.
Elle en impose sans être crâne, réfute les objections sans céder un pouce sur le fond.
Loin, très loin de l’inatteignable femme d’affaires, Élisabeth Badinter est l’intellectuelle qui a posé un autre regard sur la maternité dans L’Amour en plus, publié en 1980. Provocatrice, elle n’y va pas par quatre chemins : pour elle, l’instinct maternel n’existe pas, tout amour est construction. L’affirmation choc s’appuie sur un retour vers le XVIIIe siècle, époque à laquelle la vision rousseauiste s’impose et enferme la femme dans un rôle forcément, naturellement maternant.
Succès considérable, vendu à 400 000 exemplaires, L’Amour en plus marque les esprits. Le livre, et l’apparition de la superbe blonde qui le personnifie, un soir de mai, sur le plateau d’Apostrophes – incontournable rituel culturel de la télévision publique des années 1980 : l’assurance posée, le sourire lumineux, Élisabeth Badinter est rayonnante. Dominant implacablement les autres invitées, qui lui reprochent sa raideur dogmatique, elle en impose sans être crâne, réfute les objections sans céder un pouce sur le fond. « Élisabeth est d’une beauté exceptionnelle, elle a de la transcendance », dit son amie Élisabeth de Fontenay.
L’ouvrage provoque un tollé. On l’accuse de nier l’amour maternel, on l’associe à son maître à penser, Simone de Beauvoir, on lui attache le même stigmate de sécheresse cérébrale… Il y a eu malentendu, dit-elle aujourd’hui : « Je plaidais pour l’amour comme liberté plutôt que comme obligation morale ou nécessité biologique, ça n’a pas été perçu comme ça. » Lors de son unique rencontre avec Beauvoir, Élisabeth Badinter se souvient avoir demandé avec insistance à l’auteur du Deuxième Sexesi elle n’avait jamais eu envie d’être enceinte. « Pour la plupart des femmes, c’est une expérience incroyable. Je n’arrivais pas à croire qu’elle n’en ait jamais rêvé une fois, une nuit. »
Élisabeth Badinter refuse d’évoquer son histoire personnelle. Mais aurait-on écouté ses interrogations sur l’amour maternel si elle n’avait pas été une mère de famille ? Anne Sinclair, qui la considère comme une sœur, se souvient de leurs échanges dans les années 1970 et de la genèse du livre : « Nous avions le même sentiment sur le fait d’être mère : c’est difficile, c’est parfois un échec. On fait ce qu’on peut mais, par définition, on ne fait jamais assez bien. »

« Une révision déchirante »
Au-delà des polémiques, L’Amour en plus est un tournant. « Ce livre a eu une influence majeure : en levant une idée qui reste dans la mémoire collective, en affirmant que les mères ne sont pas coupables, elle a libéré une attente très profonde », résume une amie fidèle, la psychanalyste Élisabeth Roudinesco. Grâce à elle, toute une génération accepte mieux ses contradictions. Chouchoute de la presse, elle est sacrée porte-parole des femmes, incarnation d’un regard féministe libre et nécessaire.
Élisabeth Badinter se présente aujourd’hui comme « une petite dame qui n’a pas envie qu’on la remarque » et reçoit de la façon la plus urbaine qui soit, autour d’un thé, en fumant sans discontinuer – cartouches de Marlboro Lights alignées sur un rayonnage de la bibliothèque. Elle a une intense capacité d’écoute, et dans son puissant regard bleu, une insaisissable, profonde tristesse. De celle-ci, on ne dira mot – le privé, toujours. Les souffrances, on les garde pour soi.« Never complain, never explain », répètent ses proches.
Je ne supporte pas que mon point de vue ne soit pas exprimé. Alors si je ne l’entends pas, je le donne.
Élisabeth Badinter
Ce qui la fait sourire ? La lecture, qui est « comme le plaisir physique », a-t-elle déclaré au Monde. Le XVIIIe siècle, où elle se sent chez elle. Quand elle évoque ses philosophes favoris, Condorcet et d’Alembert, ou le travail de recherche dans les archives, son visage s’éclaire.
Son XVIIIe siècle est celui des Lumières, triomphe de la pensée libre, de l’échange intellectuel, rationaliste et progressiste, une époque qui à ses yeux fonde la nôtre. Après de nombreux livres, dont les trois volumes des Passions intellectuelles, elle en donne pourtant une toute autre vision dans un bref ouvrage, L’Infant de Parme, publié en 2008.
Biographie de Ferdinand de Parme, c’est le récit poignant d’une éducation ratée sous l’égide des meilleurs pédagogues du XVIIIe siècle. La transmission des idéaux de l’époque s’avère un échec, le « pauvre prince » reste un bigot sans envergure. À la sortie du livre, elle confie ses doutes au magazine Lire : l’éducation est « peut-être une illusion, comme l’instinct maternel ». Ce fut « une révision déchirante », me dira-t-elle. Sous la plume de l’historienne, la tristesse d’Élisabeth Badinter est émouvante.
Pas d’émotions personnelles, en revanche, lorsqu’elle se fait essayiste, et intervient dans les grands débats de société. « Je ne supporte pas que mon point de vue ne soit pas exprimé. Alors si je ne l’entends pas, je le donne », explique-t-elle.
Farouchement attachée aux valeurs de la laïcité, elle fut une des premières à s’élever contre le port du voile à l’école, en 1989. Depuis, elle ne lâche rien. Quand l’hebdomadaire Charlie Hebdo est attaqué pour avoir publié des caricatures de Mahomet, elle n’hésite pas un instant, plaide pour la liberté de critiquer la religion. Elle qui redoute la passion, qu’elle décrit comme une « perte de contrôle terrifiante », a alors « défendu la raison avec passion », affirme son ami Richard Malka, le médiatique avocat de Charlie Hebdo et de Dominique Strauss-Kahn : « Sa parole d’intellectuelle donne à d’autres le courage de s’exprimer. Elle est un glaive et un garde-fou. » Pour l’essayiste Caroline Fourest, « elle est une des grandes vigies de la République ».
Avec Robert, « le dialogue incessant »
Elle-même juge que ses principaux combats ont été perdus. Sollicitée en 2012 par les étudiants de Sciences Po Rennes qui ont choisi de baptiser leur promotion du nom de « Badinter », elle leur livre un message sévère : « Battez-vous, ne cédez pas, la vie va être difficile. » Pas de quoi festoyer à la remise des diplômes… Même Robert Badinter, qu’elle juge pourtant plus guerrier qu’elle, a un mot de remerciement plus chaleureux et plus encourageant.
La source de ses engagements, dit-elle, tient en un principe de Tocqueville, selon lequel « c’est ceux qui ont le moins à souffrir de l’injustice qui la supportent le moins ». À l’entendre, l’altruisme serait un instinct naturel chez les privilégiés, cette aristocratie à laquelle elle appartient. On lui rétorque que la chose n’est pas si fréquente et que les racines du sentiment d’injustice sont souvent plus personnelles. Elle l’admet ; personnelles, donc : domaine réservé.
Elle se décrit cependant volontiers comme fille de son père et femme de son mari. Récemment interrogée sur France Inter au sujet de la prostitution, elle s’est d’abord fermement attachée à défendre « la liberté des femmes qui veulent se prostituer sans y être forcées par un tiers » au motif que les « pulsions » ne sauraient être réprimées et que le sexe n’est pas forcément désiré. Puis, l’interview a dévié sur la longévité du couple Badinter, plus de quarante-cinq ans de vie commune. Pour une fois, la dogmatique Élisabeth a joué le jeu : « Plus on vit ensemble, plus on s’aime… Un couple qui dure, c’est un dialogue incessant, le dialogue des cœurs et des corps. » Élisabeth Badinter, une Madame Tout-le-monde libertaire : c’est sa marque de fabrique.
L’histoire veut que sa première rencontre avec Robert date du jour de ses 12 ans. Parmi les invités : Badinter, de seize ans son aîné, avocat très jet-set du père d’Élisabeth, bientôt l’époux d’une actrice brièvement en vogue, Anne Vernon. Quelques années plus tard, elle a 22 ans, lui 38, ils se croisent par hasard : coup de foudre, divorce, mariage, et trois naissances en trois ans et demi.
Elle improvise. Et pourquoi pas l’histoire de l’amour maternel ? Ce premier séminaire sera la source de « L’Amour en plus ».
Les années 1970 sont celles du combat contre la peine de mort. Robert Badinter est l’avocat des grands procès, le défenseur des accusés qui risquent la guillotine : Roger Bontems, Patrick Henry, Michel Bodin, Mohamed Yahiaoui ou encore Michel Rousseau. Elle assiste aux jugements, vient chercher son mari au petit matin lorsque le client, condamné, est exécuté. Avec lui, elle endure une opinion publique souvent violente, reçoit menaces et lettres anonymes. En 1976, une bombe artisanale est déposée devant leur domicile. Il est absent, elle dort profondément, les enfants, réveillés, seront éloignés quelque temps. Elle évoque avec sérénité cette période, mais lorsqu’elle parle de combats et déclare à la radio qu’« aimer, c’est vouloir aider », ces souvenirs sont présents.
Au début des années 1970, elle « choisit d’enseigner à mi-temps pour concilier [son] métier et [son] rôle maternel ». Elle reste cinq ans professeur au lycée de Limeil-Brévannes, apprécie son travail, mais ne se voit pas le poursuivre indéfiniment. Heureux hasard, en 1977, Robert Badinter croise le directeur de l’École polytechnique, qui souhaite féminiser le corps enseignant, et lui suggère le nom d’Élisabeth. Elle enseignera à Polytechnique pendant vingt-six ans. C’est une école militaire, aussi elle propose d’abord un cours sur la stratégie au XVIIIe siècle. Réaction mitigée… Elle improvise : et pourquoi pas l’histoire de l’amour maternel ? Ce premier séminaire sera la source de L’Amour en plus.
Quand le livre est publié en 1980, Robert Badinter, champion de la suppression de la peine de mort, est selon les camps un héros ou un homme à abattre. Un an plus tard, nommé ministre de la Justice par François Mitterrand, il fait de l’abolition une des premières lois de la gauche tout juste arrivée au pouvoir. Ami indéfectible du Président, familier, avec Élisabeth, du couple officieux qu’il forme avec Anne Pingeot, Robert Badinter est la caution morale de Mitterrand. Nommé en 1986 à la présidence du Conseil constitutionnel, il évite de voir son image ternie par la fin de règne et retrouve en 1995 un siège de sénateur… en évinçant la sortante, Françoise Seligmann. Badinter est alors « figé dans la cire », écrira un peu plus tard Philippe Lançon, journaliste à Libération.

Femme, « femme de… » et aussi « fille de… »
Avec lui, le couple devient une institution. Proches ou moins proches, beaucoup ont un soupir d’admiration en évoquant les Badinter « couple exceptionnel », « modèle de rigueur intellectuelle », « incarnation de la persévérance et du respect de la liberté »…
Badinter, un label ? Elle évoque le bonheur d’avoir travaillé ensemble à la biographie de son héros, Condorcet, intellectuel engagé, chantre des droits de l’homme et de l’égalité entre les sexes, époux de la remarquable Sophie, de vingt ans plus jeune que lui. Publié en 1988 sous la double signature d’Élisabeth Badinter et de Robert Badinter, l’ouvrage tient lieu de récit familial. Le couple qui le présente sur les plateaux de télévision est beau, brillant, harmonieux. Robert, courtoisie oblige, passe la parole à Élisabeth, et dans les sourires qu’ils échangent, c’est bien un peu de privé qui s’expose – l’amour.
Si féministe soit-elle, Élisabeth Badinter a choisi d’adopter le nom de son mari. « Attachée à l’universalisme, elle qui ne parle jamais en tant que femme parle toujours en tant que “femme de” », note le sociologue Éric Fassin, professeur à l’université de Paris 8. Pour la psychanalyste Élisabeth Roudinesco, qui observe avec attention la réception publique de son amie depuis ses débuts, l’autorité, voire la raideur qui se dégage du couple en a imposé auprès du grand public. Et puis, dit-elle, « Robert a dû jouer un rôle dans le fait qu’elle raisonne beaucoup en droit. »
La saga Bleustein-Blanchet se confond avec la phénoménale ascension de la publicité en France : il invente la communication, importe les sondages, révolutionne la pub et le marketing politique…
Avant d’être « femme de… », Élisabeth Badinter est d’abord « fille de… » son père, Marcel Bleustein-Blanchet, juif de Barbès, marchand de meubles à 13 ans et génial créateur de l’agence Publicis à 20 ans, en 1926. La saga Bleustein-Blanchet se confond avec la phénoménale ascension de la publicité en France : il invente la communication, importe les sondages, révolutionne la pub, le sponsoring et le marketing politique… Millionnaire à 25 ans, il se lance dans la radio, mais l’aventure tourne court, et dans les années 1930, c’est la ruine. Après avoir fait la bringue en compagnie des plus séduisantes créatures de l’époque, il épouse la belle Sophie Vaillant, mannequin haute couture et petite-fille d’Édouard Vaillant, communard puis leader du socialisme français des années 1900.
La guerre venue, Bleustein s’engage aux côtés de la Résistance. Il est absent le jour où sa femme, enceinte de leur deuxième fille, Élisabeth, est convoquée par la Gestapo… Par prudence, l’enfant sera enregistré sous le nom de Vaillant, et il faudra de longues procédures à Marcel Bleustein-Blanchet pour faire inscrire sa famille sous son double nom de naissance et de résistant.
Après la guerre, Publicis repart de zéro. Publicis ou les Trente Glorieuses mises en images et en musique. Années pub, années Dim, années fun, la consommation est joyeuse, l’avenir synonyme de progrès, la croissance spectaculaire. Le « lion » – logo qu’il s’est choisi – fréquente et reçoit tout ce qui compte dans les affaires, les arts et la politique. Pour les soixante ans du groupe, en 1986, une fête géante réunit « 1 000 amis » : le gratin politique, industriel, intellectuel et médiatique de Paris est présent.
Avant de faire d’Élisabeth une héritière, son père lui a transmis sa qualité maîtresse : l’ambition. Elle se revendique comme fille de « papa » plus que de celle qu’elle ne mentionne que comme « ma mère ». Des deux héroïnes de son livre Émilie, Émilie, Émilie du Châtelet et Louise d’Épinay, elle dit, comme en miroir, que « leurs pères leur ont donné le sentiment que tout était possible pour elles ».
Le quotidien, l’écoute, la complicité, les vacances : c’est papa. Sophie, la mère, semble à distance. Marcel est là, omniprésent en papa poule qui dorlote, écoute, admire et encourage ses trois filles, Marie-Françoise, Élisabeth et Michèle. Catholiques par leur mère, les sœurs vont à la synagogue avec lui et sont parmi les premières en France à faire leur bat-mitzvah, une cérémonie qui commence à peine à s’ouvrir aux filles.
Devenir soi-même, toute seule
Élisabeth Badinter vénère ce père génial, mais son monde n’est pas le sien, dit-elle. « Il fallait aller sur un terrain où il ne pouvait pas m’atteindre. Très tôt, je me suis dit : “Je ne veux dépendre de personne. Je serai professeur, fonctionnaire. Pour exister, faire ma vie à moi”. » On peine à imaginer l’héritière Publicis en employée de la fonction publique. Cette volonté de devenir soi-même, seule, comme si la détermination familiale et sociale n’existait pas, évoque le fameux « On ne naît pas femme, on le devient » de Simone de Beauvoir. Élisabeth Badinter a découvert Le Deuxième Sexe à 17 ans et, comme pour beaucoup de femmes de sa génération, ce livre a été un bouleversement. « Il m’a ouvert les portes de la prison. Je pouvais tout faire, vivre la vie que je voulais sans rendre de comptes à personne », explique-t-elle dans son portrait filmé.
Devenir ce qu’elle est, cela passe par la philosophie et l’agrégation. Les études, quelle idée ! Son père la juge saugrenue, mais sa confiance en elle est totale, il s’incline. À la même époque, les maternités s’enchaînent, et en janvier 1968, sa sœur aînée, Marie-Françoise, meurt dans un accident de voiture. L’inébranlable Bleustein-Blanchet s’effondre, Élisabeth s’accroche au concours. « Rien au monde n’aurait pu me faire renoncer à l’agrégation. » Déterminée, elle s’inscrit en cachette de sa famille, échoue trois fois, tient bon.
“Émilie, Émilie” est un très beau livre mais, scientifiquement, les travaux d’Élisabeth Badinter ne sont pas recevables. Plutôt que voir ce qu’il y a à voir, elle cherche à démontrer des idées reçues…
Éliane Viennot, spécialiste de l’Ancien Régime
Agrégée, Élisabeth Badinter affirme ne pas tenir au titre de philosophe qu’on lui associe en général, y compris sur le site du groupe Publicis. Elle préfère se dire « remueuse d’idées » et jubile en m’expliquant n’être associée à aucun domaine particulier : « C’est ma liberté, j’adore ça. Je choisis ce qui me convient pour nourrir ma réflexion, qui est partielle et partiale. J’ai une idée et je la nourris à partir de mon questionnement personnel… Je suis une idéologue. »
« Idéologue » ? Le mot fait s’étrangler les universitaires. Pour eux, l’idéologie est la somme des a priori qui s’opposent au travail intellectuel et à la recherche – loin, très loin de toute philosophie. « “Émilie, Émilie” est un très beau livre mais, scientifiquement, les travaux d’Élisabeth Badinter ne sont pas recevables. Plutôt que voir ce qu’il y a à voir, elle cherche à démontrer des idées reçues… », explique Éliane Viennot, spécialiste de l’Ancien Régime. La philosophe Geneviève Fraisse, qui a beaucoup travaillé sur l’exclusion des femmes au moment de la Révolution, va dans le même sens : « Partant de ses convictions sur la maternité, l’universalisme et le féminin, Élisabeth Badinter élabore des constructions théoriques. Je ne peux être qu’en désaccord avec une telle démarche. Elle incarne une forme d’intellectuelle généraliste, qui laisse de côté le travail épistémologique sur la question des femmes. »
Éric Fassin est encore plus précis : « Elle n’est pas assujettie à l’exigence empirique de vérité qui définit le monde universitaire. Elle a par exemple dénoncé les “quotas à l’américaine”, alors que les quotas sont contraires à la loi aux États-Unis. » Elle se situe ailleurs, souligne-t-il : « Un chercheur qui commettrait de telles erreurs perdrait toute légitimité. Pour Élisabeth Badinter, comme pour d’autres essayistes médiatiques, c’est sans conséquences. »
D’autres philosophes et féministes, comme Sylviane Agacinski ou Julia Kristeva, esquivent la discussion au sujet d’Élisabeth Badinter au motif qu’elles ne connaîtraient pas bien ses travaux – elles s’opposent pourtant sur de nombreux sujets depuis des années. Idem pour Judith Butler, célèbre théoricienne américaine du genre, pour laquelle Badinter confesse une grande admiration. Citée dans les médias anglo-saxons comme une figure majeure du féminisme français, Élisabeth Badinter est en effet « parfaitement ignorée des féministes américaines », affirme Joan Scott, professeur à l’université de Princeton et spécialiste de l’histoire intellectuelle de la France.
La rupture avec ses pairs
La rupture est irréconciliable : l’idéologie, qu’elle revendique comme une force créative, est précisément ce que lui reprochent ses pairs. Elle a pour elle de fortes intuitions, et elle « sait parler avec beaucoup plus de force et de clarté que beaucoup d’autres », note la sociologue Liliane Kandel. Elle-même assume pleinement d’utiliser ce qu’elle appelle « l’artillerie lourde » pour être comprise. C’est son arme de séduction massive et unedes clés du bon accueil que lui réserve le grand public – les femmes surtout, et plutôt en province, d’après elle. « Ma chance fut que l’époque est intellectuellement pauvre et qu’au royaume des aveugles, les borgnes sont rois… », a-t-elle déclaré au magazine Lire.
Les Français la plébiscitent. En 2010, quelques mois après la sortie de son dernier livre, Le Conflit, un sondage l’a placée en tête du hit-parade des intellectuels les plus influents, devant Jacques Attali, Luc Ferry, Jean d’Ormesson et Bernard-Henri Lévy. « Elle sort du lot de très loin », s’étonne encore Jérôme Sainte-Marie, directeur général adjoint de CSA, l’institut auteur du sondage. « Dans une telle étude, précise-t-il, influence signifie en réalité notoriété et préjugé bienveillant. Ce qu’Élisabeth Badinter écrit est abordable par un large public… et son patronyme suscite un préjugé favorable, voire une confusion. »
J’ai vu que son livre avait un impact important et qu’il déculpabilisait certaines femmes, mais je ne pouvais pas supporter qu’elle se soit appuyée sur des éléments qui ne tenaient pas scientifiquement.
Arlette Farge, historienne du XVIIIe siècle
Cette sympathie dérange ses confrères. Arlette Farge, historienne du XVIIIe siècle, évoque encore aujourd’hui son « infinie tristesse » à la sortie de L’Amour en plus : « Pour étayer son argumentation, Élisabeth Badinter cite le chiffre de 20 000 enfants abandonnés chaque année à Paris. Au même moment, j’étais aux Archives et je découvrais des centaines de témoignages poignants, des messages, des objets laissés dans les langes des bébés, montrant qu’on n’abandonnait pas les enfants par volonté ni indifférence, mais par misère. J’ai vu que son livre avait un impact important et qu’il déculpabilisait certaines femmes, mais je ne pouvais pas supporter qu’elle se soit appuyée sur des éléments qui ne tenaient pas scientifiquement. »
Élisabeth Badinter n’est pas insensible au manque de reconnaissance de ses pairs. « Les collègues sont vaches, tout particulièrement les femmes », me confie-t-elle. Mais elle s’est elle-même privée de la validation universitaire en refusant de soutenir une thèse, se souvient Élisabeth Roudinesco. Elle préfère travailler seule, garde un souvenir cuisant de plusieurs débats frontaux, les évite désormais. « Élisabeth Badinter critique les féministes mais connaît mal les travaux français dans ce domaine », s’étonne Janine Mossuz-Lavau, chercheur au CNRS. Elle admet aisément ne pas beaucoup s’intéresser aux théories des uns et des autres, préférant l’observation directe de ses contemporains.
Même chose pour le militantisme. Dans les années 1970, elle a brièvement milité, et été membre du bureau politique du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif). Depuis, rien. Féministe revendiquée, elle n’appartient à aucune association, ne descend jamais dans la rue. « Je ne suis pas une militante, mais une “révolutionnaire en chambre” », explique-t-elle. Aux salles houleuses et au travail de terrain, elle préfère la tempérance du tête-à-tête, l’échange privé façon salons du XVIIIe siècle. Son féminisme, elle l’exerce par médias interposés.
« J’ai un privilège inouï »
La méfiance est réciproque, ses collègues la sollicitent peu. Malgré son travail sur la maternité au xviiie siècle, elle ne figure pas au sommaire de la monumentale Histoire des femmes en Occident, publiée sous la direction de Georges Duby et Michelle Perrot. Son exclusion ne s’est pas faite sans heurts. « Le monde universitaire se protégeait », résume, amère, Élisabeth de Fontenay, qui avait proposé son nom.
Qu’importe, elle joue dans le club des intellectuels de masse. Elle dose ses apparitions médiatiques, sait qu’il ne faut pas lasser, mais a tribune ouverte dans la presse quand elle le souhaite. En 2010, à la sortie du Conflit, France Inter lui consacre une journée entière – du jamais vu ! Pendant les semaines qui suivent, la couverture médiatique est exceptionnelle. « J’ai un privilège inouï, me dit-elle, la possibilité de dire ce que je pense. Cette liberté est le grand acquis de ma vie d’intellectuelle… » Elle l’explique ainsi : « Il faut dire que j’interviens sur un terrain très public, pour m’opposer aux courants dominants. Cela plaît aux journalistes. »
Nous avons réussi l’exploit d’avoir en France comme figure de proue du féminisme une antiféministe, une femme qui pense que le problème du féminisme est la banlieue et l’Islam.
Mona Chollet, essayiste
Elle s’oppose, mais dérange-t-elle vraiment ? Après L’Amour en plus, ses thèses sur l’androgynie, l’indifférenciation des sexes et la disparition du désir n’ont pas retenu l’attention : pas très étayées, de l’avis général. Et elle va plutôt dans le sens de l’opinion avec ses rappels des grands principes universalistes et laïques appliqués à des questions de société, comme la prostitution, la gestation pour autrui ou le port du voile sur la voie publique. Elle célèbre un certain mythe nostalgique de la France comme berceau du progressisme démocratique : cela flatte l’orgueil national.
Non, Élisabeth Badinter ne dérange pas, s’insurgent de nombreuses féministes, bien au contraire. Auteur de Beauté fatale, un ouvrage dans lequel elle dénonce la marchandisation du corps féminin, l’essayiste Mona Chollet ne décolère pas : « Nous avons réussi l’exploit d’avoir en France comme figure de proue du féminisme une antiféministe, une femme qui pense que le problème du féminisme est la banlieue et l’Islam. »
En 1999, son refus intransigeant de la parité a été traduit comme une volonté de préserver le statu quo défavorable aux femmes. « Élisabeth Badinter persiste à maintenir la fiction selon laquelle les individus n’ont pas de sexe, alors que la différenciation sexuelle est la base de la discrimination exercée contre les femmes dans le monde politique », note l’Américaine Joan Scott dans un article sur le débat français. Depuis, elle déplore que la « femme victime » soit devenue « héroïne des temps modernes ». Là aussi, pour ses consœurs, elle se trompe de combat : « Se reconnaître comme victime quand on l’est, c’est justement le premier pas pour se battre ! », insiste Mona Chollet. « Élisabeth Badinter est déconnectée du réel, elle met toutes les féministes dans le même sac sans voir qu’au contraire beaucoup de femmes qui se battent sont d’accord avec elle. Résultat : au lieu de les aider, elle les méprise », souligne la porte-parole de l’association Osez le féminisme, Caroline De Haas.
Le tandem de Publicis
Simple jalousie, sempiternelle critique envers une féministe « bourgeoise » ? C’est l’avis de Liliane Kandel, qui connaît bien les conflits entre féministes : « Élisabeth Badinter a le sentiment qu’on ne l’aime pas, non pour ses idées, mais pour ce qu’elle est. Les féministes savent quand utiliser l’argument Publicis. Quand elle dit qu’il y a plus grave que la publicité sexiste, il y en a toujours une pour se scandaliser en renvoyant à ce que fait Publicis. »
Difficile, aux yeux de certaines, d’être l’actionnaire principale d’un groupe mondial de communication qui joue sur tous les stéréotypes, fussent-ils sexistes, tout en se revendiquant féministe. Mercedes Erra, féministe militante et présidente exécutive de l’agence Euro RSCG Worldwide, balaie la contradiction : « Le sexisme est plutôt le fait des médias, pas particulièrement de la publicité. On ne m’a jamais reproché d’être à la fois publicitaire et féministe ! »
Élisabeth Badinter assure n’avoir « aucune fonction opérationnelle chez Publicis ». Elle suit pourtant l’entreprise de très près. « Ensemble, le dirigeant que je suis et la principale actionnaire qu’elle est forment un vrai tandem », déclarait en 1998 à Libération le PDG du groupe, Maurice Lévy. Elle préside le conseil de surveillance de la société, dont sont également membres sa nièce, la productrice Sophie Dulac, et son fils Simon, animateur aux États-Unis de The Simon Rendezvous, une émission radiophonique – il y dispense ses conseils de Français sur les relations amoureuses. Benjamin, le plus jeune des Badinter, a été nommé en 2011 à la présidence du directoire de la branche médias de Publicis.
Attachée à l’égalité entre les sexes, Élisabeth Badinter n’a pas une vision aussi stricte de l’égalité des chances.
En maintenant le groupe dans le giron familial, en y plaçant ses deux fils, Élisabeth Badinter respecte à la lettre la volonté de Marcel Bleustein-Blanchet, lui qui redoutait plus que tout que Publicis perde son indépendance. L’intellectuelle classée à gauche sait gérer l’héritage familial : début 2012, elle a vendu des actions pour plus de 18 millions d’euros.
Attachée à l’égalité entre les sexes, Élisabeth Badinter n’a pas une vision aussi stricte de l’égalité des chances. Elle, qui a contesté la parité au motif que les femmes ne seraient plus jamais sûres d’être nommées « à tel ou tel poste par l’effet de [leur] compétence », a pris la tête de Publicis non « pas en raison de ses compétences, mais en vertu d’une loi, celle de l’héritage, qui assure aux enfants le droit de recevoir le legs parental, au lieu de laisser jouer la loi du plus fort », s’étonne l’historienne Éliane Viennot, qui se demande avec ironie : « Est-elle pour autant incompétente ? C’est ce qu’il serait hasardeux de dire avant de l’avoir vue à l’œuvre. »
Aux yeux de son père, Élisabeth Badinter était compétente, incontestablement. D’après son biographe, Marcel Germon, Bleustein-Blanchet plaçait sa fille sur le même piédestal que… Charles de Gaulle et Pierre Mendès France. Il « souhaitait conforter le pouvoir d’Élisabeth dans le groupe », confirmera Maurice Lévy.
« Madame Badinter »
La preuve : en 1970, Bleustein-Blanchet a appelé la holding familiale Somarel, comme Sophie, Marcel et Élisabeth, faisant ainsi de cette dernière la gardienne du temple, et sans inclure sa fille cadette. La relégation de Michèle Bleustein-Blanchet laissera des traces. En 1996, à la mort de son père, voyant qu’elle n’a pas sa place dans le groupe, elle demande à racheter ses parts. Mais l’offre de sa sœur, inférieure de 30 % au prix du marché, lui semble « inacceptable et perverse » et la famille se divise. La brouille est irrémédiable, le conflit impitoyable. Michèle Bleustein-Blanchet parle à Libération des « pratiques d’usurier » de celle qu’elle n’appelle plus que « Madame Badinter ». Deux ans plus tard, en 1998, un accord est finalement trouvé et Michèle Bleustein-Blanchet quitte le groupe avec son neveu, Nicolas Rachline.
Élisabeth Badinter, elle, se tait. Publicis, domaine privé. Publicis, pas touche. Préserver l’héritage familial et le vœu du père n’était pas discutable. Tout comme n’est pas discutable l’héritage des Lumières, idéal auquel elle s’identifie.
Depuis deux ans, elle est de nouveau plongée dans un vaste travail sur une des grandes figures féminines de son siècle de prédilection. Mais se dit prête à s’interrompre si l’actualité l’exige, comme elle l’a fait en juillet 2011 pour venir à la rescousse de Dominique Strauss-Kahn, le mari de son amie Anne Sinclair. À la radio et dans la presse, elle s’est élevée contre les « relents inouïs de moralisme » des attaques féministes à l’égard de DSK. Accusée de soutien amical, d’aveuglement réactionnaire, de solidarité de classe, elle a invoqué la régression moraliste, les libertés bafouées et le procès fait au genre masculin.
Femme laïque, femme de gauche, pas facile pour une héritière. Élisabeth Badinter a su convertir l’aristocratie de l’argent en aristocratie intellectuelle, et elle voudrait faire oublier qu’elle appartient toujours à la première. Progressiste à l’ancienne, à l’élégance si classiquement française, elle ne croit qu’aux grands principes issus d’un passé prestigieux, seuls viatiques d’un présent décevant. L’inaltérable XVIIIe siècle est son refuge, sa certitude, son confort. Élisabeth Badinter est d’un autre temps.