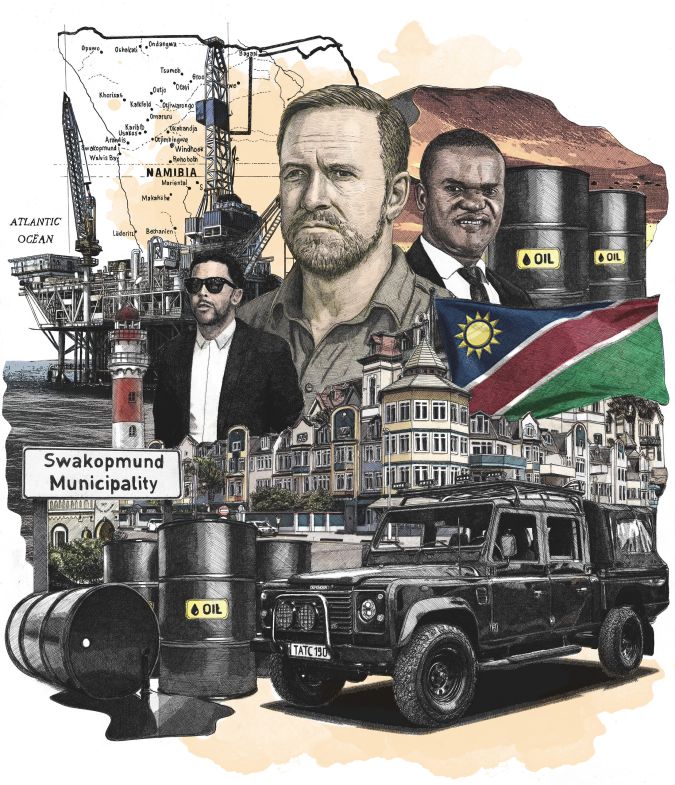« Que lisez-vous ? » Dans l’avion qui mène au Cap, ma voisine sud-africaine de retour d’un safari à Madagascar jette des coups d’œil insistants par-dessus mon épaule. En guise de réponse, je lui montre le livre : Jacob Zuma, une biographie. Sur la couverture, « son » président, crâne chauve, œil louche, chemise bleue bien repassée, prononce un discours, le poing levé. Ma voisine affiche son dégoût : « Eish ! Zuma ? Mais que pouvez-vous bien lui trouver d’intéressant à cet imbécile ? » Elle est déçue, je reste interloquée. La discussion est close.
Propulsé à la tête de la première puissance économique du continent africain, Jacob Zuma est un homme qui détonne. Sur des photos, prises lors de ses mariages successifs, on le voit lancé dans des danses guerrières et gesticuler en peau de bête.
Écoutons ses opposants sud-africains :
« Il me fait peur, dit l’un.
— Pourquoi ?
— Je ne sais pas, mais il me fait peur. »
D’autres sont plus concrets : « On ne peut pas avoir une première dame du pays sans dents. » Oui, bien sûr, mais ce président ayant trois femmes officielles, pourquoi s’attarder sur l’une plus que sur les autres ?Ses supporters ne sont pas plus raisonnés. Ils le surnomment, au choix, le « Jésus noir », le « Sauveur » et même « JZ », du nom d’un rappeur américain tendance bling-bling. Pourquoi l’aiment-ils à ce point ? « Parce qu’il était pauvre. Comme nous. »
À 67 ans, le président sud-africain s’est mis à se déhancher au rythme du kwaito, une musique tendance née du mariage de la house music et des hymnes zoulous.
Le 27 avril 2009, au soir des élections victorieuses, dix mille personnes ont hurlé leur joie dans le centre de Johannesburg : « Longue vie au président Zuma, longue vie ! » Jacob Zuma était le troisième président élu de la jeune nation « arc-en-ciel ». Après Nelson Mandela, fils d’un roi de la tribu Xhosa, après Thabo Mbeki, intellectuel éduqué à Londres, Jacob Zuma, guerrier zoulou, emportait les deux tiers des suffrages. Sur la place fraîchement rénovée du musée de l’Afrique, on a dansé ce soir-là, on s’est arrosé au champagne, on a entonné aussi l’un des chants de la lutte contre l’apartheid.
Dans la nuit froide de ce début d’hiver austral, dix mille voix se sont égosillées : « His father was a garden boy (Son père était jardinier) / His mother was a kitchen girl (Sa mère était cuisinière) / That’s why (C’est pourquoi) / He’s the president, he’s the president, he’s the president. (Il est président, il est président, il est président). » Telle une rock star, JZ est alors entré en scène. Poing levé, lunettes fumées, il ne s’est pas adressé à la foule. Il a fait mieux : il a dansé pour elle. A 67 ans, le nouveau président sud-africain s’est mis à se déhancher au rythme du kwaito, une musique tendance née du mariage dans les townships de la house music et des hymnes zoulous. Son corps, un peu bedonnant, il l’a balancé de droite à gauche, de haut en bas, avant de se frotter aux danseuses en minishort tout en tapant des pieds, comme les guerriers.
« Racontez-moi vos problèmes »
À mes côtés, une jeune fille a hurlé : « C’est la nouvelle révolution. L’esprit de Chris Hani est parmi nous ce soir ! » Assassiné en 1993 dans des circonstances douteuses, Chris Hani était une des figures de la lutte contre l’apartheid. Avec la chute du système, l’ANC, l’ancien mouvement clandestin, est devenu un parti comme les autres. L’aile gauche présentait Chris Hani comme le successeur de Nelson Mandela. Sa mort dégagea la voie à Thabo Mbeki, plus conservateur.
En ce soir du 27 avril 2009, c’est la revanche. Face à la foule, la dépouille symbolique de l’ancien président Thabo Mbeki et de ses alliés est confinée dans un cercueil. La réplique est parfaite : une boîte à chaussures peinte en noir, une croix soigneusement dessinée, le traditionnel « RIP » (Rest in peace, repose en paix) et des fleurs en plastique qui se balancent à chaque soubresaut. Allié communiste de l’ANC, le « camarade » Vavi brandit, devant la foule, le « symbole » : « Hier, nous nous sommes dit que le cercueil qu’on avait préparé pour eux était trop grand. On a décidé d’en refaire un à la taille du cadavre. » La foule rit aux éclats. « Dans cinq ans, pour les prochaines élections, je vous le promets, camarades, il n’y aura plus rien à enterrer. » La foule exulte. « L’ANC gouvernera ce pays pour toujours. Amandla ! » Dix mille personnes, poing dressé, répondent en chœur : « Awethu ! » (le pouvoir appartient au peuple).
Le peuple, Jacob Zuma a toujours su le comprendre, lui parler, l’écouter. « Racontez-moi vos problèmes », telle pourrait être sa devise. À peine élu, l’une de ses premières mesures fut d’installer une ligne téléphonique gratuite, ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour que tous puissent confier à l’appareil d’État leurs peurs, leurs soucis, leurs tracas quotidiens. Comme un service après-vente pour consommateurs déçus. Certains appelleront ça du populisme. Pour les proches du nouveau président, il s’agit de son « esprit paysan ».
Cent ans après la défaite sanglante contre les Anglais et les Afrikaners, les vieux du village nourrissent toujours leur rêve : « Un jour, Nkandla ressemblera à Johannesburg. »
Son pays, l’Afrique du Sud, il le gouverne comme un chef de village. À la manière de ceux qui, à l’ombre des arbres de ses terres natales, lui contaient la saga du peuple zoulou et de ses guerriers. Plus que le régime raciste d’apartheid, ce sont les violences coloniales qui lui ont donné la rage, l’envie de se battre et de s’engager.
Le village de Nkandla se trouve à cinq cents kilomètres de Johannesburg. C’est là, au cœur des terres zouloues, qu’est né en 1942 Jacob Zuma. Une forêt sacrée borde le petit bourg, le dernier roi zoulou y est enterré. Cent ans après la défaite sanglante contre les Anglais et les Afrikaners, les vieux du village, assis sur leurs pierres, nourrissent toujours leur rêve : « Un jour, Nkandla ressemblera à Johannesburg. » Jacob Zuma, le fils prodigue, amènera à eux les mirages de la capitale économique, ils en sont persuadés.
Combien d’habitants à Nkandla ? Ne le demandez pas. Même le chef du village n’en sait rien. Une petite centaine, probablement. Qui s’occupent des bien plus nombreuses têtes de bétail. Guidées par des enfants aux pieds nus, les vaches, indifférentes aux tracto-pelles et bulldozers, traversent l’immense route en chantier qui mène à Nkandla.
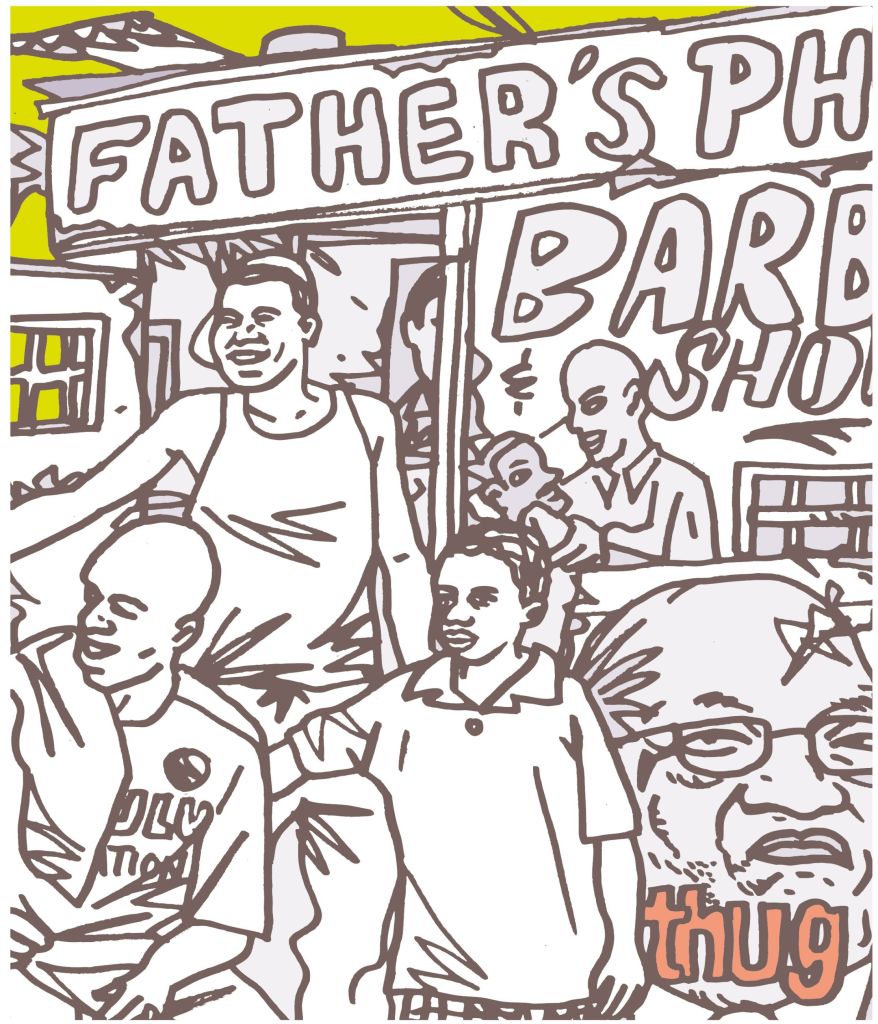
« Jacob Zuma fait beaucoup pour nous », confie le chef, le nkosi. Il vient de débarquer au volant d’une vieille BMW éclatante de propreté. Blouson en cuir et casquette ANC, le parti du Président, il invite à le suivre « dans [son] bureau », un immense bâtiment en brique rouge qui tranche sur les huttes abîmées des alentours. Une épaisse porte vitrée, nous voici à l’intérieur. La réception est vide, couverte de poussière. Le bureau, au fond d’un long couloir sombre, n’est pas plus meublé : une table et deux chaises en plastique. Pas de dossiers, pas de stylo non plus. « Jacob Zuma, il a tout fait ici. Il a mis l’électricité, il fait construire des routes et sa propriété est goudronnée. Il a construit une poste, un collège. Grâce à sa fondation, des orphelins peuvent aller à l’école et deux cent soixante-quinze jeunes de la région sont à l’université. » Les yeux du nkosi en tremblent d’émotion.
Pour atteindre Nkandla, il a fallu traverser la province du Kwazulu-Natal, une région où les montagnes voluptueuses dévalent dans des gorges enserrées, où les huttes colorées parsèment des champs de canne à sucre vert émeraude, où les femmes marchent le long des pistes, le visage couvert de boue pour se protéger du soleil. Partout, la pauvreté en trait commun. Comme à Nkandla, avant bien sûr que la politique n’envahisse les lieux. Enfant, Jacob Zuma y était garçon de ferme et passait son temps libre à « nager dans la rivière, chasser les oiseaux et se battre avec des bâtons ».
« Dans la famille, on n’aimait pas la politique »
« Bonjour, mon nom est Michael Zuma. Z.U.M.A. » Le frère du président s’applique à épeler son nom de famille, comme s’il s’agissait d’un nom de code à la James Bond zoulou. Ou alors, c’est qu’il ne réalise pas que tout le monde, dans le pays et ailleurs, connaît ce nom par cœur. Comme le veut la tradition, Michael vit toujours à Nkandla, au village, avec ses épouses et deux des épouses de son frère aîné. Mais cette semaine, il la passe dans un hôtel quatre étoiles de Durban, capitale côtière du Kwazulu-Natal. Michael est plus jeune de trois ans que son président de frère. Mais son dos courbé lui donne des airs de vieux monsieur, un peu perdu dans son époque et dans son hôtel de luxe.
Michael admire son grand frère : « C’est lui qui prenait tous les coups. Quand les vaches allaient pâturer dans le champ du voisin, ma mère nous réunissait dans la maison. Elle m’ordonnait de m’asseoir et de regarder et elle le frappait avec un lourd bâton. Lui, il ne bronchait jamais. Il gardait la tête haute et le regard droit. » La famille Zuma n’était pas politisée, ni éduquée d’ailleurs. Le président sud-africain n’est jamais allé à l’école. « Notre mère disait qu’en classe on apprenait à devenir stupide. » À Nkandla, on n’avait pas besoin d’être éduqué : soit on restait au village, soit on partait à la ville pour y devenir domestique « et astiquer le sol jusqu’à ce que Madame puisse se recoiffer dans le carrelage », s’amuse Michael.
Jacob Zuma, lui, a d’autres aspirations. A 17 ans, il part seul pour Durban où il rejoint un demi-frère, le fils de la première épouse de son père. Militant de l’ANC, engagé dans la lutte antiapartheid, ce dernier est de ces « communistes », comme on les appelle alors à Nkandla. Michael : « Dans la famille, on n’aimait pas la politique. Les communistes, on leur parlait pas. Et on n’en parlait pas beaucoup non plus. »
L’enfant de Nkandla se place dans les pas de son demi-frère. Il le suit à tous les meetings, assiste aux discussions politiques et se passionne pour les théories d’un certain Marx, reprises par les leaders africains militant pour la décolonisation. En s’engageant dans la lutte, c’est sûr, il deviendra quelqu’un.
Menottés les uns aux autres
Apprenti activiste, il est interpellé. Michael : « Quand Jacob s’est fait arrêter et qu’ils l’ont emmené en prison, ma mère s’en est prise à mon demi-frère. Elle hurlait : “T’as vu ce que t’as gagné avec tes histoires de politique ?” » Jacob Zuma passera dix ans dans la prison de Robben Island. Personne de sa famille ne viendra lui rendre visite.
Pendant leur transfert vers l’île du Cap, les « terroristes » sont menottés les uns aux autres. Le compagnon de Zuma s’appelle Ebrahim Ebrahim. « Nous avions 20 ans et on imaginait Robben Island comme Alcatraz. On était terrorisés », raconte l’ancien compagnon de cellule. Ebrahim Ebrahim n’est pas très bavard, mais son visage perlé de cicatrices parle pour lui. Les années de lutte et de prison endurées avec Jacob Zuma, il les porte dans sa chair. Le froid, la faim, le travail forcé, les séances de torture aussi.
Jacob Zuma avait été privé d’école. Ses dix années de prison seront son école. Plus il reçoit de coups, plus son regard s’emporte au loin. Dans sa cellule, avec l’aide de ses codétenus, le jeune homme apprend à lire et à écrire. Dans sa cellule aussi, il assoit ses talents de meneur. Ebrahim Ebrahim : « Le soir, il nous racontait les histoires du peuple zoulou, et tout le monde l’écoutait sans un bruit. C’est un orateur né. Il a monté un club de danse, une chorale et faisait même partie de l’équipe de foot. » Quand les détenus veulent porter des réclamations, c’est vers Zuma qu’ils se tournent. Et lui les transmet aux gardiens, en les assortissant de menaces de grève de la faim.
Thabo Mbeki a voulu mettre au ban le parti communiste, la jeunesse ANC et le syndicat des travailleurs. Zuma est alors devenu l’arme de ces exclus. L’arme du peuple.
Des années plus tard, la fraternité carcérale reste au cœur de son histoire. Longtemps conseiller politique de Jacob Zuma, Ebrahim Ebrahim a été nommé secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères. L’ANC est une grande famille. Qui désigne elle-même son chef : « Jacob n’avait pas l’ambition de devenir chef d’Etat mais, lorsqu’il a été renvoyé de son poste de vice-président par le président Mbeki, le parti l’a choisi », assure l’ancien compagnon de détention. Après l’assassinat de Chris Hani, Thabo Mbeki a voulu mettre au ban le parti communiste, la jeunesse ANC et le syndicat des travailleurs. Zuma est alors devenu leur arme, l’arme de ces exclus. L’arme du peuple.
La guerre avec le camp Mbeki commence. En 2005, le communiste Vavi prévient : « La candidature de Zuma comme prochain président de l’ANC sera un tsunami impossible à arrêter. » Jacob Zuma est alors poursuivi pour corruption et achat d’influence dans une affaire de ventes d’armes avec la compagnie française Thales. Le président Thabo Mbeki le renvoie de son poste de numéro deux du pays. Les mises en cause se succèdent. En quatre ans, le candidat Zuma est accusé dans quatre procédures : trois pour corruption, une pour viol.
Lui ne bronche pas. Ses alliés montent au feu, font état d’un complot qui viserait à éliminer le candidat des pauvres, c’est-à-dire la majorité des électeurs sud-africains. La bataille politique fait rage. Jacob Zuma navigue, habilement. Les charges lancées contre lui ? Il les retourne. Plus il passe devant les juges, plus le peuple l’idolâtre. « Les Sud-Africains aiment les opprimés et se sont toujours considérés comme des victimes », explique Jeremy Gordin, journaliste et biographe du Président.
Dans les nœuds du passé
L’argent et les femmes. Voilà le cœur de l’accusation. Pour comprendre, il faut plonger encore plus dans l’histoire et remonter à la fin de l’apartheid en 1994. Ancien responsable des services secrets, Jacob Zuma revient alors de dix-sept ans d’exil. Il a quatre femmes, une quinzaine d’enfants, ses poches sont vides, comme beaucoup de ses compagnons de lutte.
L’ancien parti de libération, l’ANC, est appelé à gouverner le pays. Mais ses responsables n’ont ni maison, ni compte en banque, ni même voiture. « Vous savez, en 1994, les banques ne prêtaient pas beaucoup aux Noirs. Encore moins s’ils avaient fait partie des services secrets de l’ANC »,raconte un ancien de la lutte armée. De fait, un système parallèle et opaque se met en place entre les comrades qui ont et ceux qui n’ont rien.
En cette année, Jacob Zuma se découvre un nouveau meilleur ami : Shabir Shaik. « Occupe-toi donc de politique, je m’occupe du reste », lui intime Shabir. Le reste, bien sûr, c’est l’argent. Riche investisseur issu de la bourgeoisie indienne, Shabir Shaik est un des financiers des temps héroïques. Il n’est pas étranger à Jacob Zuma non plus : ses cinq frères ont combattu sous les ordres d’Umsholozi, le nom de code de Zuma quand celui-ci était responsable des services secrets de l’ANC.
Vous savez, dans la défense, il faut toujours s’assurer que les gens avec qui on travaille ne risquent pas de poser problème dans les prochaines décennies.
Un marchand d’armes
De 1995 à 2005, Shabir Shaik verse à Zuma près de 100 000 euros (1,3 million de rands). Cet argent, l’ancien guérillero l’utilise pour payer sa maison, honorer ses prêts bancaires, régler son essence, les vêtements de ses épouses, l’école et l’éducation de ses vingt-deux enfants. Une belle amitié, mais aussi un investissement sur l’avenir.
En échange de cette aide, Shabir Shaik « disait tout le temps qu’il connaissait bien Zuma et qu’il pourrait faire pression sur le gouvernement dans les contrats », rapporte une source qui a fait affaires avec « ce drôle de mec ». Le soutien de Zuma permet à Shabir Shaik d’emporter de nombreux appels d’offres, notamment avec Thales, à l’affût d’opportunités dans la nouvelle démocratie. « Vous savez, dans la défense, il faut toujours s’assurer que les gens avec qui on travaille ne risquent pas de poser problème dans les prochaines décennies », explique un marchand d’armes.
En 2005, l’« ami » Shabir Shaik est condamné à quinze ans de prison pour « trafic d’influences » et « corruption ». Sa condamnation marque le début de la confrontation entre le président Thabo Mbeki et son vice-président, jugé trop encombrant. L’homme d’affaires indien passe deux ans en prison et sera libéré sur avis médical, peu avant l’élection de Zuma à la présidence.

Au cœur du trafic d’influence
Aujourd’hui, Shabir Shaik « se bat avec les juges pour ne pas retourner en prison ». Cela, c’est son frère qui le dit. Moe Shaik me reçoit pour le petit déjeuner dans sa magnifique demeure des quartiers chics de Pretoria, juste en face de la résidence de l’ambassadeur de France. Il vient d’avoir son frère Shabir au téléphone. Et si Moe tente d’arrêter de fumer, il ne peut s’empêcher de bourrer sa pipe : « Je veux que Shabir porte plainte à la Cour des droits de l’homme pour les terribles conditions de détention qu’il a endurées. »
L’ancien condamné pour corruption ne suivra pas ces conseils. Ou plutôt, pas tout à fait. Depuis le petit déjeuner de Pretoria, Shabir a préféré demander la grâce présidentielle… à celui-là même qu’il avait autrefois corrompu. Quant à Moe, il a été nommé à la tête des services secrets sud-africains.
C’est que le passé ne s’efface pas. La famille Shaik a toujours été si proche de Jacob Zuma, si dévouée… Comment Jacob Zuma pourrait-il oublier que, chef des services secrets de l’ANC, il avait ordonné aux Shaik de se faire arrêter à la place de son camarade de détention, Ebrahim Ebrahim, piégé dans une histoire de trafic d’armes. « Certains ont dû faire des sacrifices… », note Moe, imperturbable en train d’étaler le beurre sur ses tartines.
Six membres de la famille sont emprisonnés. L’un des frères, Yunus, est torturé. Moe passe vingt mois à l’isolement. Emportés par la tourmente, les parents de la fratrie meurent dans l’année. De cet épisode, Zuma porte la responsabilité. Se sent-il coupable ? Lui fait-on sentir sa culpabilité ? Qu’importe. Plus il grimpe les échelons du pouvoir, plus il place la famille Shaik.
Thales, le géant français de l’armement, est dans un premier temps visé par les poursuites. Mais, très vite, la société passe au travers des gouttes.
L’ascension des « frères de Durban » finit par déranger le président Mbeki. De plus en plus autoritaire et paranoïaque, ce dernier rêve d’un troisième mandat. Un de ses proches entre en scène : procureur général du pays, Bulelani Ngcuka lance des poursuites contre l’influent Shabir Shaik, accusé d’avoir pesé dans la négociation des contrats d’armement emportés grâce à l’amitié de Zuma.
Shabir Shaik comparaît seul dans le box. Zuma n’est pas directement mis en cause, même si les preuves sont là. La décision de ne pas le poursuivre est prise d’en haut, visiblement par Thabo Mbeki : « A l’époque, Zuma n’était pas vraiment une menace pour Mbeki. Le Président pensait que le procès de Shaik suffirait à le discréditer », explique le journaliste Jeremy Gordin.
Thales, le géant français de l’armement, est dans un premier temps visé par les poursuites. Mais, très vite, la société passe au travers des gouttes. L’un de ses responsables, en poste à Pretoria, rencontre le ministre de la Justice et le procureur général, pour « chercher un arrangement ». La discussion porte ses fruits. Le procureur général abandonne les poursuites initiées contre Thales – détenu à 27 % par l’Etat français et à 26 % par Dassault.
Quinze ans de prison
L’enquête ouverte en France est aussitôt interrompue. Le groupe rappelle à Paris Alain Thétard, son directeur général pour l’Afrique du Sud. « Le gouvernement voulait protéger ses intérêts économiques. Thales est l’une des rares sociétés étrangères à avoir investi autant d’argent dans ce pays », confie un responsable du groupe.
Dans sa résidence de Pretoria, Moe Shaik tire avec énergie sur sa pipe : « Thales pensait qu’en donnant 50 000 euros à Zuma – des cacahuètes ! – et en sacrifiant mon frère devant la justice, ils seraient tirés d’affaire. » La colère perce : « Ils se sont comportés en Afrique du Sud comme dans leurs anciennes colonies. » Shabir Shaik va donc porter le chapeau. Quand le verdict tombe, il est le seul condamné : quinze ans de prison. Une semaine plus tard pourtant, Zuma est mis en cause. Le voici accusé d’avoir touché 50 000 euros de Thales pour « protéger » la compagnie et bloquer l’enquête sur le contrat d’armement.
Effectivement, Zuma a stoppé les investigations quand il était au gouvernement. Mais il l’a fait avec le soutien de Mbeki, qui avait beaucoup à perdre. Des millions d’euros ont été versés en commissions au gouvernement. Zuma, lui, a touché 50 000 euros, des « cacahuètes ». Cela suffit, sa proximité avec Shabir Shaik le désigne comme cible. Jacob Zuma devient le fusible idéal. Il est aux yeux du monde le corrompu, celui qui, ayant failli, permet de faire passer tout le reste. Les pays européens ferment leurs enquêtes contre les compagnies d’armement. Mbeki renvoie son vice-président. Ultime affront, il nomme à sa place la femme du procureur général.
« Nous sommes prêts à tuer pour Zuma. » Ça y est, le mot d’ordre de la campagne est lancé.
Les alliés de Zuma se déchaînent. Ils cherchaient un héros, ils l’ont trouvé et jouent la carte de l’oppression et du scandale. Trop occupée à couvrir les multiples rebondissements judiciaires et à dénoncer la corruption, « gangrène » de la jeune démocratie, la presse ignore le vent en train de se lever. Dans les campagnes, dans les townships, au Kwazulu-Natal, la colère gronde. Les exclus expriment leur frustration, le peuple zoulou guette son heure. Mais le président Mbeki, déjà autiste quand il s’agit de lutter contre l’épidémie du sida, reste sourd aux cris exigeant du pain. La nation bout.
« Nous sommes prêts à tuer pour Zuma. » Ça y est, le mot d’ordre de la campagne est lancé. C’est le président de la jeunesse de l’ANC qui ose la « métaphore ». Le meurtre sera politique. On prépare le cercueil, ce cercueil qui, plus tard, au soir de la victoire de Zuma, sera triomphalement promené dans Johannesburg.
Derrière ses petites lunettes de soleil rondes, Jacob Zuma, l’ancien des services secrets de l’ANC ne bronche pas. Umsholozi en a vu d’autres. C’est un guerrier. Avant chaque confrontation avec la justice, il s’isole dans son village natal. A son frère, Michael, il confie que cette période fut « la plus dure » de sa vie : « Dix ans de prison, dix-sept d’exil, être un criminel pour le régime d’apartheid, ce n’était rien. Par contre, être traîné dans la boue par ses anciens camarades, c’est un assassinat. »
Les trois procédures lancées pour corruption tombent les unes après les autres. Le premier procès est annulé pour vice de procédures, le deuxième sur décision du juge qui renonce en raison des pressions politiques, le troisième car l’unité d’élite policière des Scorpions, chargée de l’enquête, aurait reçu ses instructions du gouvernement de Thabo Mbeki et non de la justice. En 2006, une nouvelle procédure est lancée contre le vice-président déchu. Le registre est différent : Jacob Zuma est accusé de viol. Dans un pays qui bat le record mondial d’agressions sexuelles, le sujet est extrêmement sensible. Zuma fait face, à sa manière.
« Apportez-moi ma mitraillette »
Le guerrier de Nkandla joue la carte zouloue. Au juge, il s’adresse dans sa langue natale. Ses proches, présents au procès, s’habillent de peaux de bête. Les rues de Johannesburg, la capitale des affaires, s’emplissent de supporters surgis des profondeurs négligées du pays. On brandit les premières pancartes « Jacob président », « JZ est invincible », « Zuma, Jésus-Christ noir, viens nous sauver ».
Pendant les marches, des hommes brûlent des portraits de l’accusatrice. Les sorciers traditionnels lui lancent des sorts. Des pierres sont jetées contre les associations de femmes venues manifester. Son frère Michael part s’isoler dans la forêt de Nkandla afin d’invoquer les ancêtres. Gommée et presque niée depuis la fin de l’apartheid, en 1994, l’Afrique du Sud traditionnelle s’impose sur la scène. Elle revit, enfin. La culture des villages reculés ou des profondeurs des townships déboule à Johannesburg.
Jacob Zuma est finalement acquitté. Troublé par la personnalité « perturbée » et « mythomane » de la plaignante, le tribunal tranche : il y a bien eu relation sexuelle, mais consentie.
Emporté par l’élan, Zuma affirme que la jeune femme a été utilisée à des fins politiques. Mais son image, il le sait, est anéantie par ses déclarations sur le sida pendant le procès. Dans l’un des pays les plus touchés au monde par le virus, il a expliqué au magistrat avoir pris une douche en guise de protection. Oui, une douche.
La naïveté de son propos et son ignorance font peur. Mais à la sortie du tribunal, ses supporters ne s’inquiètent pas. L’ambition est affirmée, la campagne lancée. Devant des milliers de supporters, Zuma déclare lui-même la guerre à son ennemi, Thabo Mbeki. Tête haute, regard raide et sourire aux lèvres, il entonne un chant, dont il fera sa marque : Apportez-moi ma mitraillette. La foule reprend en chœur le refrain : « Umshini wami Mshini wami (Ma mitraillette, ma mitraillette) /Khawuleth’umshini wami (S’il vous plaît, apportez-moi ma mitraillette). »
Après le miracle Mandela, Zuma a senti venir le temps des frustrations. La liberté, ça ne se mange pas.
Umshini wami, le chant de la branche armée de l’ANC, devient un second hymne national. Dans les townships, les jeunes en font la sonnerie de leur portable. Demandez aux électeurs de l’ANC pour qui ils veulent voter : ils ne répondent pas « Zuma », ils entonnent Umshini wami.
« J’aurais pu choisir n’importe quelle chanson, mais c’est le seul chant qui m’est venu à l’esprit », confiera Zuma, dans un documentaire sur l’ANC. Son sourire provocateur laisse pourtant entendre qu’Umshini wami n’est pas un choix du hasard. Après le miracle Mandela, Zuma a senti venir le temps des frustrations. La liberté, ça ne se mange pas.
Mais il ne faut pas se tromper : Jacob Zuma n’est ni socialiste ni communiste. Les théories de Marx, c’est bien quand on a 20 ans. « Etre dans un gouvernement, c’est se frotter aux réalités », assure son vieil ami et secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, Ebrahim Ebrahim. Pour battre Mbeki, Jacob Zuma avait besoin des communistes. Peut-être même s’est-il laissé convaincre. Mais jamais il n’a remis en cause la politique économique libérale menée depuis la présidence de Mandela. L’homme est trop malin et, à la révolution, il préfère la navigation.
Quand il s’adresse aux townships, le nouveau président parle accès au logement, électricité. En pleine crise économique, il n’hésite pas à promettre la création de cinq cent mille emplois dans l’année. Dans les salons financiers, au contraire, il distribue la bonne parole pour rassurer les investisseurs. Et réfute toute idée de redistribution accélérée des richesses.
Jacob Zuma, assure un diplomate français en poste à Pretoria, « n’est pas un idéologue, c’est un vrai homme politique ». L’accompagnant à Paris avant son accession au pouvoir, il se souvient n’avoir pas été trop rassuré : « Zuma est intervenu devant les cadres du Medef. Au début, il n’était pas à l’aise et son discours était plutôt confus. Mais au repas, il est devenu très naturel. Ses conseillers ont pris le relais et tout le monde est reparti satisfait et confiant. Jacob Zuma ne nous a jamais fait peur. »
Toujours tapi dans l’ombre
Faut-il oublier ses costumes en peau de bête, ses lunettes de soleil de gangster, et ses chants guerriers ? Se dire que tout ça, c’est du spectacle ? Que Jacob Zuma est « un mec sympa », « humble », « courageux », « à l’écoute » ?Se laisser bercer par son sourire, omniprésent ? Même quand il chante Apportez-moi ma mitraillette ?
Le soir des élections, Zuma a serré très fort dans ses bras son adversaire. Avec la douceur de ses cent kilos, il l’a promené dans les airs. Former son gouvernement fut un jeu d’enfant : un peu de communistes aux portefeuilles sociaux, quelques conservateurs aux ministères en charge d’économie.
Deux mois plus tard, la crise économique a sonné comme un rappel. Les grèves se sont accélérées, les townships se sont embrasées, les maisons promises n’ont pas pu combler la demande. Et le pays a perdu sept cent mille emplois en lieu et place des cinq cent mille créations promises. Le principal syndicat des travailleurs, grand soutien du temps de la campagne, mène la vie dure au nouveau président : « Pourquoi devrions-nous stopper les grèves ? Nous ne sommes pas les gardiens du gouvernement », déclarent ceux qui, autrefois, portaient le cercueil de la victoire.
Au siège de l’ANC, immeuble de style stalinien au centre de Johannesburg, la jeunesse fait pression. « Il faut nationaliser les mines du pays », affirme le représentant des ligues de jeunesse, Floyd Shivambu, indigné par « ce gouvernement » qui « n’a pas l’argent pour payer ses médecins » : « Les jeunes des campagnes rêvent de vivre dans des bidonvilles et ceux qui sont éduqués rêvent de travailler en Australie, ce n’est pas normal. »
Le pays avait besoin de se sentir compris et entendu. Jacob Zuma était l’homme idoine.
Les plus engagés, ceux qui se déclaraient prêts à « tuer pour Zuma », veulent encore croire en leur sauveur. Après tout, disent-ils, c’est un « type bien ». Il incarne les valeurs de l’ANC, il a grandi et vieilli avec elle. Mais le doute effleure : « De toute façon, ce n’est pas Jacob Zuma qui prend les décisions, c’est l’ANC. Que dira-t-on à notre peuple si, à la fin de son mandat, rien n’a changé ? Que vingt ans après la fin de l’apartheid, c’est encore trop tôt ? »
Le pays avait besoin de se sentir compris et entendu. Jacob Zuma était l’homme idoine. Depuis son élection, la ligne téléphonique ouverte 7 jours sur 7 a conclu que les Sud-Africains avaient besoin de logements, de travail et de sécurité. Ça, tout le monde le savait déjà. Reste à y parvenir. Entre les tenants de l’économie de marché, les partisans de la discrimination positive en faveur des défavorisés et les soutiens d’une répartition rapide des richesses, la bataille est rude. Au milieu, il y a Zuma.
L’enfant de Nkandla porte son rêve de développement rural, il ne veut pas changer la face de l’Afrique du Sud. Ses ministres sont là pour répondre aux questions sur la nationalisation des mines ou la mise en place d’une assurance santé. L’ancien chef des services secrets, lui, ne se sent jamais aussi bien que tapi dans l’ombre, sauf quand il s’agit de danser sous les projecteurs.