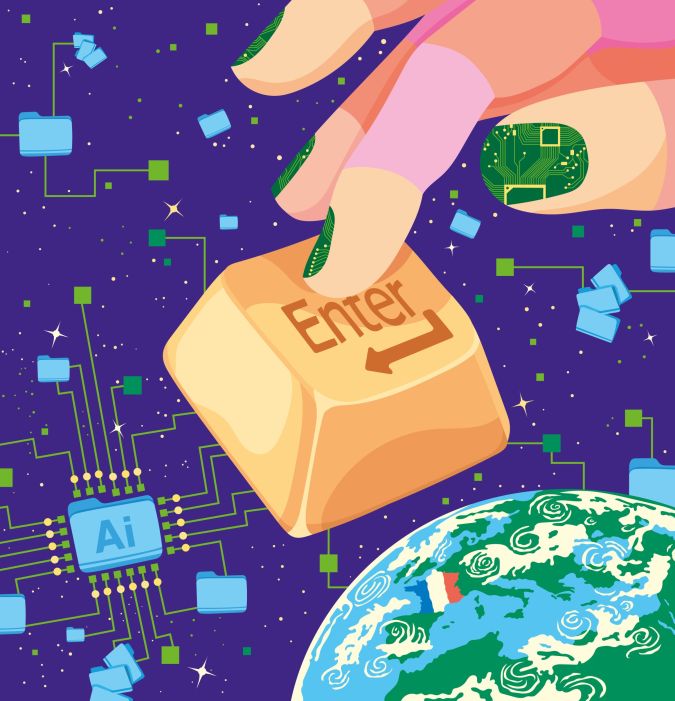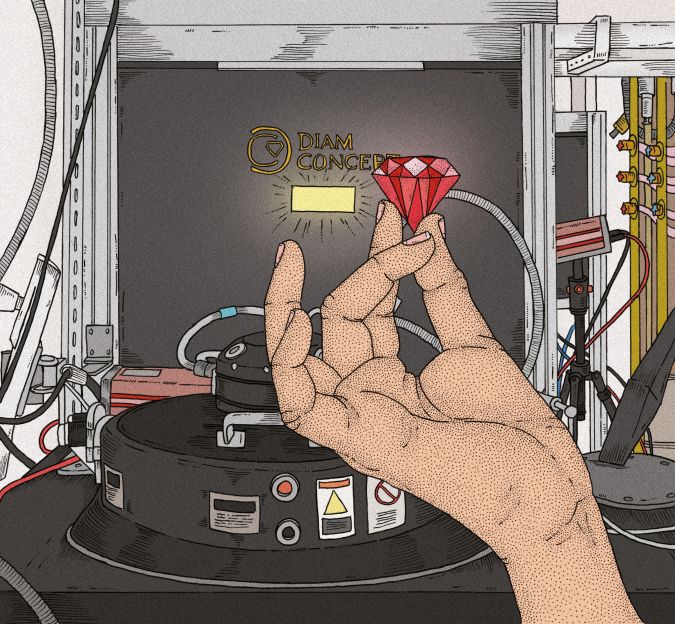Il suffirait, titre un livre paru en 2022 chez Odile Jacob, de « bien manger pour ne plus déprimer ». L’estomac, lit-on partout, serait notre deuxième cerveau. « Bouge ton corps, soigne ton esprit », invite la neuroscientifique Jennifer Heisz dans son essai à succès publié aux États-Unis, où elle démontre les vertus de l’exercice physique pour surmonter l’anxiété et la dépression. Bref, la réponse à nos problèmes ne se trouverait plus dans le cabinet du psy, le confessionnal ou les leçons des philosophes, mais dans le huis clos le plus intime qui soit : notre propre corps.
Tout l’enjeu commercial devient alors de vendre les moyens de mieux le connaître. Que ce soit par les formations au voyage intérieur que permettent les techniques de méditation ou, plus futuriste, par l’utilisation de capteurs connectés en tous genres, téléphone, montre ou bracelet. Là où la tête doute, le corps sait. Prenez soin de lui et le reste suivra. Bonne idée. Mais pas n’importe comment ni à n’importe quel prix, alerte la philosophe Frédérique de Vignemont, autrice de Désenchanter le corps.
Miroir déformant
Cette spécialiste de sciences cognitives voue sa carrière à la compréhension de notre relation au corps. Ce qui n’est peut-être pas sans rapport avec son incurable maladresse, avoue-t-elle en m’accueillant dans son bureau. Il ne faut pas se laisser leurrer par la décoration spartiate de la pièce : c’est la seule de la très sérieuse École normale supérieure de la rue d’Ulm à abriter des objets de farces et attrapes. D’abord, un miroir déformant. Puis, près de l’ordinateur, une main jaune et cramoisie en caoutchouc d’Halloween.
Ces artefacts ont beau être enfantins, ils suffisent, avertit la directrice de recherche au CNRS, à faire momentanément dérailler nos convictions les plus solides. Car la conscience que nous avons de notre propre corps n’est pas aussi fiable que nous le croyons. C’est une certitude que la chercheuse a acquise au contact de patients atteints de troubles psychiatriques ou ayant perdu, suite à un accident, la conscience de leur main, de leur bras, de pans entiers d’une enveloppe charnelle autrefois si familière. Pour elle, croire que notre matière corporelle serait une boîte magique à partir de laquelle régler tous nos problèmes relève d’une « mythologie contemporaine », qu’elle a voulu déboulonner.
Quel rapport entretenons-nous avec notre corps aujourd’hui ?
Frédérique de Vignemont : Il y a un double mouvement à l’œuvre. D’un côté, notre expérience du monde et des relations aux autres s’est désincarnée. Nous travaillons à distance, nous vivons une partie de nos relations sociales par écrans interposés, nous passons des heures absorbés par des avatars virtuels dans les jeux vidéo. D’un autre côté, nous accordons de plus en plus d’attention à notre corps. Je pense par exemple à la mode du quantified self [la mesure de soi, NDLR], c’est-à-dire l’idée que nos compétences corporelles sont devenues des chiffres et qu’il est utile de scruter nos calories, nos heures de sommeil ou le nombre de nos pas quotidiens.
Le quantified self peut transformer des gens sains en hypocondriaques.
Sauf qu’en un sens, passer par une machine pour nous dire si nous allons bien, c’est toujours s’éloigner de notre corps. Nous déléguons à un objet externe le soin de comprendre ce qui se passe en nous. Ce qui est paradoxal avec le quantified self, c’est que nous finissons par ne plus avoir confiance dans nos perceptions, comme si ce que nous ressentons sans ces instruments de mesure était insuffisant ou trompeur… Et ça peut transformer des gens sains en hypocondriaques qui s’inquiètent de manière disproportionnée, finissant par imaginer ou amplifier leurs sensations.
Pensez à la mesure du poids, qui est un quantified self à l’ancienne. Évidemment, elle peut être très utile, que ce soit pour évaluer la croissance d’un enfant ou alerter d’un problème. Mais elle peut aussi conduire des comportements obsessionnels qui finissent par nuire à l’organisme si elle est utilisée à mauvais escient.
Et puis, il y a cette tendance à vouloir se « reconnecter avec son corps ». Qui pourrait être contre ? Ce qui me gêne, c’est que toute une littérature, dans la catégorie du développement personnel et du self-help, fait référence dans son argumentaire commercial aux prétendus pouvoirs magiques du corps, comme si le corps pouvait résoudre tous les problèmes dans notre vie.

Parmi les pouvoirs magiques attribués au corps, on lit souvent que l’intestin est notre « deuxième cerveau ». Le livre Le charme discret de l’intestin, paru en 2015, s’est vendu à des millions d’exemplaires et a été traduit dans le monde entier. Qu’en pensez-vous ?
Même moi, je ne suis pas certaine de savoir ce que cette jolie formule veut dire [rires]. Ce qui est sûr, c’est que ça ne veut pas dire que l’estomac réfléchit par lui-même, soyons clairs. Ce qui a fasciné les gens, c’est de découvrir que les parois d’un organe comme l’estomac comportaient des cellules électriques, semblables aux neurones, qui signalent au cerveau le rythme de pulsation gastrique en continu. L’activité cérébrale peut ainsi résonner en synchronie avec l’estomac. Et ces dernières années, on a commencé à étudier l’impact que cela a sur nos capacités mentales.
L’estomac n’est pas le seul à trouver un écho dans le cerveau. C’est le cas aussi des battements cardiaques, de la respiration, etc. On parle d’intéroception, qui repose sur la perception de toutes les informations provenant de nos organes et viscères. Tout est encore à découvrir sur le fonctionnement de l’intéroception. Il y a tant de récepteurs internes que nous ne savons même pas encore comment nous avons conscience de notre rythme cardiaque ! Mais le problème, c’est qu’à partir de cette capacité, certes fascinante mais encore très mystérieuse, il y a beaucoup d’extrapolations.
C’est-à-dire ?
Le cerveau reçoit des informations de tout le corps, c’est un fait. À partir de là, beaucoup ont été tentés de penser que, si nous pouvions être plus à l’écoute de nos signaux internes, cela nous rendrait plus intelligents, moins anxieux, plus équilibrés. C’est une question qui a beaucoup intéressé les scientifiques, et un nombre impressionnant d’études ont été menées à ce sujet : près de 4 000 expériences sur ces dix dernières années ! Toutes cherchent à montrer que l’intéroception influence la conscience de soi, la perception du temps, les émotions, l’attention, voire même les capacités mathématiques !
Un protocole classique au cœur de ces études consiste à demander à des volontaires de compter mentalement leurs battements cardiaques sur une minute. Plus leur évaluation est proche de leur rythme cardiaque réel, plus cela signifie qu’ils sont de « bons intérocepteurs ». Ensuite on leur demande d’effectuer différentes tâches cognitives pour voir s’ils sont plus performants que les « mauvais intérocepteurs ». Et quelquefois c’est le cas. Le problème, c’est que, en science, on peut faire dire ce qu’on veut aux corrélations. Elles ne prouvent rien. Ce score d’intéroception mesure-t-il la capacité à prendre conscience du corps ou seulement la capacité à être plus concentré et donc plus performant en général ?
Les résultats peuvent aussi aller dans toutes les directions. Par exemple, certaines études établissent que les bons intérocepteurs sont plus anxieux, d’autres qu’ils sont moins anxieux ! Qu’en conclure ? On ne peut pas dire en tout cas que les procédés de voyage intérieur, comme le « balayage corporel » par exemple – body scan en anglais –, qui consiste à passer en revue tous ses membres en leur portant une attention particulière et sensorielle, rendent plus intelligent. Ni plus empathique d’ailleurs, comme le prétendent certains vendeurs de méthodes de développement personnel.
D’où vient cette idée que, si nous portions davantage attention à notre corps, nous pourrions être plus empathiques ?
Un des grands défis pour les philosophes est de savoir par quelle magie nous nous comprenons les uns les autres. Après tout, nous n’avons accès qu’aux comportements externes de nos congénères, et non à ce qui se passe dans leur tête. Jusqu’à la fin du XXe siècle, les scientifiques et les philosophes ont majoritairement compris notre relation aux autres d’une manière uniquement cérébrale. Un peu comme si nous étions des ordinateurs jouant aux échecs : chacun d’entre nous chercherait à deviner et à appréhender rationnellement ce que l’autre va faire. Cette vision a été remise en question par une théorie qui a eu une popularité fracassante, bien au-delà des sphères scientifiques.
Tout part d’une expérience avec des singes en Italie, menée dans les années 1990. Le dispositif était hyper classique : le singe devait manger des cacahuètes pendant que les biologistes mesuraient son activité cérébrale. Sauf que l’expérimentateur, qui avait faim, a pris l’une des cacahuètes du singe et l’a mangée. Quelque chose d’assez incroyable s’est alors produit : dans le cerveau du singe s’est activé exactement le même neurone que s’il l’avait mangée lui-même. De là, le chercheur italien Giacomo Rizzolatti a émis l’hypothèse des « neurones miroirs », c’est-à-dire que notre cerveau a la capacité de réagir en regardant quelqu’un agir, de la même manière que si nous étions l’auteur de l’action.
Cette découverte a eu un grand impact dans la communauté scientifique. D’un coup, tout a été relu à travers ce prisme des neurones miroirs, de l’entraînement sportif à la création d’œuvres d’art ! Ce phénomène de résonance a aussi été observé à propos de la douleur, lorsque nous voyons quelqu’un se blesser devant nous. Nous avons alors littéralement mal pour l’autre, au sens où les zones de la douleur dans notre cerveau s’activent en partie.

Comme si nous étions tous en Bluetooth… Cette découverte des neurones miroirs a donc permis de faire évoluer la compréhension de notre relation aux autres vers quelque chose de plus incarné ?
Oui, la découverte des neurones miroirs est venue donner une plausibilité empirique à une hypothèse qui a été très en vogue dans les années 2000 : la cognition sociale incarnée, ou embodiment. Pour le philosophe Alvin Goldman et le neuroscientifique Vittorio Gallese, nous ne connaissons pas autrui seulement de manière abstraite et intellectuelle, mais aussi de manière corporelle – même s’il s’agit de neurones qui s’activent, et que donc cela reste très cérébral. Une version plus extrême de la cognition sociale incarnée affirme que c’est littéralement le corps – au-delà du cerveau – qui ancre la compréhension d’autrui. Ainsi, si nous écoutions mieux les signaux envoyés par notre corps, nous devrions du même coup être plus sensibles à l’autre.
Cette théorie a contribué à diffuser l’idée que prendre soin de son corps pourrait faire de nous de meilleures personnes, plus empathiques et altruistes. Mais là où elle me paraît atteindre ses limites, c’est qu’à en croire ses défenseurs, tout devrait passer par le corps. Sauf qu’il y a de nombreux cas qui montrent le contraire, comme l’illustre parfaitement la simple lecture d’un roman. Les personnages sont désincarnés et pour autant nous partageons leurs expériences de manière parfois intense.
Vous examinez dans vos recherches plusieurs cas où le corps nous induit en erreur.
Pendant mon doctorat, je me suis intéressée à l’origine de la conscience de soi. Les philosophes ont souvent l’intuition naïve qu’elle est infaillible, mais la clinique montre que c’est loin d’être le cas. Je me rappelle ainsi un patient atteint de schizophrénie, convaincu d’être un super-héros qui pouvait courir plus vite que la lumière. Il s’élançait devant moi dans le couloir à vitesse normale puis revenait et me disait : « Alors ? Vous ne m’avez pas vu partir ! » D’autres patients sont persuadés que la moitié de leur corps ne leur appartient pas, qu’une jambe ou un bras n’est plus le leur. Demandez aux médecins qui exercent aux urgences en neurologie : près de 40 % des patients qui se retrouvent là ont un trouble de représentation de leur corps.
La conscience de soi peut être aussi perturbée chez tout un chacun, cela n’est pas limité aux syndromes neurologiques ou psychiatriques. Prenez l’exemple de l’illusion dite de la main en caoutchouc. Votre vraie main est cachée derrière un écran et vous voyez sur l’écran l’imitation d’une main. Si je caresse votre main avec un pinceau et que vous voyez simultanément sur l’écran un pinceau caresser la fausse main, vous pourrez avoir l’impression que ce morceau de caoutchouc fait partie de votre corps. Les gens croient souvent que nous pouvons nous tromper à propos du monde extérieur mais que, vis-à-vis de notre propre corps, nous sommes dans une relation immédiate et évidente. De ces diverses expériences, j’ai appris au contraire que la conscience que nous avons de notre corps est un fil changeant et fragile.
Et le miroir déformant qui se trouve derrière nous ?
Il donne une petite idée de ce que vit une patiente anorexique. Ce sont des personnes, souvent des jeunes filles, qui ont perdu la capacité à voir leur corps tel qu’il est réellement. Des études ont ainsi montré que, quand on leur demande de dessiner le contour de leur silhouette sur un miroir, elles se dessinent littéralement plus grosses qu’elles ne le sont. Le miroir déformant permet de rendre visible leur vécu subjectif.
En tant que philosophe, que pensez-vous du fait que notre époque s’intéresse autant au corps ?
Je dirais que nous vivons une époque angoissante où nous manquons de prise sur le cours des choses. Il peut être tentant de se replier sur son corps, cet objet familier, à portée de main, presque la seule chose qu’on peut contrôler directement. Mais au fond, à mon avis, ce désir de mieux connaître notre corps est alimenté par un besoin profond de comprendre nos émotions et de les réguler. Toute émotion a une tonalité corporelle.
Imaginez avoir peur sans qu’il se passe rien dans votre corps… Ça n’arrive jamais. La peur est associée à toute une gamme de signaux corporels qui se mettent en branle, le cœur qui bat, le sursaut, les muscles qui se tendent. Comme si le corps se mettait à clignoter. Il en va de même pour la tristesse ou l’anxiété. On peut alors espérer qu’en contrôlant mieux notre corps, nous allons mieux contrôler nos émotions. Certains vont jusqu’à conclure que nos émotions ne sont qu’un ensemble de réponses corporelles.
D’où vient cette idée ?
Un philosophe et psychologue américain, William James, a formulé à la fin du XIXe siècle une théorie très importante qui se résume en une phrase : nous ne pleurons pas parce que nous sommes tristes, nous sommes tristes parce que nous pleurons. Il inverse totalement ce que nous pensons spontanément, à savoir que, face à certaines situations, nous ressentons de la tristesse qui se manifeste par les pleurs. Pour lui, les signaux corporels ne manifestent pas une émotion, ils sont l’émotion elle-même. Il écrit avec un certain lyrisme, je cite de mémoire : « On ne peut pas imaginer un état de rage sans sentir ses poings qui se crispent, sans sentir ses dents qui se serrent… » Bref, ce que nous appelons « émotion » serait juste la perception de sensations corporelles.
Mais, ça, c’était en 1890. Très vite, le neurophysiologiste Walter Cannon a observé que quelque chose clochait dans cette approche. Qu’en est-il de ces patients qui ont une lésion de la moelle épinière et qui, alors qu’ils n’ont plus accès à leurs signaux corporels, ont tout de même une vie émotionnelle ?
Un siècle après William James, la théorie incarnée des émotions revient, mais remaniée, avec le neurologue luso-américain Antonio Damasio. Celui-ci démontre que ce qu’il appelle les marqueurs somatiques liés à l’état du corps – les viscères qui se nouent, la peau qui réagit, etc. – jouent un rôle majeur dans la prise de décision. Mais il accepte aussi que, dans d’autres cas, le cerveau puisse simuler mentalement l’état du corps, l’imaginer, faire « comme si » le corps ressentait ces marqueurs somatiques, et que cela suffise à provoquer l’émotion.
Les émotions ne sont pas l’ennemi de la raison. Bien au contraire.
Mais ce qui a rendu Damasio vraiment célèbre, c’est l’idée que les émotions ne sont pas l’ennemi de la raison. Bien au contraire. Certains patients qui, par exemple, ne sont plus capables d’avoir des regrets, des remords ou de la peur, suite à une lésion cérébrale, prennent des décisions moins optimales, par exemple dans des jeux d’argent. En résumé : sans émotions, pas de raison.
Du coup, comment écouter son corps de la bonne façon, avec attention mais sans le prendre pour un guide infaillible ?
Cela n’est malheureusement pas aussi simple, comme le montrent une série d’études de grande envergure menées par la neuroscientifique allemande Tania Singer. Elle a conduit entre 2012 et 2016 en Allemagne un vaste projet de recherche à l’Institut Max-Planck sur les effets de la méditation. Elle a travaillé avec le dalaï-lama et a mené ses recherches en étant à titre personnel une praticienne experte. Tania Singer a suivi pendant onze mois 150 participants répartis en trois groupes, ce qui est massif pour une étude du genre. Avant de débuter, elle leur a fait passer à tous des tests pour mesurer trois éléments : leur niveau d’anxiété, leur attention et leur capacité à se mettre à la place d’autrui – l’empathie. Puis elle leur a demandé de s’entraîner quotidiennement à un certain type d’exercice de méditation qui variait selon les groupes.
Le premier groupe, « présence », pratiquait la méditation dans sa dimension corporelle, avec des exercices de respiration et d’attention au corps comme le balayage corporel. Le deuxième groupe, « émotion », mettait l’accent sur l’entraînement à la compassion. Le dernier groupe, « mise en perspective », était plus intellectuel et menait un travail plus réflexif, où, pour citer l’étude, la chercheuse encourageait les participants à « penser au fait de penser ». Elle a refait les tests onze mois après.
Pour l’empathie, seule la deuxième méthode a marché. Donc la méditation centrée sur le corps ne permet pas d’être plus dans la compassion. Pour l’anxiété, les participants se disaient moins stressés, mais cela ne se reflétait pas au niveau de leur corps lui-même, qui présentait toujours les mêmes marqueurs typiques du stress, comme le rythme cardiaque ou des réponses électrodermales. Au contraire, les pratiques cognitives expérimentées par le troisième groupe, qui se focalisent sur la reconstruction personnelle et demandent beaucoup plus de travail, avaient de véritables effets physiologiques sur l’anxiété. Pour s’apaiser, le corps a besoin d’un esprit.