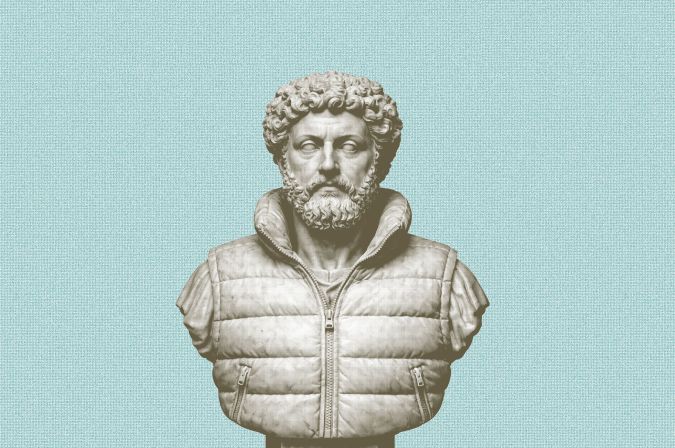Appelons ça le « paradoxe coatesien ». À 50 ans tout rond, Ta‑Nehisi Coates, sans doute l’un des intellectuels américains les plus notables des quinze dernières années, devait échouer pour avoir raison. Durant l’ère Obama, l’enfant du ghetto de Baltimore s’était taillé une place de choix dans le débat public. Il en était le rabat-joie lettré et streetwise (la proverbiale « sagesse de la rue »), relativisant les avancées de l’antiracisme et les victoires des démocrates, toujours trop maigres, trop éphémères ou trop symboliques (voire hypocrites) à son goût. Dans le même temps, son ambition dévorante l’avait amené à s’embarquer dans une mission folle : celle de remodeler la pop culture américaine, y injectant toute une mythologie afrocentrée – le blockbuster Black Panther, c’est en grande partie lui.
Le monde de Trump signe ainsi la réalisation des pires prophéties de Coates, et la plus cinglante de ses défaites. « Tu n’as pas tort, me répond-il quand je pose l’équation devant lui, début novembre, lors d’un entretien à Paris. Mais t’oublies une chose : je ne m’attendais pas à réussir dans le présent. La lutte est générationnelle. Le retour de bâton qu’on subit aujourd’hui est tout sauf surprenant. L’histoire nous enseigne que le contrecoup de tout progrès est toujours vicieux. » Longtemps placé sur un piédestal, il est le premier concerné. Ses livres sont désormais bannis dans les lycées de plusieurs États républicains, ses scénarios commandés à prix d’or par Hollywood enterrés jusqu’à nouvel ordre.
Hip-hop et réseaux sociaux
Ma première rencontre avec Ta‑Nehisi Coates remonte à une décennie. Janvier 2015, pour être précis. Autant dire un siècle. C’était, déjà, à Paris, en fin de journée, dans une antenne culturelle de l’ambassade états-unienne. Aucun de nous deux n’arrive à se souvenir de l’arrondissement où elle se situait, ni même vraiment ce qu’il était censé y animer – à mon arrivée, des adolescents blasés prenaient congé en rangeant leurs carnets. J’étais venu lui parler de l’Université Howard, à Washington, ce « Black Harvard » où il avait étudié, pour un article que je préparais sur ces établissements « historiquement noirs », selon la dénomination officielle, car créés durant la ségrégation pour façonner l’élite afro-américaine. Et qu’on disait, dans cette ère Obama finissante, anachroniques.
Ta‑Nehisi Coates était alors la star montante du grand magazine de la gauche américaine, The Atlantic. Une figure de ce qu’on appelait les « nouvelles voix de la radicalité noire », hyperactives sur les réseaux sociaux : Coates était l’un des premiers journalistes à dépasser le million d’abonnés sur le Twitter pré-Musk. Avec sa plume acide et ses aphorismes façon KO nourris à la culture hip-hop, il ferraillait contre l’angélisme « post-racial » en vigueur à l’époque, tout en donnant forme, intellectuelle et militante, aux revendications du mouvement Black Lives Matter.
Monstrueux travail
Six mois plus tôt, Coates avait signé son premier grand fait d’armes avec un article-fleuve, le plus long jamais publié par le vénérable Atlantic. Un réquisitoire pour que l’État américain verse des réparations financières aux descendants d’esclaves. Pour sa démonstration, le journaliste – tel qu’il se définissait alors – noyait son lyrisme dans une montagne de statistiques sur les inégalités et un monstrueux travail d’enquête dans les archives nationales.
Fils d’un libraire et éditeur affilié aux Black Panthers, il voulait poser des chiffres et des faits sur ce que beaucoup considéraient encore comme une lubie marginale, cantonnée aux petits cercles de nationalistes noirs. Lui citait en exemple les réparations payées par l’Allemagne au sortir de la Seconde Guerre mondiale à l’embryonnaire État d’Israël. Le débat s’était poursuivi jusqu’au Congrès, Coates auditionné comme une sommité, avant de sombrer dans les rouages de la machinerie législative. C’était à ce moment-là que je l’avais appelé la première fois, pour Le Monde.
Être Charlie (ou pas)
En ce début 2015, l’année de ses 40 ans, Coates était venu se mettre au vert à Paris, comme son idole l’écrivain James Baldwin au siècle dernier. Il portait une casquette plate, des lunettes et des fringues baggy masquant un léger embonpoint. Il mettait la dernière touche à ce qui allait devenir, l’été suivant, son premier best-seller : Entre le monde et moi, rumination aussi sombre que viscérale sur l’expérience afro-américaine. Un pamphlet foncièrement fataliste, à rebours de l’optimisme obamien, face à la toute-puissance de « l’Amérique blanche, une sorte de syndicat déployé pour protéger son pouvoir exclusif de domination et de contrôle sur nos corps ». Coates jouait les Cassandre, et s’apprêtait à vendre des tonnes de livres.
Mais à ce moment-là, ce qui occupait son esprit, comme nous tous, était les attentats de Charlie Hebdo et de l’Hyper Cacher. Forcément, The Atlantic lui avait commandé un article sur ce qu’« être Charlie » (ou pas) voulait dire. En échange de son aide pour mon article sur les facs blacks américaines, il m’avait fait une demande particulière : lui présenter un collègue musulman. Ce n’était pas difficile, il n’y en avait qu’un à l’époque à Libération, où j’écrivais désormais, en la personne de Rachid Laïreche (par ailleurs futur collaborateur de Revue21).
Nous avions déjeuné tous les trois, à côté de la place de la République couverte de camionnettes télé et de cars de CRS. Coates posait des questions, prenait des notes. Dans la discussion, le reporter d’outre-Atlantique était dur avec l’Amérique, mais tout autant avec la France, pourtant meurtrie. Il peinait à comprendre l’obsession pour la caricature blasphématoire, quel qu’en soit le coût, y compris pour les minorités marginalisées et brutalisées au passage, soulignait-il, au risque d’être inaudible.
Pessimisme radical
J’ai ensuite suivi de loin son immanquable ascension. Dans le petit laps de temps précédant l’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche – de l’été 2015 à l’automne 2016 –, Ta‑Nehisi Coates était absolument partout. Massivement adulé, parfois critiqué, mais avant tout consulté (Vanity Fair titrait : « notre intellectuel le plus vital »), de conférences en entretiens exclusifs avec Barack Obama himself. Le président démocrate avait assuré qu’Entre le monde et moi (« essentiel comme l’eau ou l’air », lisait-on dans le New York Times) était dans ses bagages lors de sa retraite annuelle sur l’île de Martha’s Vineyard. Toni Morrison, la Prix Nobel de littérature, déclarait que l’écrivain remplissait enfin le vide laissé par Baldwin – un couronnement.
Coates était un must-read, une discussion de machine à café, un phénomène de société, porté aux nues par les foules progressistes blanches assoiffées de repentir. Dès lors, pour le contacter, il fallait écrire un mail à une assistante. Sa parole n’était plus seulement rare : elle était devenue chère, de masterclasses en press tours. Dans une interview, il ironisait sur comment l’argent l’avait rendu « snob », à s’offrir un coach sportif et un passage hebdomadaire chez le coiffeur.
Pour la sortie de la traduction française d’Entre le monde et moi – initialement publié sous le titre éculé Une colère noire –, je l’avais revu en 2016 chez son éditeur parisien, la maison Autrement. Épuisé comme une rock star en fin de tournée, il disait apprécier l’anonymat qu’il retrouvait dans les rues parisiennes. Désormais rompu à l’exercice, il avait déroulé ses constats désenchantés sans affect et son pessimisme, un temps taxé de « radical chic », comme validé par l’émergence irrésistible de Trump dans la campagne présidentielle, à quelques mois des élections. Les punchlines tombaient toutes seules. Plus le temps de déjeuner…
Néolibéral et woke
L’année suivante, Coates publiait Huit ans au pouvoir, recueil de ses chroniques écrites sous Obama, qui prenaient une tonalité sépulcrale. Le titre original était plus explicitement amer : We Were Eight Years In Power (« nous avons été huit ans au pouvoir »). Au même moment, il s’abîmait dans une joute publique avec une autre grande figure noire, le théologien marxiste Cornel West, qui l’accusait d’être un suppôt de l’« establishment néolibéral », trop conciliant envers le passif économique (le renflouement des banques après la crise des subprimes) et militaire (l’usage des drones tous azimuts) d’Obama au moment d’en faire l’inventaire.
Soudainement, Coates était attaqué sur sa gauche, transformé en punching-ball embourgeoisé et, dans le même temps, érigé par ses contempteurs droitiers mais aussi centristes en grand prêtre du « wokisme » – le nouveau mot à la mode. En réaction, il fermait son compte Twitter, quittait The Atlantic et se retirait du débat public. Il annonçait qu’il allait désormais se consacrer à une nouvelle tâche : changer les esprits par la fiction populaire. En scénariste et romancier, il s’en allait façonner de nouveaux imaginaires. Fini, du moins à cet instant, le journalisme.
Superman afro
Dans cette nouvelle vie, il rencontrait un succès plus grand encore. Pour les Marvel Comics, sa réécriture afrofuturiste du roi T’Challa, alias « Black Panther », s’arrachait en kiosques depuis qu’il avait dépoussiéré ce super-héros de seconde zone. Les aventures new-look du potentat du Wakanda étaient ensuite transposées au cinéma dans un blockbuster du même nom, sorti en 2018. Carton monumental dans les multiplexes mondialisés (1,3 milliard de dollars de recettes à l’échelle du globe), premier long-métrage du genre « cape et collants » nommé à l’Oscar du meilleur film.
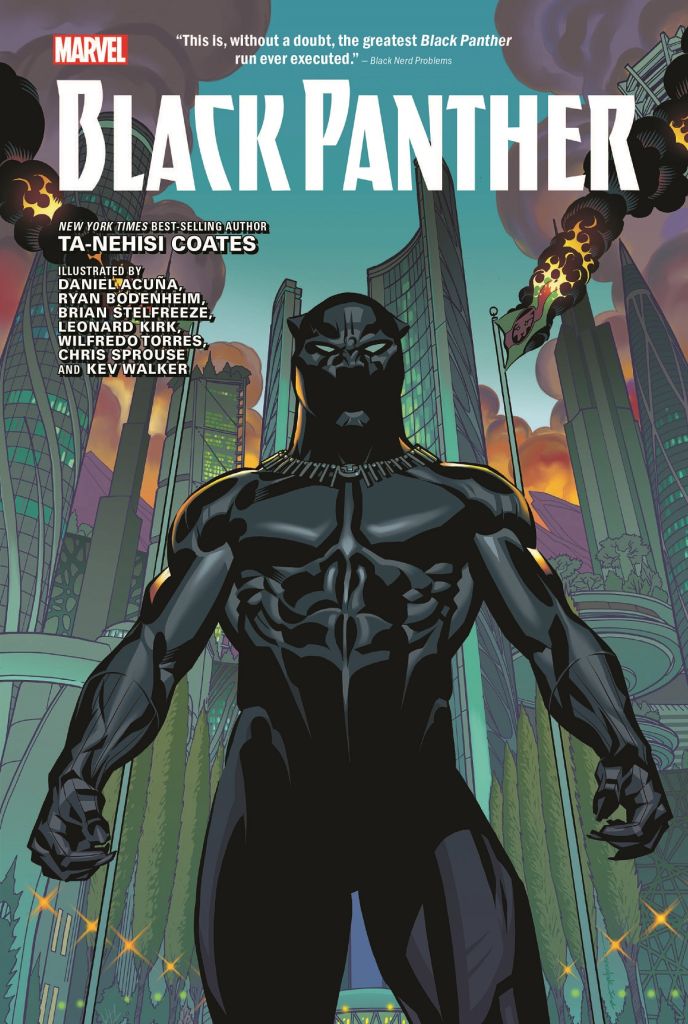
Toujours discret médiatiquement mais plus influent que jamais, Coates signait dans la foulée un thriller historico-fantastique, La Danse de l’eau (2019), tentative modérément réussie de réactualiser les récits de fugitifs de la traite négrière dans une intrigue à la Stephen King. Succès, là encore. Pour la petite histoire, les droits français du livre avaient été arrachés de haute lutte par Fayard, période pré-Bolloré.
Notre dernière conversation remontait à cette époque-là, dans les limbes de la pandémie de covid. À distance : les bavardages promo en visio étaient devenus la norme. Barbe fournie, décor bucolique de maison de campagne en arrière-plan, Ta‑Nehisi Coates m’expliquait qu’il était devenu écrivain. Commenter les intrigues politiques du moment – soit le premier mandat de Trump – n’était plus vraiment à sa hauteur. Son ambition était de changer la culture américaine en la prenant à la racine, en remodelant ses mythes fondateurs, dans une sorte de logique mi-gramsciste mi-hollywoodienne, depuis sa tour d’ivoire. Le studio Warner Bros venait de lui confier le gros lot : la réinvention de Superman en surhomme noir.
L’apartheid, c’est bien ou mal. C’est très, très simple.
On l’avait ainsi perdu de vue jusqu’à l’automne 2024. Soudain, les images d’un clash brûlant tournaient en boucle sur TikTok et Instagram. Coates était de retour, comme un boxeur qu’on pensait à la retraite remontant sur le ring, avec un nouveau livre et une nouvelle polémique. Tant qu’à faire, sur le sujet le plus incendiaire possible : le conflit israélo-palestinien. Un an après le 7‑Octobre, sur le plateau de la matinale CBS Mornings, il était venu marteler son pitch.
Selon lui, ce qui se passe au Proche-Orient depuis des décennies n’a rien de compliqué, contrairement aux « narratifs » biaisés qu’entretiendrait la doxa occidentale. Ce qu’Israël fait aux Palestiniens, qu’importent les arguties géopolitiques ou sécuritaires, ne serait que l’application froide et méthodique d’un agenda colonial, culminant avec une guerre d’annihilation à Gaza. Et qui, en Cisjordanie, prend la forme d’une politique de ségrégation identique en tout point à celle en place dans le Sud américain jusqu’à la lutte pour les droits civiques, ou à la situation en Afrique du Sud jusqu’à la libération de Mandela.
Et de conclure qu’Israël et ses soutiens n’ont aucune excuse : « L’apartheid, c’est bien ou mal. C’est très, très simple. » L’animateur de l’émission, Tony Dokoupil, s’indignait. Quid du Hamas ? Des massacres et des roquettes ? « Si on retire votre nom, toutes vos récompenses et les éloges de la couverture pour ne garder que le contenu, concluait-il, votre livre aurait toute sa place dans le sac à dos d’un extrémiste. » L’échange viral suscitait une polémique à tiroirs au sein de la chaîne, déjà laminée par les grandes manœuvres de rachat du groupe Paramount par le tech-milliardaire Larry Ellison, un proche de Donald Trump ostensiblement pro-Israël.
En procureur moraliste
Ce jeudi de novembre 2025, l’« extrémiste » est donc à nouveau face à moi, à quelques pas des grands magasins déjà ornés de décorations de Noël, dans une salle de réunion stérile des locaux de Flammarion (la maison mère des éditions Autrement, qui continuent d’éditer ses essais en France). Aminci, le dos droit et le profil altier, il porte un fin blazer marine et une chemise bleu clair, ses bouclettes blanchies coupées ras. Il a l’aura d’un diplomate, voire d’un homme d’État – on pense un instant, sans doute par facilité, à la prestance d’Obama, comme si l’homme et son sujet avaient morphé pour ne faire qu’un. « Oh mec, ça fait un sacré bail », lance-t-il dans un grand sourire, avec cette affabilité suave et lisse si américaine, ce charme qui se déclenche comme on presse un bouton.
Dix ans après notre discussion sur la fac d’Howard, ce fils d’une institutrice des quartiers chauds en est désormais l’un des professeurs, chargé d’un programme de « creative writing ». Le livre si controversé qu’il vient promouvoir, Le Message, au titre aussi simple qu’abrasif, se présente justement sous la forme d’un cours d’écriture adressé à ses étudiants, qu’il voit comme ses héritiers. Les temps ont changé, son rapport aux mots, aux textes, au journalisme tout entier aussi. Coates, qui dit avoir perdu « le luxe de se taire », ne se rêve plus poète loin des affaires des hommes, ni même reporter fouineur et méticuleux comme à ses débuts. Il réapparaît en procureur moraliste, tout en emphase, le « je » envahissant chaque page. Le Message, découpé en trois parties, parle donc de ça : quand le monde se rappelle à l’écrivain dont on a crevé la bulle pour le replonger dans la guerre des récits, redécouvrant l’adage selon lequel l’histoire est toujours écrite par les vainqueurs.
« Honteux d’être blancs »
Le premier chapitre, le plus superficiel, l’envoie au Sénégal frotter sa négritude à la lumière du passé colonial du continent, terre ancestrale idéalisée où il met les pieds pour la première fois, la cinquantaine approchant. Dans le deuxième, il part à la rencontre d’une certaine Mary Wood, prof de lycée blanche de Caroline du Sud qui se bat pour enseigner son best-seller Entre le monde et moi à sa classe de terminale, alors que le school board local vient de le bannir. Officiellement, le livre causerait de la « détresse psychologique » chez les élèves, en leur faisant courir le risque de se sentir « honteux d’être blancs ». Coates note à l’occasion comment les préventions hypersensibles de lecture (alertes « trigger warnings », suppression de termes offensants…) attribuées à la « cancel culture woke » ont été habilement détournées par les forces réactionnaires pour imposer leur censure. Enfin, dans le dernier chapitre, nettement plus long, l’écrivain tire donc les conclusions volontairement simplistes d’une visite de la Cisjordanie à l’été 2023, juste avant le 7‑Octobre.
Au-delà de l’accrochage télévisuel sur CBS, le livre n’a pas été bien reçu aux États-Unis, qualifié de prêchi-prêcha binaire et ampoulé, voire vaniteux, y compris dans les colonnes qui avaient longtemps sanctifié Coates, à l’instar du New Yorker ou du New York Times. On démarre l’entretien là-dessus. « La moitié du bouquin parle de la Palestine, j’étais sûr que ça mettrait en rogne pas mal de monde », balaye-t-il. La voix est douce, le propos tranchant. L’homme n’a rien perdu de son charisme. Il raconte qu’il a découvert la question palestinienne sur le tard, longtemps intimidé par l’ampleur du sujet, et qu’il s’est senti trahi quand il s’y est penché.
« Le plus difficile à admettre pour moi, c’est que ces gens dont je suis proche, ces collègues qui avaient couvert cette partie du monde, qui étaient allés à Jérusalem, avaient vu la même chose que moi mais, au fond, ne l’avaient pas vue comme moi. Les routes séparées [en Cisjordanie], l’accès à l’eau inégalitaire, les systèmes judiciaires différents selon qu’on est Palestinien ou Juif israélien, les arrestations arbitraires… Ils ont vu tout ça de leurs yeux mais, à la fin, ils font comme si ce n’était qu’une dispute complexe entre deux peuples au même niveau ! Pourtant, on ne manque pas d’analogies historiques pour décrire cette situation : ça s’appelle l’apartheid. »
Comme la peine de mort ou la torture
Dans Le Message, il en tire une réflexion provocatrice sur sa profession, coupable à ses yeux d’« élever la complexité factuelle au-dessus de l’évidence morale ». Dit autrement, l’abondance d’informations servirait à obstruer la manifestation de la vérité. Ou, a minima, l’opinion qu’on doit s’en faire. « Je me suis rendu compte que j’avais accepté un peu trop facilement les grands préceptes du journalisme, pose-t-il, d’emblée. L’idée que, en gros, on va quelque part, on récolte tout un tas de faits, on met au propre, et tout se clarifie. Mais les faits ne vous donnent pas de cadre moral. »
D’autant que les faits ne sont jamais purs, toujours sélectionnés, spécifiquement agencés, note-t-il. « Il y a les faits qu’on minore, ceux qu’on souligne. De la même manière, on me dit : “Hey, Ta‑Nehisi, pourquoi tu n’écris rien sur le Hamas ?” Parce que, pour moi, la question n’est pas là. Elle est simple : est-ce que tu es pour ou contre la ségrégation ? Si Israël est une démocratie, qu’est-ce qui justifie un traitement inégalitaire comme la construction de routes séparées ? Rien. C’est comme la peine de mort, ou la torture, si tu es contre, tu l’es dans tous les cas de figure. Peu importe si le condamné est un horrible violeur d’enfants ou si une bombe risque d’exploser parce qu’on n’arrive pas à faire avouer un terroriste. C’est le prix à payer pour avoir des valeurs. »
Coates en revient toujours à l’ère des lois Jim Crow, celles de la ségrégation raciale dans le Sud américain. « Dans les années 1950, les sudistes avançaient tout un tas de “faits” pour s’opposer à la mixité. Ils disaient : “Mais vous avez vu le taux de criminalité dans les ghettos noirs de La Nouvelle-Orléans ? On ne peut pas vivre avec ces gens-là, ils sont trop violents !” Dans certains cas, les faits sont hors sujet dès lors qu’on a pris une position morale claire. »
« Avec nos propres missiles »
Peut-on régler un conflit centenaire avec une telle intransigeance ? Ou bien remporter des élections, ne serait-ce que dans le contexte américain ? Peu son affaire : malgré son costard, Coates n’est ni diplomate « ni candidat à la présidence ». Mais nous renvoie à la victoire de Zohran Mamdani à la mairie de New York et à ses déclarations résolument propalestiniennes, « courageuses » en son sens. Incapable de se positionner sur un sujet – Gaza – qui électrise sa base, l’establishment démocrate, selon lui, « ne sait plus pour quoi et pour qui il se bat ».
Il mentionne ainsi comment Kamala Harris, en campagne pour la Maison Blanche, a mis plus d’énergie à courtiser le soutien de la famille Cheney (dont Dick, le patriarche, était l’éminence grise de George W. Bush durant la guerre d’Irak) qu’à freiner les bombardements sur l’enclave palestinienne. « Comment est-ce que je peux faire partie d’un mouvement qui n’a même pas la volonté de s’opposer à la destruction d’une population, le tout avec nos propres missiles ? » Il va plus loin : « Le fond du problème avec les démocrates, mon propre camp en général, et je déteste le dire comme ça, c’est que nous n’avons plus de batailles pour lesquelles nous sommes prêts à mourir, littéralement. Quand j’étais enfant, les gens qui luttaient contre la ségrégation, l’apartheid, ils étaient prêts à ça, à mettre leur vie en jeu. »
Ce crédo strident résonne avec un autre sujet brûlant aux États-Unis : la violence politique. Ces derniers mois, elle est partout, de la popularité inouïe de Luigi Mangione, poursuivi pour avoir abattu un ponte des assurances dans une rue de New York, à l’assassinat du polémiste pro-Trump Charlie Kirk en plein débat public, le 10 septembre 2025. Là encore, Ta‑Nehisi Coates a renfilé les gants de boxe pour répondre à Ezra Klein, éditorialiste du New York Times et nouvelle coqueluche des centristes, auteur d’un éloge funèbre controversé intitulé « Charlie Kirk faisait de la politique de la bonne manière », en défense de la liberté d’expression. Quelque part, en version droite chrétienne conservatrice, c’est le retour du débat « être Charlie ou pas » – de l’hebdo satirique à Kirk.
C’est le spectacle de la mort de Kirk qui a choqué. C’est juste que les Blancs n’ont pas l’habitude de voir ça.
S’il condamne, évidemment, le meurtre de l’influenceur MAGA par un sniper aux motivations floues, Coates considère qu’on ne peut faire abstraction de la brutalité de sa rhétorique, largement qualifiée de raciste, misogyne et homophobe avant sa mort. « Les mots ne sont pas violents en soi, mais ils ne sont pas sans pouvoir non plus », écrivait-il en réponse à Ezra Klein dans Vanity Fair. Et de demander à l’éditorialiste et à ses soutiens : « Si vous êtes prêts à faire abstraction des propos de Charlie Kirk, de quoi d’autre allez-vous détourner le regard ? » Les deux ont ensuite longuement débattu de la question dans un podcast, comme le veut désormais l’usage. Face à nous, l’auteur du Message commente froidement : « Il n’existe pas de politique, certainement pas en Amérique, sans violence. Ce n’est pas quelque chose dont je me félicite, mais… c’est un fait. »
Les États-Unis ont certes vu, depuis leur fondation, quatre de leurs présidents tomber sous les balles. Mais, pour Coates, la rupture amorcée par l’agonie en mondovision de Kirk est tout autre : « C’est le spectacle de sa mort qui a choqué, la façon dont ça a été capté en direct et visible partout sur les réseaux sociaux. Les Noirs ont l’habitude de ça. Pour nous, la mort de George Floyd [filmé en train d’étouffer lors d’un contrôle de police, symbole du mouvement Black Lives Matter], c’était déjà une démonstration de violence politique. Les lynchages dans l’entre-deux-guerres immortalisés en cartes postales, c’était aussi ça. C’est juste que les Blancs, notamment à droite, n’ont pas l’habitude de voir ça. »
Ce détachement, pour ne pas dire ce manque d’empathie, envers le camp d’en face est aussi ce que lui reprochent Ezra Klein et, plus généralement, tout un pan du commentariat occidental. La radicalisation de toute une partie de la gauche, les fameux « wokistes », dont il serait le précurseur et l’incarnation, serait responsable de l’arrivée au pouvoir de Trump. Et, par décalque, d’autres figures autoritaires en Occident, de Giorgia Meloni en Italie à la montée en puissance du Rassemblement national en France. « Je ne pense pas que ce soit moi ou les gens comme moi qui avons convaincu Trump et la plupart des républicains qu’Obama n’était pas né aux États-Unis – ce qu’ils ont commencé à dire dès son élection, se défend-il. Le problème, ce n’est pas nous, c’est ce que l’Amérique est. Est-ce qu’on a enragé toute une partie du pays en réclamant d’être traités comme des êtres humains égaux ? Probablement. »
Éliminer une idéologie
Le problème, à ses yeux, n’est pas la conflictualité, mais le refus des démocrates de s’y engager. « C’est ce qu’une bonne partie de nos alliés ne réalise pas : on se bat contre ces gens. On n’est pas en conversation avec eux. On est là pour éliminer leur idéologie. C’est une confrontation, pas un débat. La plupart de nos adversaires, désolé de le dire, ne seront jamais convaincus. Ça ne veut pas dire que, dans mes écrits, je sois complètement insulaire : je cherche à être compris et soutenu. Mais il ne faut pas perdre de vue la nature de l’opposition en face. »
Dans un souci de cohérence, Coates ne s’indigne pas de l’hystérisation du débat public, de l’ouverture béante de ce que les politologues appellent la « fenêtre d’Overton », soit le spectre des opinions dicibles, et donc acceptables, en société. Pour lui, ceux qui regrettent les « désaccords polis » sont en fait nostalgiques d’un temps « où tout le monde n’avait pas la parole » : « Bien sûr, les “discours haineux”, comme on les appelle, sont moins subtils qu’avant. Plus besoin de sous-entendus façon “ultrasons rhétoriques” [“dog-whistle”, en anglais]. Mais rien de tout cela n’est neuf. Je pense que le retour du refoulé actuel, ce qui explique pourquoi le moment politique est si intense, est dû au fait que désormais, de l’autre côté, non seulement les Noirs s’expriment, les minorités s’expriment, mais aussi les personnes queers, trans, etc. »
La question en suspens est : jusqu’à quand ? Le Wall Street Journal a rapporté récemment que David Zaslav, le patron de Warner Bros, avait gelé le développement du projet de Superman noir de Coates, jugé « trop woke ». Aucune nouvelle non plus de l’adaptation annoncée de son roman La Danse de l’eau par la réalisatrice noire Nia DaCosta. Vu qu’il est question de business, l’écrivain pèse chaque mot au trébuchet : « Rien n’est officiellement annulé. Ce que je peux dire au sujet de Superman, c’est qu’on m’a demandé d’écrire un scénario, et je l’ai fait pendant des années – j’étais payé jusqu’en 2024. Mais ça ne m’appartient pas. Ça n’a jamais été mon rêve, d’ailleurs, d’écrire Superman ! Je ne suis pas allé toquer à la porte de la Warner en disant : “J’exige que vous sortiez un Black Superman !” Disons qu’à une certaine époque, les studios ont pensé qu’ils pouvaient faire de l’argent avec ça, et qu’il leur semble que ce n’est plus le cas. Même si, à mon avis, le marché n’a pas changé… »
Hexagone et racisme
La fin de notre conversation bifurque sur Paris, où il revient souvent, même si son français reste sommaire mais suffisant pour commander un café. Son cercle intellectuel comprend la fine fleur des « décoloniaux », l’universitaire Maboula Soumahoro, la militante Rokhaya Diallo, la cinéaste Mati Diop… Il juge que la France, avec ses institutions, est « mieux armée que les États-Unis pour combattre le fascisme, mais sans doute moins équipée face au racisme », en référence au moindre poids, dans l’Hexagone, des organisations communautaires – son tropisme américain, là encore.
Il remarque, au détour d’une formule poliment troussée, que, dans la série d’entretiens qu’il a accordés ces jours-ci pour promouvoir Le Message, pas un « journaliste noir ou arabe » ne s’est présenté face à lui. À l’heure de se quitter, Coates pose quelques questions sur nos reportages à Gaza (où il n’a pas pu se rendre), promet de prendre des nouvelles. Et s’en va retourner dans l’arène trumpiste, vêtu de son costume immaculé.