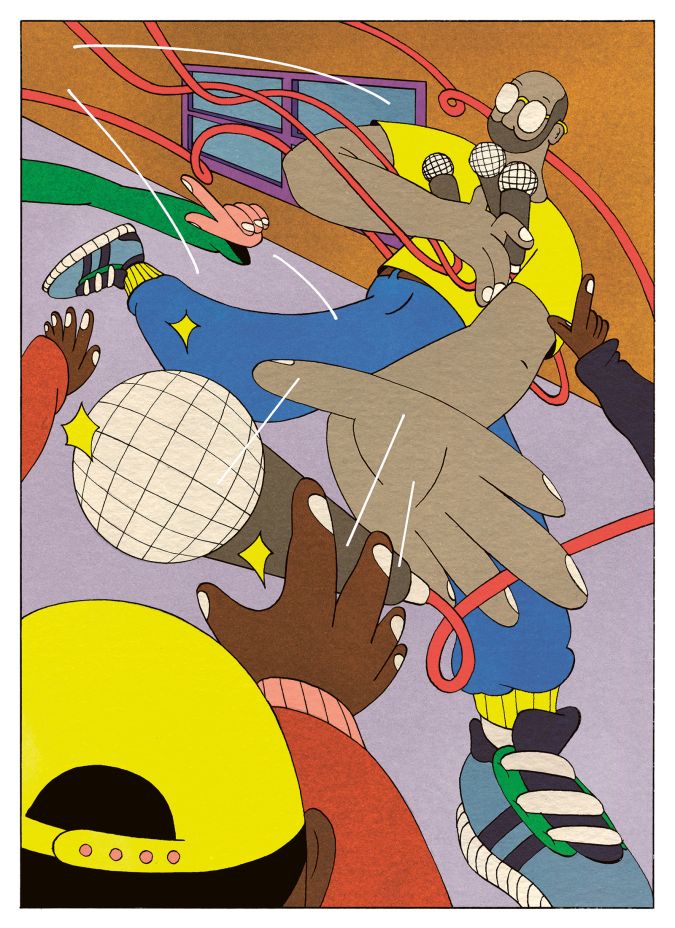Le sanglier est-il le mal aimé de la forêt ?
Les protecteurs de la nature parlent des cerfs, des chevreuils, des mouflons, des bouquetins, mais rarement du sanglier, comme si cet animal n’était plus une véritable composante de la biodiversité. Le sanglier a été effectivement « transformé » pour répondre aux besoins de la chasse dans les années 1970, quand le petit gibier – lièvres et lapins – a été victime de la modernisation de l’agriculture et de l’usage de certains produits sur les terres. À cette époque, il a été élevé et lâché pour être chassé, en conservant les jeunes reproducteurs et les reproductrices. Mais, depuis les années 2000, le sanglier est devenu un problème, en raison des dégâts croissants qu’il cause dans les champs. Il est même devenu un souci pour les chasseurs ! Leurs fédérations doivent dédommager les exploitants agricoles pour ses ravages à partir d’un certain seuil – c’est inscrit dans la loi de finances. Alors ils sont sommés de tuer toujours plus de sangliers. Ce qui ne correspond pas à l’essence même de la chasse.
Quelle est l’essence même de la chasse ?
L’animal doit avoir une chance de s’échapper et le chasseur, le choix de tirer ou de renoncer. Tuer en masse des animaux – 800 000 sangliers sont éliminés tous les ans – transforme les chasseurs en opérateurs de destruction de la faune dite « à problème ». Cela induit une forme de « désanimalisation » de cet être vivant, qui n’est plus respecté ni traité comme tel. Ce qui implique, depuis qu’il est considéré comme « un problème », d’abattre les marcassins et les femelles. Le sanglier est pourtant une espèce avec des facultés de vivacité et d’adaptation incroyables. Contrairement au chevreuil, il se défend. Il ne recule pas, il se bagarre contre les chiens. Historiquement, le tuer a toujours été un acte de combativité. Simplement, aujourd’hui, il dérange. Du fait de nos interventions multiples sur sa reproduction et son habitat, il n’est plus tout à fait sauvage sans pour autant être tout à fait domestique.
Que signifie ce terme de « régulation » ?
La possibilité de « réguler » signifie qu’il y aurait un état de référence sur lequel se fonder. Mais lequel ? Celui-ci diffère selon la capacité d’accueil des territoires. Avec le terme de « régulation », on nie l’individualité du sanglier. On ne questionne plus sa relation à la mort, à la douleur, son caractère propre et ses modes d’existence. L’envisager comme « une masse animale qui déborde » autorise sa destruction. Dans notre imaginaire, le sanglier est une espèce surabondante et banalisée – une espèce des pare-chocs, des bords de routes et des parties de chasse. La facilité serait d’accuser les chasseurs d’avoir joué aux apprentis sorciers en favorisant sa reproduction sans pouvoir désormais la contrôler. Or le « problème » est toujours multifactoriel. La forêt, qui fournit des fruits, progresse sur les versants escarpés et attire les animaux. Aussi, le changement climatique entraîne des hivers plus doux et une mortalité naturelle plus faible. C’est à prendre en compte dans la mobilité des bêtes. Autant que la crise des vocations et le manque de revenus dans certaines fédérations de chasse.
Quand le sanglier a-t-il été respecté ?
Quand il était rare, jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. De grands naturalistes l’ont recherché pour l’observer, comme le Suisse Robert Hainard. Avant les années 1960, le sanglier était également convoité par les chasseurs, mais d’une autre manière. Il était le symbole du « sauvage ». Dans les années 1980 et 1990, il s’est banalisé du fait de sa démultiplication et du retour du loup, qui a, en quelque sorte, accaparé toute l’attention. Toujours est-il que la figure du sanglier a traversé l’histoire, et ce, depuis l’Antiquité. Dans la mythologie grecque, il était craint car envoyé par les déesses pour punir les villageois de l’insuffisance des prémices – des offrandes religieuses.
C’est aussi un animal de journaux, chroniqué chaque fois qu’il entre dans les villes.
Il n’a pas toujours été très éloigné de l’homme, en réalité. Au Moyen Âge, il s’approchait des fermes et des villages, s’accouplait avec les truies des élevages en semi-liberté. Pendant le confinement s’est popularisée une expression quand un animal apparaissait au milieu des immeubles : « La nature s’invite en ville. » C’est l’inverse, pourtant. Avec l’étalement urbain, bien souvent, c’est la ville qui s’invite dans les territoires des animaux sauvages et les campagnes.