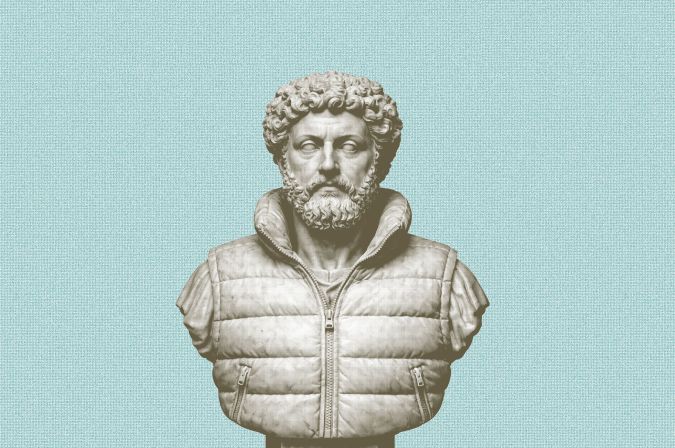L’armée guinéenne est souvent décrite comme un agent déstabilisateur plutôt que pacificateur. Comment percevez-vous sa trajectoire depuis l’indépendance du pays en 1958 ?
Jusqu’en 2011, il est difficile de parler d’armée nationale en Guinée. C’est plutôt une entité désorganisée dont chaque président a fait un instrument pour assurer sa survie politique. La Guinée est un pays multi-ethnique, et le choix fait jusqu’à cette période par les chefs d’État a consisté à confier les rênes de l’appareil sécuritaire à des membres issus de leur communauté afin de sanctuariser leur pouvoir. Le tout allant de pair avec un système fondé sur la peur ainsi qu’une certaine brutalité : lors de mon arrivée à Conakry en tant que chef de la coopération de sécurité et de défense du Quai d’Orsay en 2010, j’ai été frappé par la crainte qu’on lisait dans les yeux de la population à la vue d’un uniforme. Des militaires de tous grades arpentaient les rues de la capitale dans des 4x4, arborant cartouchières et décorations fantoches. On se serait presque cru dans une scène du film Blood Diamond !
L’arrivée d’Alpha Condé au pouvoir en 2010 a-t-elle temporairement mis fin à cette situation chaotique ?
En effet. Avant cette date, la Guinée n’a connu que des présidents issus de l’armée, à l’exception du premier chef d’État du pays après l’indépendance, Ahmed Sékou Touré. Il ne m’appartient pas de porter jugement sur la manière dont Alpha Condé a exercé le pouvoir, mais on ne peut nier les efforts qu’il a su déployer sur le plan sécuritaire pour remettre le pays sur les rails. Très vite après son élection, il a su mesurer le danger que représentait pour le pays la situation anarchique qui régnait, notamment dans la capitale, du fait de la non-maîtrise de la machine militaire. Il a alors fait appel à la France pour l’aider à procéder à une refonte totale du système sécuritaire national. Afin de recréer un lien de confiance entre la population et l’armée, nous lui avons recommandé dans un premier temps d’évacuer une bonne partie des militaires stationnés dans la capitale et de les relocaliser dans les zones rurales, afin qu’ils prennent part à des travaux d’infrastructures.
Nous lui avons ensuite conseillé de recenser l’ensemble des acteurs œuvrant dans le domaine sécuritaire, puis de de rédiger un livre blanc dans le but d’identifier les principales menaces pesant sur les intérêts du pays : terrorisme, mais aussi catastrophes naturelles et épidémies. Cet exercice a débouché sur la création de nouvelles entités, parmi lesquelles un bataillon de maintien de la paix, un service de sapeurs-pompiers – qui s’est particulièrement illustré lors de la lutte contre l’épidémie d’Ebola en 2015 – ainsi que l’Agence de service civique d’action pour le développement (Ascad) au profit de la jeunesse guinéenne. Cette unité encadrée à la fois par des civils et des militaires a d’ailleurs été maintenue par le président Mamadi Doumbouya. En 2017, l’outil de défense guinéen avait fini par trouver sa juste place et contribuait activement à l’unité du pays.
Malgré ces transformations, Alpha Condé a été renversé par le coup d’État militaire de Mamadi Doumbouya en 2021. Comment l’expliquez-vous ?
En 2017, la menace terroriste au Mali voisin s’est amplifiée, et tous les partenaires de la Guinée ont commencé à s’inquiéter qu’elle puisse pénétrer le pays par la frontière nord. Avec l’appui de la France, Conakry a alors créé une unité de forces spéciales, spécifiquement dédiée à la sécurisation des frontières. C’est paradoxalement à ce moment que le ver a été introduit dans le fruit, car cette entité n’a pas été raccrochée à l’armée guinéenne mais curieusement placée hors hiérarchie.
Il fallait quelqu’un de confiance pour la diriger, et Mamadi Doumbouya rentrait de l’École de guerre française à ce moment-là. Le problème, c’est que cette unité a très vite échappé au contrôle de l’armée et du ministère de la Défense. Doumbouya s’est dès lors comporté de manière autonome, et ses hommes ont reçu un traitement privilégié en matière d’équipement, de formation et d’entraînement. Ce qui n’a pas tardé à agacer au sein des hautes sphères de l’écosystème sécuritaire guinéen. La structure centralisée et unifiée qui avait été bâtie devait composer avec une unité indépendante dont le chef ne voulait surtout pas qu’elle rentre dans le rang et se retrouve subordonnée à l’armée nationale. La suite est connue.
Alors que l’armée française a dû se retirer du Sahel sous la pression des juntes malienne, burkinabè et nigérienne, comment analysez-vous le maintien de la coopération militaire franco-guinéenne ?
Les leviers sur lesquels se sont appuyés les coups d’État en zone sahélienne ne sont pas les mêmes qu’en Guinée. Au Sahel, on a assisté à une forme de contestation liée à la faillite des États, dans l’incapacité de remplir les missions régaliennes de base – santé, social, éducation, sécurité –, ainsi qu’à l’échec de la réponse sécuritaire portée contre le terrorisme, la France étant en première ligne dans ce combat. En Guinée, la situation est totalement différente. La prise de pouvoir relevait plus de l’opportunité, répondant à la crainte d’avoir à rendre des comptes.
Contrairement à ce qu’on a pu observer dans le cas du Niger au cours de l’été 2023, la communauté internationale a à peine dénoncé le coup d’État mené par Doumbouya. La France elle-même a été très discrète, appliquant le principe de réalité puisque le nouveau venu semblait être solidement installé au pouvoir. Dans ces conditions, pourquoi prendre le risque de couper les relations avec le pays ? Ça n’était dans l’intérêt de personne.