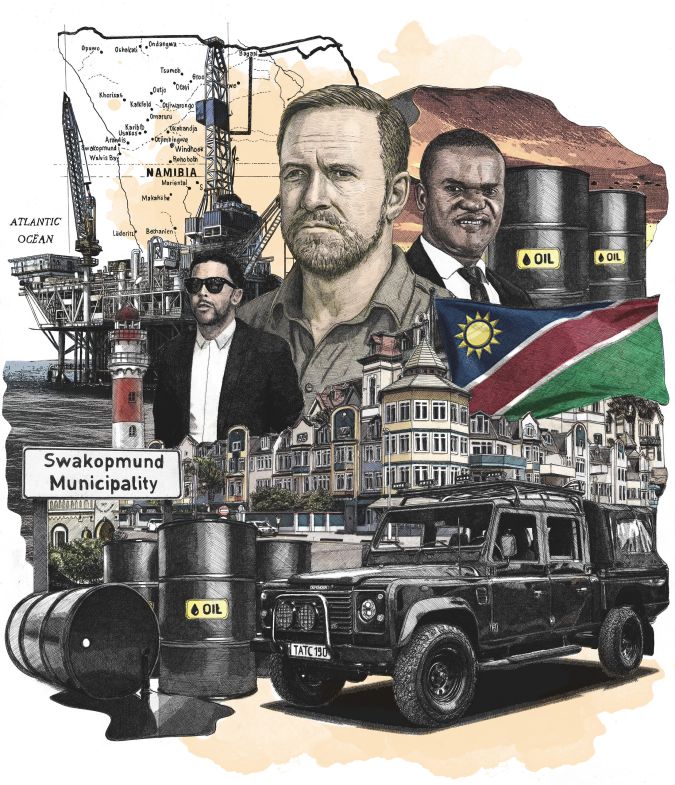Plusieurs gosses hébétés traînent un ventre dilaté. Dans ce village d’Ambarato, une dizaine de cases en bois et en chaume au milieu de buissons ras et de prairies, les joues sont creusées, les membres maigres sous les pagnes aux couleurs vives, les regards vagues et vides, apeurés et résignés. Des regards si caractéristiques de ceux qui ont faim et savent que ça va durer.
Depuis des mois, hommes, femmes et enfants n’ingèrent que des goyaves sauvages pas mûres, des fruits de cactus, quelques insectes, des feuilles, un peu de manioc. Sous le soleil de feu, le peu de riz récolté sèche sur des nattes. À l’ombre de sa case, Narina, la trentaine, berce amoureusement son nouveau-né. Son septième enfant. Elle a perdu les six précédents en couche, de faiblesse sans doute. Dans ce village proche de la grande ville de Betroka, dans le sud de Madagascar, la faim a déjà pris des vies.
Depuis 2019, une sécheresse inhabituelle ravage les cultures. La famine – le kere, en malgache – a atteint son pic morbide entre mi-2020 et début 2021. Dans les régions Anôsy et Androy, pas de décompte officiel, mais on estime les victimes à plusieurs milliers, et les dénutris à des centaines de milliers, voire des millions. Depuis fin 2020, le Programme alimentaire mondial (PAM), qui dépend de l’ONU, distribue nourriture et argent. Il a sauvé des milliers de vies en urgence et assiste toujours environ un million de personnes. Dans ce pays si riche sur le papier, qui exporte vanille, litchis et lingots d’or, comment en est-on arrivé là ? Le PAM a une explication.
La région est connue comme « un cimetière de projets », une terre brûlée par l’insécurité et la corruption.
Smartphone en mode selfie. Polo bleu. Pommettes rougies par le soleil. En arrière-plan, des familles frappées par la famine. L’Américain David Beasley, grand patron du PAM, est en plein plaidoyer humanitaire : « Voici la ligne de front de l’impact du changement climatique. La région est touchée par une sécheresse continue. La vie des habitants a été dévastée », se lamente l’ancien gouverneur de la Caroline du Sud, dans une vidéo diffusée le 21 juin 2021.
Ce serait donc la faute du changement climatique, qui a provoqué « la pire sécheresse depuis quarante ans ». Et donc la faute des pays riches qui polluent beaucoup. Comme les Malgaches polluent peu, ils subiraient les conséquences des autres. Une injustice climatique. La première.
Explication bizarre. Le sud de -Madagascar reçoit au minimum 750 millimètres de pluie par an. En Israël ou en Arizona, c’est moitié moins. Imagine-t-on une famine là-bas ? La région est connue comme « un cimetière de projets » de développement, une terre brûlée par l’insécurité et la corruption, où la population a rasé les forêts. Où les famines sont récurrentes depuis plus d’un siècle. Bien avant le changement climatique.
Un beau coup médiatique
D’ailleurs, des scientifiques réfutent la thèse du PAM. Le manque de pluie, de juillet 2019 à juin 2021 dans le Sud, « n’a pas augmenté de manière significative en raison du changement climatique d’origine humaine », écrit, le 1er décembre, le World Weather Attribution. Ce collectif de scientifiques est spécialisé dans l’attribution – ou non – d’événements météorologiques extrêmes au changement climatique. Leurs données contredisent l’affirmation de « pire sécheresse depuis quarante ans ». En clair, le changement climatique mondial n’est pas responsable du fait qu’il ne pleuve pas assez depuis 2019.
Et quand on questionne Pasqualina Disirio, la directrice du PAM pour -Madagascar, elle confirme : en 2020, « il y a eu des changements au niveau du climat, comme le manque de pluie et les vents de sable ». Mais est-ce vraiment dû au changement climatique global, comme le professait David -Beasley en juin 2021 ? « Possible, ça demande des études plus pointues. Je ne veux pas rentrer dans ce débat scientifique », répond-elle. Quelque chose cloche dans cette « famine due au changement climatique ». Mais la thèse se répand. En fait, il s’agit d’un des coups médiatiques les plus réussis de ces dernières années.
Tout part de cette vidéo de David Beasley, diffusée sur Facebook et Twitter le 21 juin. Le 23, le PAM sort un communiqué officiel. Le même jour, CNN donne la première résonance médiatique : Beasley, qui a renfilé un costume trois pièces, apparaît, le ton grave, au milieu d’images déchirantes d’enfants faméliques. Et l’histoire prend. Les mois suivants, de nombreux médias citent l’ONU, ou se recopient entre eux : l’Agence France-Presse – reprise par de nombreux journaux –, Ouest -France, Sud-Ouest, France 24, le Time magazine, Sky News, Envoyé spécial (le magazine d’Élise Lucet, malgré deux semaines sur le terrain), National Geographic… Ainsi qu’Amnesty International. Impossible de tous les nommer.
Pour répandre une narration, une solution : le voyage de presse. Avion, hôtels, 4x4. Tous frais payés.
Le pouvoir malgache se saisit de l’aubaine. Ce storytelling lui permet de se dédouaner d’une bonne part de ses responsabilités, et de demander de l’argent. Pour répandre une narration, une solution : le voyage de presse. La présidence l’organise du 26 septembre au 2 octobre 2021. Avion, hôtels, 4x4. Tous frais payés. Le séjour est piloté par l’agence de communication française Concerto. Sa consultante, Nachouat Meghouar, qui accompagne les journalistes, et son PDG, François Hurstel, travaillent en direct avec le président Andry Rajoelina depuis sa campagne victorieuse de 2018. Le séjour promeut aussi l’action gouvernementale – comme une usine de produits nutritionnels, un centre de coordination, la fixation de dunes. Répondent à l’appel, entre autres, Paris Match, Les Échos, Le Figaro… Le PAM, l’Unicef, la Banque mondiale, l’agence des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture participent à cette messe.
Quelques semaines plus tard, les articles paraissent. Les échos : « Madagascar asphyxiée par le vent brûlant du réchauffement climatique ». Paris Match : « Madagascar : Au commencement de la faim », avec photo de l’hélicoptère présidentiel en plein atterrissage, et décrit comme « très attendu ». Le Figaro : « La première famine climatique ». Tous perdent leur distance critique. Tous indiquent que leur journaliste est un « envoyé spécial ». Début novembre 2021, à la COP26, l’ONU et la ministre malgache de l’Environnement d’alors, Baomiavotse Raharinirina, en remettent une couche. France 24 lui offre sept minutes d’interview très favorables.
Volte-face début décembre, quand l’AFP diffuse la thèse du WWA. De nombreux médias affichent désormais deux assertions opposées : un coup le changement climatique cause la famine, un coup non. Mais la « famine climatique » est passée dans l’opinion publique. La chaîne de production de la « vérité » a fonctionné. Les Malgaches qui « meurent de faim à cause des riches » sont de bons supports de communication.

Pourquoi raconter cela ? L’ONU cherche de l’argent, « en urgence ». « Les nations industrialisées ont une obligation morale d’aider ces victimes innocentes du changement climatique », gémissait David Beasley sur CNN. Le PAM a d’abord réclamé 78,6 millions de dollars, puis plus de 200 millions. Finalement, en 2021, le PAM a reçu environ 100 millions, selon le chiffre fourni par l’institution. Pour Nachouat Meghouar, responsable de l’activité politique chez Concerto, l’impact du changement climatique, « loin d’avoir été inventé lors de ce voyage, avait déjà été établi par de nombreux médias et experts ». Et « rien n’a été caché » dans ce voyage de presse, qui « illustrait la grande diversité des causes de la malnutrition : inflation, sécheresse, déforestation, besoin de transparence accru dans la gestion des aides ».
Mais si la famine n’est pas climatique, d’où vient-elle ? Qui est responsable ? Et comment y remédier ? Pour comprendre, je pars à moto vers le sud. Depuis la capitale, Antananarivo, il faut deux jours et demi sur la tortueuse RN7 pour atteindre le nord du « Grand Sud ». On tourne alors sur la RN13, artère qui a perdu son bitume depuis longtemps. En 4x4, comptez vingt-cinq à trente heures pour parcourir ses 500 kilomètres, d’Ihosy à Tôlanaro. Deux ou trois fois plus pour les camions de marchandises. Quand il pleut trop, les rivières et la boue coupent la -circulation. Et gare aux crevasses.
Première étape : Betroka, qui borde la rivière Mangoky. En cette saison, zébus, hommes, femmes et enfants traversent à pied un fleuve qui, avec la sécheresse, s’est fait pédiluve. Autour de la ville s’étendent à perte de vue des champs à sec, vides, où devraient pousser manioc, patates douces, maïs, riz. La terre jaune-orange, durcie par le soleil, est émaillée de termitières et de buissons ras qui restent verts, un exploit. Les plantes reines sont les cactus, comme les raketa, à larges feuilles, dont les épines acérées traversent n’importe quelle semelle. Leurs fruits verts remplissent souvent les estomacs en dernier recours.
« Du travail et pas de discours », lit-on sur le fronton de la mairie de Betroka. Mais en cette saison, le soleil a mis les habitants au chômage technique. Comme dans tout Madagascar, 95 % sont agriculteurs. Tous dépendent de la pluie. Or voilà trois ans que les précipitations sont insuffisantes. Le revenu général baisse. Les commerçants ne vendent plus. L’économie est cassée.
Le piège de la pauvreté
Le pire dans le Sud, c’est que les habitants côtoient souvent les ressources. « À chaque fois que j’y ai creusé une carrière, j’ai trouvé de l’eau vers dix mètres », explique un petit exploitant minier. Les bulletins de suivi des nappes phréatiques édités par l’Unicef démontrent un vaste réseau hydrologique souterrain. Ambovombe, la capitale de -l’Androy, signifie « beaucoup de puits » !
Mais le très faible niveau d’éducation, le manque d’argent, d’infrastructures (canalisations, électricité, routes) et l’insécurité bloquent les capacités d’adaptation et l’accès à l’eau. En plus, chez les jeunes enfants, la sous-nutrition provoque un irréversible retard de développement intellectuel. La population est prise au piège de sa pauvreté. « C’est absurde, absurde ! », s’exclame Jean-Claude, à Ambarato. Ce notable arpente une rizière carbonisée en battant l’air avec ses bras, dans sa chemise bleu clair trop grande. Pourtant, trois mètres en dessous, une rivière ne tarit pas, gonflée par un barrage. Mais les habitants ne savent pas comment remonter le liquide. Il n’y a pas d’argent pour une pompe et son carburant. « Et ils n’ont pas de semences de légumes. De toute façon, ils ne savent pas comment les cultiver », déplore Jean-Claude.
« On s’est fait voler nos dix derniers zébus le mois dernier », peste Faralahy, 63 ans, le chef du village, qui nous salue d’une main rongée par la lèpre. Dans le Sud, le manque de richesses tient beaucoup à l’insécurité. Des bandits, appelés dahalo ou malaso, déciment les troupeaux. Une triple destruction, car les zébus sont une réserve de valeur en l’absence de banque, un outil agricole pour labourer, et un objet sacré pour les rites. D’où venaient les bandits ? « Andriry », gronde une fillette.
L’Andriry. Une chaîne de montagnes à l’est de Betroka, où s’évanouissent les zébus volés depuis des décennies. Le royaume des malaso. Mais il paraît qu’eux aussi ont faim, en ce moment. Les motos nous conduisent aux premières pentes, mais seules nos jambes peuvent les gravir. Un cairn borde le sentier caillouteux, signe d’un mort. « Une embrouille au retour du marché », sourit le porteur. Il y a quelques années, les habitants des montagnes étaient en conflit ouvert avec ceux des plaines. Ils ne descendaient pas sous peine de mort, et inversement. Les combats ont saccagé les patrimoines, empêché la construction d’infrastructures (barrages, ponts, sentiers carrossables). Toujours délaissé et craint, l’Andriry a été martyrisé.
En 2012 et 2013, l’État a déclenché l’opération « Tandroka », censée combattre les malaso. Mais les militaires ont pillé, tué et brûlé des villages comme Voromiantsa. Là, les militaires ont exécuté le chef en public avec trois autres personnes.
Les pommes de terre sont mortes de la sécheresse. À un moment, la rivière ne coulait même plus.
Milison, gardien d’un parc national
Milison a construit quelques cases au pied de forêts luxuriantes, dans le creux d’une vallée baignée de soleil. Le gardien du parc national local Kalambatritra habite là depuis quatre ans, avec ses douze enfants. Ses genoux sont si noueux qu’on jurerait qu’il a trois rotules, et la forêt lui ouvre des sentiers qui n’existaient pas, semble-t-il, quelques instants avant.
Milison porte un éternel sourire de Mona Lisa, sauf quand il parle nourriture. « Par jour, je ne mange qu’une fois. On est trente, j’ai besoin d’environ 13 kilos de riz, c’est trop. » Eux aussi sont pris au piège du manque de pluie et de la pauvreté. « On a déjà récolté nos carottes. Et les pommes de terre sont mortes de la sécheresse. À un moment, la rivière ne coulait même plus. » Il n’y a plus d’argent pour les semences. Mais il reste de fabuleuses quantités de haricots blancs et rouges. Ils en mangent matin, midi et soir. Et en vendent au marché, en transportant pendant dix heures des sacs de 50 kilos sur des dalles rocheuses glissantes et des corniches. Des zébus ? « Ah non ! Ça va attirer les “malaso” », sourit Milison. De sa pipe longiligne en bambou, il lâche un fantastique nuage de fumée blanche et parfumée.
Milison a un plan pour désenclaver le secteur : construire des barrages sur la rivière et ouvrir une route aux charrettes. Il a tout dessiné sur une feuille à carreaux, avec l’échelle et l’orientation. Sa famille et les autres villages feront la main-d’œuvre. Reste à acheter le ciment et les outils. « Maximum 1 000 euros. » Le prix de la famine. Ridicule mais introuvable. Les habitants manquent tellement de moyens qu’ils ne tireront même pas parti du « coup de chance », le lendemain de notre arrivée : un cyclone, nommé Batsirai. Il se déchaîne dans la nuit. Pluie à l’horizontale, arbres fracassés. « On va mourir », hurle le porteur. Un tronc manque d’écraser notre hutte. Des trombes s’abattent pendant un jour entier. Sur la côte et plus au nord, Batsirai ravage plusieurs villes.
On redescend quelques jours plus tard par des vallées encaissées. Dans plusieurs villages, Mahatsinjo, Sangniregna, on croise ces joues émaciées, ces membres chétifs, ces vêtements trop grands, ces ventres dilatés, ces regards vides. Tous ne mangent que des feuilles. Le cyclone ? « Trop tard. » La saison sèche arrivera avant la maturité des plantes, et aucun moyen de retenir l’eau.
Pourtant, des hectares de rizières sont inondés. Les rivières nous trempent jusqu’à la poitrine. Les cascades dévalent les pentes, parfois sur cent mètres. La nature se fiche du monde. Je continue plus au sud avec l’idée de creuser ces conflits qui ont détruit les patrimoines, fracturé les régions et les familles, mis tout le monde à la merci de la famine. On descend la RN13, avant d’obliquer à l’est. Le Grand Sud d’il y a cinquante ans. Des forêts sèches, zébrées de lianes, courent sur des pentes reverdies et fleuries par le cyclone. La piste en terre jaune clair ondule au rythme des collines. On croise beaucoup de baobabs.

C’est la zone considérée comme la plus dangereuse, avec l’Andriry. À Imanombo, une dizaine de jours plus tôt, un gendarme et un propriétaire de zébus sont morts. À Marotsiraka, le 31 janvier, des locaux de deux ethnies, les Antandroy et les Bara, ont bataillé. Bilan : des morts et des cases brûlées. Les premiers se sont emparés d’environ 200 zébus chez leurs ennemis, sous les yeux des autorités publiques. Ici, sur les quinze dernières années, le nombre de zébus est passé de plus de 30 000 à moins de 8 000, selon le maire. À Mahaly, plus à l’est, le cheptel a chuté de 17 000 à 200, d’après la mairie.
Mais aujourd’hui, tout est calme. Des rizières carbonisées s’étendent à perte de vue, le PAM distribue de la nourriture. C’est dans cette zone que la famine a frappé le plus fort. Fin 2020, elle y prenait plusieurs vies par jour. On pouvait compter de loin les côtes des enfants, les adultes tombaient malades et mouraient, le bétail aussi. Les habitants vendaient tout. La criminalité est montée en flèche. Le PAM a sauvé des dizaines de milliers de vies ici. Depuis, l’institution tient les habitants à bout de bras. Elle promettait de débuter cette année des programmes de résilience, et plus seulement d’urgence. En attendant, personne ne peut plus cultiver. « On est devenus des “bras croisés” », soupire un type.
On atteint notre destination en fin de journée : Tsivory, sur les contreforts sud de l’Andriry. Le matin de la Saint-Valentin, Anicet, le médecin de l’hôpital, qui fume en auscultant ses patients, nous réveille à 5 heures. Peut-on le conduire sur les lieux d’une attaque ? Avec trois gendarmes, nous embarquons, face au soleil qui perce déjà la brume.
Les victimes, père et fils, gisent dans une case, par terre. Mbola, environ 60 ans, a pris une balle en pleine tête. Mahamby, 18 ans, a le flanc gauche labouré par une charge de chevrotine. Il a régurgité du sang partout sur lui. Deux morts pour quatre bovidés volés dans l’enclos qui borde la maison. Un veau qui retardait les voleurs a eu le crâne fracassé. Les gendarmes et le médecin font les constatations. Les villageois observent, assis contre les murs, hache et gourdin à la main. L’air pèse lourd. Tout le monde s’interroge : « C’est lui ? C’est elle ? » Il y a forcément un traître parmi eux. Comme toujours.
La haine et la jalousie
C’est ce que me raconte un malaso. Dans un bar de Tsivory, il arrive discrètement, casquette sur les yeux, veste à capuche et visage juvénile. Il a 18 ans. Il est recherché. « Les “malaso” ne volent jamais des zébus au hasard, assure-t-il. Il y a toujours un commanditaire et un guide venant du village, quelqu’un qui renseigne. Le “mpanolotsy”. Parfois, c’est la même personne. Lui ne prend qu’un zébu, ou deux. Son but, c’est juste de saboter, de nuire. Les “malaso” revendent ensuite les zébus à des grossistes, à moitié prix du marché. »
Il connaissait vingt malaso qui sont morts. Pourquoi prendre de tels risques ? « Sinon, il n’y a pas d’argent pour draguer les filles », rétorque-t-il, sans rire. Et puis, des malaso ont tué son frère, et les gendarmes n’auraient rien fait. Ça paraît bizarre. Pourquoi les habitants commanditent-ils des vols s’ils ne s’enrichissent pas ? « La haine », répond-il. « Et la jalousie », ajoute le traducteur. Le malaso acquiesce.
J’entends aussi ça dans une autre histoire de famille. Fahasoava, la vingtaine, raconte d’une voix rythmée l’agression de son mari. Début 2021, « on était aux champs. Des “malaso” ont brûlé les cannes à sucre, le manioc. Dada, mon mari, s’est fait battre. Il n’est pas mort. On a perdu 17 zébus ». Les agresseurs ? L’oncle de Dada et ses fils, qui sont revenus en octobre 2021, cette fois chez le frère de Dada, « sauvagement assassiné », selon le rapport médico-légal. Dix plaies, à la tête par coup de hache et au torse par balle et coup de javelot. « On ne peut plus rentrer chez nous, se lamente Fahasoava. L’oncle a dit qu’il nous tue s’il nous voit. On n’a plus d’argent, de terre, de ressource, plus rien jusqu’à la chemise. On attend juste le PAM. » Pourquoi tant de haine ? « L’oncle détestait Dada, qui s’enrichissait, explique Fahasoava. Ici, si nous éprouvons une jalousie pour quelqu’un qui possède des zébus, même le fait de le voir nous dérange. Nous allons trouver un moyen pour le tuer. »
Des édiles, des éleveurs, des curés, des habitants me le confirment. À -Madagascar, la jalousie semble exacerbée. Ensuite, les victimes font appel à des malaso pour se venger. Les nouvelles victimes aussi. Le cercle vicieux s’alimente sans fin.
Ce genre d’histoires, où les représentants de l’État oppriment des personnes vulnérables, peuple les brousses.
Face à ces conflits, l’État et les autorités locales – policiers, gendarmes, procureurs, juges, maires ou chefs fokontany (le plus petit échelon administratif) – n’assument pas le rôle de puissance apaisante. Au contraire. Dada, qui a perdu ses bêtes, ses terres et son frère, dort aujourd’hui… en prison. Le commandant de gendarmerie l’a placé en détention. Libéré le 6 décembre 2021, il est replacé sous mandat de dépôt le 7.
Contacté, le parquet de Tôlanaro justifie la détention actuelle : Dada est accusé d’avoir brûlé des maisons et blessé deux personnes. L’institution ignore en revanche la raison de la première incarcération. Et ne semble pas au courant du frère décédé. J’ai pourtant consulté une plainte de Dada, visée du cachet du procureur.
« Ce sont nos maisons qui ont été brûlées », s’étranglent des proches de Dada. Ils dénoncent des collusions entre les autorités publiques et la famille de l’oncle. Ce genre d’histoires, où les représentants de l’État oppriment des personnes vulnérables, peuple les brousses, du nord au sud. Vers Betroka, commune d’Analamary, le maire propose aux hommes et femmes qui meurent de faim de travailler dans ses champs de manioc. Salaire espéré : 40 centimes d’euros par jour. Une misère de misère, même ici.
Le « vent rouge », mauvais génie
Nous repartons vers le sud. La RN13 se fait sable, frôle des familles de lémuriens et traverse des forêts sèches qui s’arrêtent net à une trentaine de kilomètres de l’océan Indien. Dernière étape, Ambovombe, capitale de l’Androy, au milieu d’une vaste plaine agricole. Il y plane un mauvais génie : la tiomena, le « vent rouge », une nuée de poussière. « Le phénomène existe depuis longtemps mais s’est amplifié en 2019 », relate Paubert Tsimanova, au volant de son van. Entrepreneur, journaliste et spécialiste autodidacte du climat local, il nous emmène voir les dégâts des tiomena.
À 8 kilomètres, dans un village, le sol arrive au niveau des toits. Les puissants alizés d’est ramassent d’énormes quantités de poussière et forment des nuages. Les grains redescendent dans des avalanches de poudreuse rouge, étouffent les champs, tuent les plantes rases, s’amoncellent partout.
La tiomena cause directement la famine. Elle provient de la déforestation. Avant, la forêt fixait la terre. Mais la population a tout défriché, pour faire du charbon et cultiver. Seuls subsistent des arbres isolés, aux branches toutes ébouriffées du même côté. « Nos pratiques ont façonné le “kere”, juge Paubert. Il faut reforester, planter des pastèques et des patates douces qui couvrent bien le sol. » L’ONG Gret promeut une technique de culture qui associe des haies d’arbustes pour protéger du vent et distribue des semences habituées à la sécheresse, comme le sorgho ou le mil.
Car la déforestation fait aussi fuir la pluie, comme l’explique Zo Rakotomavo, chercheur de la météorologie malgache : « Dans le Sud, les averses sont de type convectif. La chaleur échauffe la masse d’air au sol, fait monter l’humidité, qui se refroidit dans les couches supérieures, se condense, et forme un nuage. Plus il y a de végétation, plus il y a d’humidité et donc, les chances de précipitations augmentent. »
Paubert nous conduit à l’extrême sud : la mer. Elle regorge de requins, de langoustes, de poissons divers. Mais très peu de personnes pêchent. Sur la plage, Velonafo répare ses filets et entretient ses quatre pirogues et dix filets. Il est vezo, une ethnie de pêcheurs originaire de l’Ouest. « Quand la mer est bonne, je gagne jusqu’à 3 millions d’ariary en quinze jours », révèle-t-il. Quinze fois le salaire minimum mensuel. Comme si un pêcheur français se faisait 20 000 euros en deux semaines. Pour lui, pas de kere.
Dans les tribunes ou à même la terre battue, gendarmes, « malaso », éleveurs, paysans se côtoient, applaudissent, rient ensemble.
La question brûle les lèvres. Pourquoi les autres ne pêchent-ils pas ? « Ils ont peur de la mer », s’exclame Velonafo. « Ceux des terres viennent juste se baigner, rigole Retsikombo, chef d’un village de pêcheurs, juste à côté. Nos ancêtres aussi craignaient l’océan. Quand ils se baignaient, ils devaient ensuite sacrifier des coqs aux esprits. »
Un jour, ces habitants ont rencontré des Vezo et ont appris. Ils ont vaincu l’imaginaire de « la mer qui fait peur ». Et en ont créé un autre. « Quand on pêche, on se transforme en mi-homme mi-oiseau, récite l’ancien. On a l’impression de planer sur l’eau. » Ils ne pleurent jamais de mort de la famine. Ici, la peur comme la jalousie font partie des racines de la disette. Ces deux sentiments « perturbent en profondeur le fonctionnement social et paralysent l’indispensable évolution des mentalités », écrivait le père Sylvain Urfer en 2012. Cet auteur spécialisé sur la société malgache, décédé en décembre 2021, « ne voulait pas changer les valeurs malgaches, il voulait les tourner dans un sens positif », rappelle Nicolas Pesle, qui assure l’intérim à la tête du centre de recherche et d’édition Foi et Justice. Urfer proposait de faire de la jalousie « un désir et une ambition portés par l’effort ».
Contre la famine, un changement sociétal s’imposerait. À Betroka, une association de musique nommée Abra s’est engagée dans cette voie. Parmi ses fondateurs, Mathilde Lainé, anthropologue, détaille : « On est partis du principe qu’il y avait des “murs de la peur” partout, entre État et population, entre ville et brousse, entre plaines et montagnes, à l’intérieur même des clans, des familles. Ces barrières empêchent une communication essentielle au changement positif. »
Depuis 2018, la structure a fédéré des dizaines de groupes de musique, et organise des spectacles interactifs sur les questions de société et de développement, dans les communes de brousse, comme à Tsivory ou Marotsiraka. Dans les tribunes ou à même la terre battue, gendarmes, malaso, éleveurs, paysans se côtoient, applaudissent, rient ensemble. L’idée d’Abra est de « créer un lieu neutre, où on peut rencontrer les autres, y compris ses ennemis, ou ses voisins stigmatisés, souvent mal jugés, et qui inspirent la peur », explique Mathilde.
Abra, Milison et les pêcheurs le prouvent : des solutions locales existent et elles fonctionnent mieux contre des problèmes eux aussi locaux. Mais elles sont éparpillées, manquent de diffusion et de budget. Pourtant, la famine draine des dizaines de millions de dollars d’aides. Mais depuis trente ans que les bailleurs et l’État interviennent, la région a toujours faim et soif. À chaque constat d’urgence, les gouvernements sollicitent l’aide des grands bailleurs – l’ONU, la Banque mondiale ou l’UE – qui promettent de gros budgets. Et communiquent sur des infrastructures onéreuses, comme des routes ou un pipe-line. Mais, dans la plupart des cas, soit les travaux ne commencent jamais, soit ils s’arrêtent, soit la maintenance fait défaut. À Ambovombe, les bornes-fontaines et châteaux d’eau ne fonctionnent jamais. Et en brousse, on croise souvent des forages cassés. Ces absurdités sont le résultat d’une mauvaise gestion locale alliée à une très mauvaise connaissance du terrain de la part des bailleurs.
Exemple avec le nouveau centre nutritionnel, à Ambovombe. Au téléphone, le docteur Vily Magnirisoa, la responsable du centre actuel, éclate de rire : « C’est juste de la communication. Les murs sont finis mais l’intérieur est vide. Quand le président est venu vérifier, ils ont emprunté des meubles à une école primaire. Quand il est reparti dans son hélicoptère, tout s’est arrêté. »