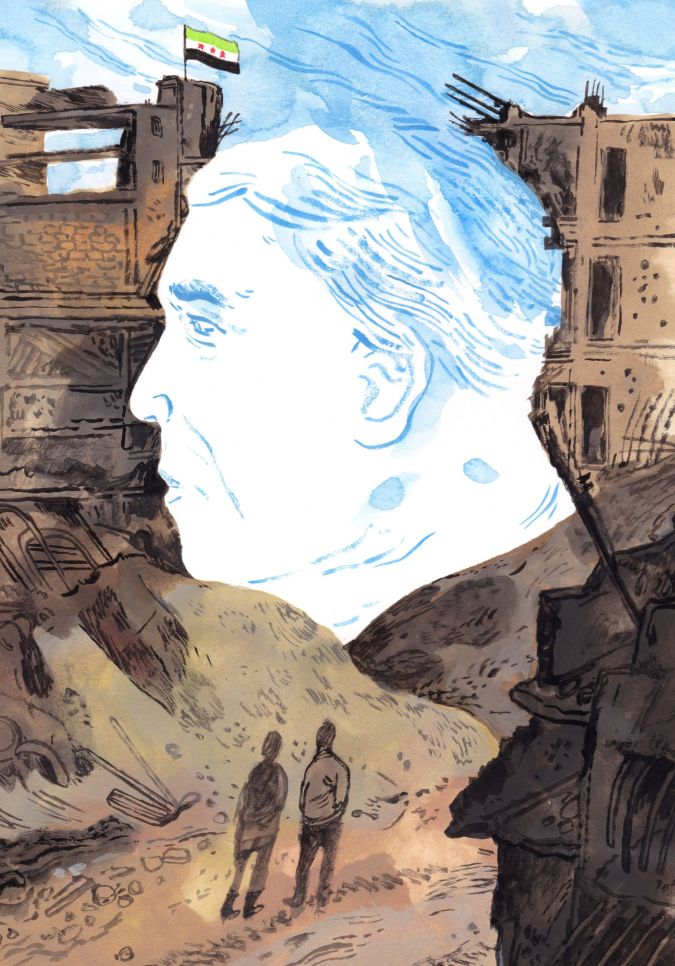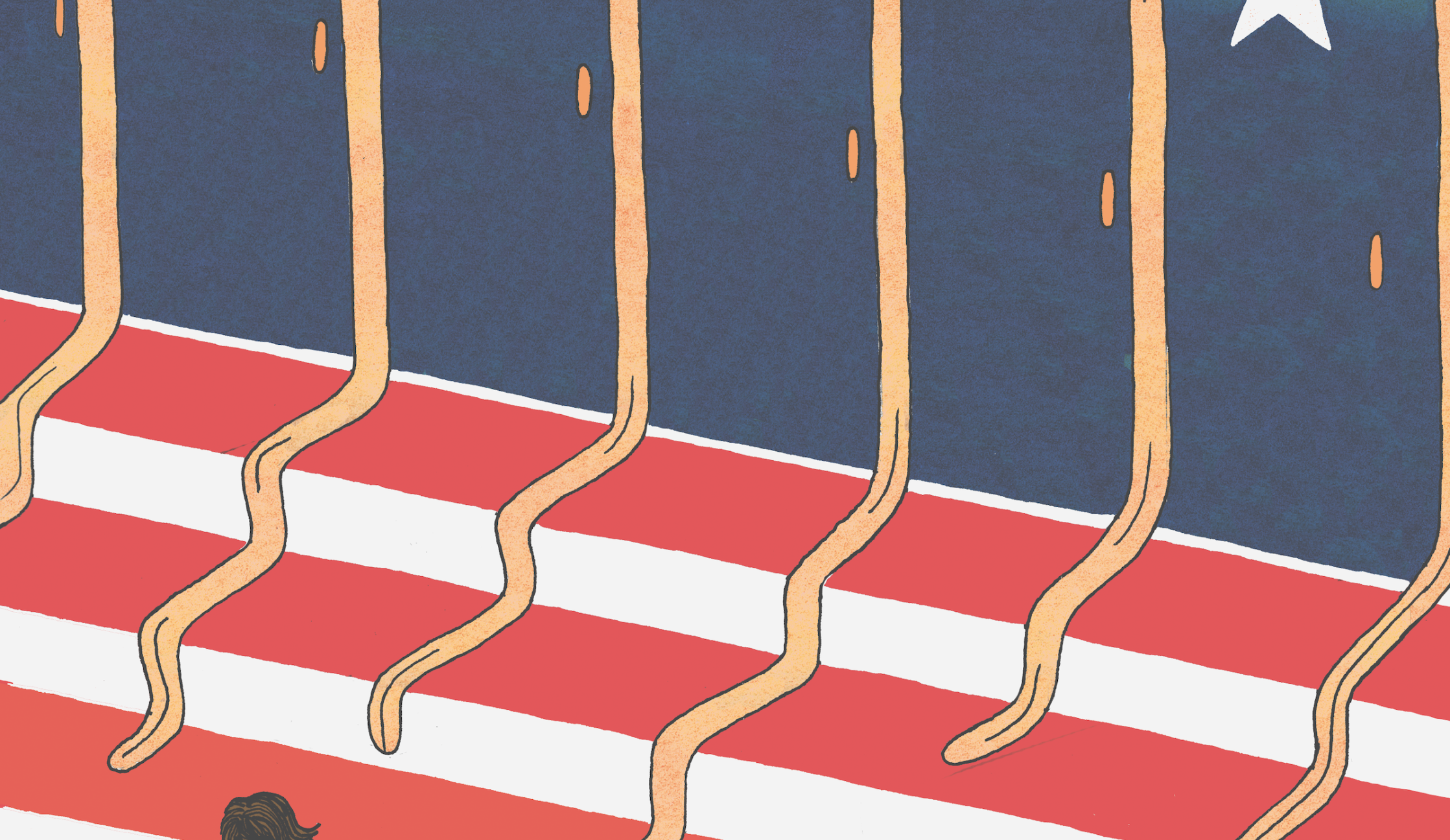Nous lui avions promis des chocolats. C’était l’unique condition de notre entrevue. Didier y tenait, il n’aurait pas accepté notre venue sans le ballotin rouge et blanc que nous trimballons jusqu’à l’hôpital psychiatrique de Saint-Égrève, en croisant les doigts pour que tout ne fonde pas à l’intérieur. Nous traversons sous un ciel couvert les longues allées goudronnées, bordées d’un gazon bien taillé. Passé le sas d’entrée, nos baskets couinent sur le lino gris. À peine le temps de jeter un coup d’œil au hall immaculé. À droite toute, direction la salle des visites.
Des mois que nous entendons parler de Didier et de sa maladie, l’autisme. Un trouble qui touche 700 000 personnes en France, et se caractérise par des problèmes d’interactions sociales, de communication, et des comportements répétitifs. Marie-José Fiorina, sa mère, nous a tout raconté : son internement, sa régression, sa déréliction. Et puis, les mauvais traitements. La violence, les médocs, la négligence.Quand nous poussons la porte, avec nos chocolats fondus, nous savons que nous trouverons un homme abîmé. Une part de nous espère que, au moins, il appréciera les gourmandises.
Et nous y voici, dans cette pièce aseptisée qui sent la grisaille. Rien au mur, aucun mobilier, encore moins de magazines. Face à nous,deux rangées de chaises. Sur l’une d’elles, Didier, prostré. Avec ses cheveux poivre et sel en bataille et son pyjama couleur béton, il se fond dans le décor comme un caméléon. Il a passé la moitié de sa vie, de ses 46 printemps, entre les murs de cet établissement situé à vingt minutes au nord de Grenoble. La baie vitrée inonde la pièce de lumière, mais il n’a plus un regard pour le dehors.
En France aujourd’hui, faute de place dans des institutions adaptées, des autistes sont internés en hôpital psychiatrique. Or, sauf en cas de crise violente, ils n’ont rien à y faire. L’autisme n’est pas une psychose, c’est un trouble envahissant du développement, que la recherche peine encore à cerner. Une maladie qui ne se soigne pas avec des médicaments et une psychothérapie, mais se gère, se contient, se régule, avec de la patience, du lien, de la stimulation et des activités adaptées.
Une chambre de 15 mètres carrés et une serrure limée
Didier n’a pas eu droit à tout ça. À notre arrivée, il croise les bras sur un ventre si gonflé que sa chemise se déboutonne. Sous ses sourcils broussailleux, un regard bleu perçant semble vouloir demander : « Vous avez ce que je veux ? » Nous dégainons les chocolats. Didier les engloutit méthodiquement. Un à un, les emballages tombent par terre. Difficile de lui arracher un mot. Gamin coincé dans un corps d’ogre, il nous raconte juste que samedi, chez sa mère, il mangera des pommes dauphines et du steak haché.
Les chocolats finis, Didier lâche un « au revoir » solennel, aussi mou que sa poignée de main. Les infirmiers viennent le chercher. Il est temps pour lui de regagner sa chambre fermée à double tour. Et pour nous de reprendre la route.
Pierre a été durant deux ans l’un des éducateurs spécialisés de Didier à Saint-Égrève. Comme les autres, il a claqué la porte, désabusé. Il hésite à tout nous raconter. L’homme se rêve lanceur d’alerte, mais quand même, il aimerait bien retrouver du travail. Puis il se lance, sous couvert d’anonymat. Explique qu’il en a eu marre de voir tous les jours « ces autistes qui errent dans les couloirs comme les morts-vivants de la série américaine “Walking Dead” ». Marre d’entendre les cris des patients mis sous contention. Marre de passer devant des malades « attachés en prévention ».
Pierre pensait pouvoir être utile, pourtant. Il ne connaissait rien à l’autisme, il s’est retrouvé un peu par hasard en psychiatrie, mais à force de lire des bouquins, il a compris à qui il avait affaire. Lorsqu’il a rencontré Didier pour la première fois, « il était allongé sur son lit, sans expression. Il m’a dit bonjour, avec une voix qui rappelle celle de Giscard d’Estaing, une sorte d’intonation chuintante. Ce qui m’a frappé, c’est qu’il était très pâle. Ça, c’est l’enfermement ».
En France, faute de place dans des institutions adaptées, des autistes sont internés en hôpital psychiatrique. Or, sauf en cas de crise violente, ils n’ont rien à y faire. L’autisme n’est pas une psychose.
Didier passe le plus clair de son temps cloîtré dans une chambre de moins de 15 mètres carrés. « Son horizon ne dépasse pas les murs ou le plafond. Il n’y a rien d’autre qu’un lit, une caisse pour ranger ses bandes dessinées, et un placard mural avec des survêtements et des CD de variété française des années 1980, surtout Véronique Sanson. Dans la salle de bains, il n’a même pas de pommeau de douche. Le personnel lui parle à travers une petite fenêtre carrée en double vitrage qui étouffe les voix. Comme toutes les serrures des chambres, la sienne est limée de l’intérieur pour qu’il ne puisse ni ouvrir ni s’enfermer. Depuis vingt ans, il reste le plus souvent allongé. Il ne se lève que pour la toilette, pour manger, ou pour de rares activités. »
Le son de la voix de Pierre retombe. Il baisse la tête, si bien que nous avons du mal à distinguer ses traits sous la barbe de trois jours qui lui mange les joues. Malgré l’éclatant soleil de la montagne, l’éducateur garde les rideaux tirés. Depuis qu’il a quitté l’hôpital, il fait des insomnies, frôle la dépression.

Tous les jours, il allait voir Didier, lui parlait, et écoutait les mêmes histoires que l’autiste ressasse inlassablement. « Il répète les trucs comme s’il les avait appris par cœur. » Les mêmes questions, les mêmes réponses. Parfois des blagues. Une fois, il a récité du Prévert. Avec une somme de petits riens, Pierre finit par l’apprivoiser. « D’emblée, on le vouvoie. Il y tient. Lui ne maîtrise pas les pronoms. Comme beaucoup d’autistes, il dit “on”. Et si je lui demande “qui”, il pointe du doigt. »
Attentif, il cherche à le comprendre.
« Il ne sait pas demander. Une fois, il a frappé quelqu’un. Deux jours après il me dit : “Je sais pourquoi j’ai tapé.
— Ah bon, pourquoi ?
— Parce que je ne suis pas allé à l’anniversaire de mon frère. On ne m’a pas proposé.”
Il ne sait pas demander :“J’aimerais bien aller à l’anniversaire de mon frère.” Le jour J arrive et le lendemain, bim ! »
L’éducateur arrive peu à peu à le convaincre de sortir de sa chambre. Il découvre la salle télé, son écran plat encastré dans le mur. Pierre l’emmène se dégourdir les jambes dans les deux petits jardins de l’hôpital, au pied du curieux palmier planté là. Et parvient finalement à le faire rentrer chez ses parents, un samedi par-ci, un samedi par-là, au début. Ils sont ravis, se préparent à leur manière. Marie-José enfile des protège-tibias pour amortir les coups de pieds. Jean-Noël pousse le canapé contre le meuble de la télévision. Ce papa dont la voix douce, parfois inaudible, contraste avec celle de sa femme, préfère en rire : « On ne compte plus combien il nous en a cassé ! »
« Au départ, quand il est parti, j’ai dit ouf »
Dans leur petit jardin, la piscine couverte, la balançoire et le trampoline laissent imaginer les dimanches en famille avec leurs quatre petits-enfants. Autour d’un thé pêche-mangue, les Fiorina se souviennent avec nostalgie que leur fils « aurait rêvé être animateur radio. Il avait déjà rédigé des petits journaux, et même visité France Bleu Isère ».
Le petit Didier sait jouer du piano et connaît tous les tubes français, de Johnny à Téléphone. Il chante à tue-tête ceux de son artiste préférée, Véronique Sanson. À l’inverse de ce que chantait la blonde star du hit-parade, Didier serait plutôt « fou dehors, doux dedans ». « Son grand regret, c’est de ne pas avoir pu aller la voir lorsqu’elle était en concert à Grenoble. » Marie-José laisse s’envoler un rire sonore qui envahit le salon. Elle précise qu’en consolation « il a assisté à celui de Jean-Jacques Goldman ». Un ado normal, qui n’hésite pas à partir en vadrouille quand il en a envie. « Il prenait le bus, il allait chez ses grands-parents tout seul. Il faisait sa vie. » Ils y ont cru.
Mais petit à petit, la violence fait irruption dans la vie de cette famille ordinaire. Didier frappe. Il multiplie les allers-retours dans différentes structures, se retrouve dans une famille d’accueil « qui élevait des chèvres dans la Creuse » et « l’emmenait se baigner tout nu dans une rivière », raconte la retraitée. Rien n’y fait. Retiré d’ici, pas adapté là-bas, viré ailleurs, tout capote. La famille Fiorina ne trouve aucune solution. Didier fait partie de la « génération perdue » des enfants autistes nés dans les années 1970 : ce sera l’internement et les médicaments.
Didier frappe. Il multiplie les allers-retours dans différentes structures. Rien n’y fait. Retiré d’ici, pas adapté là-bas, viré ailleurs, tout capote.
Sa mère se racle la gorge :« J’étais devant la maison, et j’entends sa petite sœur de 4 ans hurler à l’intérieur. Didier avait jeté la télé, elle était tombée sur la gamine. Mais il ne l’avait pas visée ! Elle ne voulait pas mettre la chaîne qu’il voulait, certainement. Là, je me suis dit que ce n’était plus possible. »Son corps, engoncé dans un excentrique gilet sans manche en fourrure synthétique, est secoué d’un sanglot. Marie-José se tapote les yeux avec un mouchoir, passe sa main dans ses cheveux blonds méchés, et reprend : « Il a été interné. Au départ, quand il est parti, j’ai dit ouf. Mais en réalité, ç’a été la descente aux enfers. »
Nous sommes en 1994. Didier a 22 ans et rejoint l’hôpital psychiatrique à jamais. Isolé, enfermé, il tape de plus en plus. Marie-José apprend qu’un jour « les médecins ont pris rendez-vous à Lyon, dans un hôpital, pour le lobotomiser ». La pratique est interdite en France, selon l’ordre des médecins. Grande gueule, sa mère fait des pieds et des mains. Un docteur évite de justesse à l’ogre-enfant le triste sort du héros de Vol au-dessus d’un nid de coucou.
Piqué comme du bétail
Les médecins de l’hôpital l’envoient régulièrement dans des unités pour malades difficiles (UMD), un service psychiatrique destiné, selon la loi, aux personnes qui « présentent un danger pour autrui », des schizophrènes en majorité, ayant parfois commis des homicides. Sur les dix UMD de France, Didier en connaît trois. À Cadillac, près de Bordeaux, à 700 kilomètres de chez lui, « il a failli mourir à cause d’une fausse-route avec une banane ». Coma profond. Il s’en sortira quelques jours plus tard.
En cause, une dose massive de médicaments, qui peut provoquer des troubles de la déglutition. L’administration de psychotropes, utilisés pour leur effet tranquillisant et antidélirant, est controversée. Pourtant Didier en est gavé. « Il n’arrivait plus à marcher, ni à parler. Il bavait. Une autre fois, ses yeux roulaient dans ses orbites. J’ai dû appeler un médecin, qui l’a piqué comme si c’était du bétail. »
Dans une autre UMD, à Sarreguemines, Didier retombe dans le coma. « Ses reins étaient bloqués à cause des neuroleptiques. Et le pire, c’est que malgré le coma, ils l’avaient attaché. Attaché ! s’étrangle sa mère. Deux infirmiers montaient la garde devant sa chambre. Il est resté hospitalisé presque deux mois. »
À Saint-Égrève, les patients sont considérés comme responsables de leurs actes. Qu’ils frappent, s’automutilent, se cognent la tête contre le mur, crient, tout sera de leur faute.
Pierre, éducateur
Sophie Janois, avocate spécialisée dans le droit de l’autisme, a défendu plus de mille familles d’autistes depuis sept ans.Dans son bureau, des piles de dossiers ; en elle, la même colère, intacte.« Les autistes réagissent très mal aux psychotropes. Normal, ce n’est pas une maladie psychiatrique ! J’ai même eu un cas où il était écrit “cause de la mort inconnue” sur l’avis de décès. Cet avait fait un coma pour surmédication très peu de temps avant. Je n’ai pas attaqué l’hôpital, car j’étais persuadée qu’on allait perdre. On n’avait aucune preuve. » Elle ajoute : « Au lieu de stimuler la personne, on l’endort. C’est une manière d’avoir la paix dans les hôpitaux. Ils manquent de moyens, de personnel, et ne savent pas donner la réponse thérapeutique adéquate. »
À Saint-Égrève, « les moyens » arrivent d’un coup, en 2016. L’hôpital ouvre un pôle consacré aux autistes. Un bâtiment bariolé, qui semble avoir été posé là par un architecte sous acide, avec sa façade ultramoderne aux bandes vert pomme. Marie-José se souvient très bien du « grand discours » de Pascal Mariotti, alors directeur de l’hôpital, qui avait lancé le projet quelques années plus tôt. Didier est un des premiers occupants. Mais dans sa chambre, la seule ouverture au monde reste une lucarne qui donne sur un rêve d’herbe fraîche. C’est là que Pierre a débarqué.
L’éducateur se souvient : « Quand un changement de pyjama est refusé à Didier, les soignants viennent à plusieurs pour l’entraver. Quand ils lui refusent un changement de chaussettes, ils l’entravent. Quand il frappe trop souvent à la porte pour solliciter du personnel, ils l’entravent… » Pieds et poings liés par quatre bandes en nylon noires-rouges-bleues, fermées par des cadenas de métal froid, sur le dos. Parfois il hurle, parfois il attend que ça passe. Les patients les plus agités sont ceinturés par des bandes en cuir ou une attache ventrale avec un système de fermeture magnétique.
Selon le Code de la santé publique, « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, prise pour une durée limitée ». Mais Pierre explique : « À Saint-Égrève, les patients sont considérés comme responsables de leurs actes. Qu’ils frappent, qu’ils jouent avec leurs selles, qu’ils s’automutilent, qu’ils se cognent la tête contre le mur, qu’ils crient… tout sera de leur faute. »
« Une zone de non-droit absolu »
Il continue : « On a beau expliquer que, pour qu’un patient ne tape pas, il faut des activités, rien n’y fait. Les infirmiers sédatent, attachent, et puis voilà. Les recommandations de la Haute Autorité de santé, les droits des personnes, ils s’en foutent. » À l’hôpital, nous rencontrons une cadre de santé du pôle autisme. Le torse bombé et le verbe haut, elle défend pied à pied ses collègues, insiste sur les difficultés de leur travail, et tient à rappeler que « la contention et l’isolement sont des procédés thérapeutiques ! Nous les faisons dans les règles de l’art ».
La Cour des comptes relève que les autistes « représentent une part importante des hospitalisations dites inadéquates », c’est-à-dire des séjours particulièrement longs.

Pour l’avocate Sophie Janois, les patients comme Didier n’ont rien à faire en hôpital psychiatrique. « C’est pire que la prison. Sachez que, quand je faisais des visites en détention, les plus filous prétextaient une dépression pour aller à l’hôpital. Ils pensaient que ce serait moins dur. Eh bien, ils revenaient dans la semaine ! lâche-t-elle, avant de renchérir : L’hôpital psychiatrique est une zone de non-droit absolu. »
Et ce n’est pas Juliette qui dirait le contraire. Comme Pierre, elle a travaillé au pôle autisme de Saint-Égrève, avant de le quitter en 2017. « Je suis un peu stressée, j’ai hésité à vous répondre. » Elle a la gorge serrée, veut rester anonyme elle aussi. « Mais j’ai des choses à vous dire. » La trentenaire nous reçoit dans son nouveau bureau, caverne d’Ali Baba saturée de jouets et de feutres en vrac. Son témoignage se confond avec celui de Pierre. Isolement et contention font partie du quotidien de l’hôpital : « Il y a des patients qui ont passé plusieurs mois enfermés dans une chambre. »
« Des patients ont passé plusieurs mois enfermés dans une chambre. » Quand on lui demande pourquoi elle n’a fait aucun signalement, Juliette rit jaune. En milieu fermé, c’est « parole contre parole ».
Quand on lui demande pourquoi elle n’a fait aucun signalement, Juliette rit jaune. L’omerta règne. Comme Pierre, elle pense que toute opposition du personnel serait vouée à l’échec. En milieu fermé, c’est « parole contre parole », tranche Juliette. « Vous voulez quoi ? Faire témoigner Didier Fiorina, qui parle de dragons et de n’importe quoi toute la journée ? »
Dans le salon des Fiorina, justement, Marie-José et Jean-Noël nous tendent une des lettres que leur fils écrit chaque jour. Avec ses grandes boucles enfantines, tracées au stylo à bille bleu, il décrit un quotidien où la violence n’est jamais loin. Un monde où les phrases « Je voudrais des peluches pour mon anniversaire » et « J’ai tapé des infirmiers car j’avais des malaises » se suivent en toute logique.
Sur le portable du papa, une photo floue prise dans la salle d’isolement. Moins de 3 mètres carrés aux tons blancs, sans lumière extérieure, garnis d’une banquette, d’un plafonnier trop bas pour les patients les plus grands et d’une fenêtre de surveillance rectangulaire qui donne sur le couloir. Sur la photo, Didier est absent, l’œil vide, cramponné à son père. Elle date de 2009, mais aurait pu avoir été prise hier.
En sortant de ce rendez-vous, nous sommes secoués. Une fois retournés dans la voiture, nous ne pouvons démarrer avant un temps. Comment imaginer cette vie d’internement ? Marie-José espère que son fils quittera un jour l’hôpital psychiatrique pour une structure adaptée. Mais cette maman à la voix rauque, comme usée d’avoir si souvent protesté, a cessé de croire qu’un jour Didier franchira le seuil de la maison avec ses valises. « Je ne peux plus le prendre ici », répète-t-elle, impuissante. Les colères de l’aîné hantent encore les murs de la bâtisse familiale.
Dans ses textos, toujours les mêmes questions : « J’en suis malade de voir Didier comme ça. Quand cessera cette monstruosité ? Quand pourra-t-il enfin bénéficier d’une vraie prise en charge adaptée pour son autisme, avec respect et bienveillance ? »
Le rapport qui accuse
L’hôpital de Saint-Égrève est mis en cause dans un rapport encore confidentiel écrit par Ghislaine Lubart, directrice de l’association Envol Isère Autisme. Ghislaine, c’est un peu votre grand-mère : des rides malicieuses au coin des yeux et une coupe châtain à la Mireille Mathieu qui coiffe des lunettes à grosse monture. La première fois que nous la rencontrons, en décembre dernier, au congrès annuel d’Autisme France, l’association la plus active de l’Hexagone, ses joues sont rouges comme les mailles de son pull. Prenant son courage à deux mains, la sexagénaire attrape le micro et raconte l’histoire d’un jeune homme, enfermé dans sa chambre en hôpital psychiatrique, qui s’est mis à boire son urine, faute d’eau et d’accès à la salle de bains.
Nous sommes choqués. La salle, elle, reste indifférente. Comme si c’était normal, habituel. Au moment où les rangs se vident, nous en profitons pour alpaguer Ghislaine. Il y a quelques années déjà,cette « militante de l’autisme » s’était fait embarquer par les flics après un sit-in devant un cinéma grenoblois accusé de diffuser un film qui lui semblait discriminatoire. Pour son fils, autiste, pas question de Saint-Égrève. Mais le petit bout de femme veut faire tomber l’institution.
Dans son rapport, elle a recueilli la parole de Pierre, Juliette, Marie-José et les autres et a placé ces témoignages entre les mains d’Adeline Hazan, la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Celle-ci a épinglé en mars 2016 le centre psychothérapeutique de l’Ain, à Bourg-en-Bresse pour son « traitement inhumain » des patients. Deux ans plus tard, c’est au tour du CHU de Saint-Étienne d’être pointé du doigt par cette autorité pour « les violations les plus graves aux droits fondamentaux ».
Du nord au sud de la France, des voix s’élèvent. À Cadillac, il y a Nicole, ancienne cadre de santé, qui nous parle d’un jeune autiste enfermé et attaché des jours durant parce qu’il démontait les prises de courant la nuit. À Amiens, il y a Hazies, ex-éducateur, qui nous raconte l’histoire de Freddy, resté « deux ans en chambre d’isolement ».
Des infirmiers prennent des photos de chambres tartinées de selles. Pendant des activités “dessin”, ils peignent le visage des autistes, histoire de s’amuser.
Pierre, éducateur
Le secrétariat d’Adeline Hazan affirme que l’hôpital de Saint-Égrève sera visité, sans vouloir en dire plus. Nous demandons : « Des patients enfermés pendant plusieurs semaines, ça arrive souvent ?
— Ça semble totalement déraisonnable. Jamais vu un truc pareil. L’unité de mesure d’un isolement, c’est vingt-quatre heures. »
Mais Pierre se souvient : « On refusait souvent à une autiste, déficiente intellectuelle, de sortir de sa chambre alors qu’elle le demandait. Ça la mettait hors d’elle. Elle se mettait à crier, allant jusqu’à se cogner la tête contre la vitre. La décision était systématiquement de l’entraver. Pendant plusieurs heures, elle restait attachée, souillée de selles. »
Il continue : « Certains infirmiers prennent des photos de chambres tartinées de selles. Pendant des activités “dessin”, ils peignent le visage des autistes, histoire de s’amuser. Ou ils font une mèche d’Hitler au gel à un patient… »
Pascal Mariotti, directeur de l’hôpital de 2009 à décembre 2017, admet qu’il y a eu des dysfonctionnements. Celui qui dirige depuis son départ de Saint-Égrève le centre hospitalier du Vinatier, près de Lyon, ne nie pas les contentions et l’isolement, notamment concernant « les patients les plus déficitaires » pour lesquels « il y a un problème d’application des référentiels de bonne pratique ».
L’ancien directeur est cinglant : « Il faudrait qu’on arrête de faire miroiter à des parents d’autistes âgés qu’on va régler les choses comme par miracle ! » Ilpréfère répéter qu’il a dû « colmater les brèches » d’une « situation de crise ». Sans jamais y parvenir. « Le pôle autisme était voué à l’échec. »
« Et tous les gens qui en font les frais, qu’est-ce qu’on fait pour eux ?
— Ça peut vous choquer, mais je n’ai pas plus la réponse que vous. La psychiatrie a encore d’immenses progrès à faire concernant ces patients très particuliers. »
Véronique Bourrachot, la nouvelle directrice, a été informée des « dysfonctionnements » et de l’inquiétude de familles comme les Fiorina. Elle assure vouloir « mettre le problème sur la table ». « Je ne dis pas qu’il y aura zéro isolement, zéro contention. Ils sont parfois incontournables dans une période de crise, mais toujours sur décision médicale et en respectant les recommandations de bonne pratique et de surveillance. » De sa voix douce, presque chevrotante, elle insiste : « Chaque semaine, nous analyserons chacune des situations pour être sûrs qu’il n’y ait pas de dérapages. »
« La psychiatrie n’a pas vocation à être un lieu d’hébergement pour les patients. » Le but, c’est qu’ils puissent rentrer chez eux ou intégrer d’autres structures. Une ambition qui vire à l’utopie pour quelques patients. « Certains sont restés très longtemps hospitalisés en psychiatrie. Mais on peut quand même mettre en place des choses pour eux. Je me refuse à dire que c’est sans espoir. » Dans sa résolution de refonder le pôle autisme, elle a fait appel à l’association de Ghislaine Lubart. La sexagénaire a du mal à cacher sa joie. « Je pense qu’on va y arriver », dit-elle, avant de corriger : « Avec elle, on va y arriver. »
« Il y a des gens qui me tapent »
Nous échangeons quasiment tous les jours avec Ghislaine. Textos, coups de fil, elle nous tient au courant de chaque étape, espérant qu’enfin explose la culture du secret à Saint-Égrève. Elle nous présente Véronique, une maman qui a rejoint son association depuis peu. Son fils Valentin est sorti de cet hôpital au début de l’année. Si Véronique accepte finalement de nous rencontrer, elle tient à rester anonyme.
Dans sa grande maison près de Grenoble, la table du salon est balayée par les premiers rayons de soleil de l’année. Véronique pince ses lèvres maquillées d’un rose accordé à son gilet. Elle fouille dans son téléphone et nous le tend du bout des doigts. Impossible de réfréner un haut-le-cœur. Sur la photo, Valentin est salement amoché. Comme 20 % à 25 % des autistes, il est aussi épileptique, et les neuroleptiques à fortes doses ont aggravé ses crises. Ce jour-là, il est tombé : « Fracture du nez et traumatisme facial. »
Sur l’image, son œil gauche, tuméfié, tire sur le violet. Du sang séché colle sur sa paupière, son sourcil et sa moustache mal rasée. Sa bouche, dont la lèvre supérieure est gonflée, s’entrouvre. Elle donne un air hagard au jeune homme échevelé. Au milieu de son visage bouffi, une bosse marronnasse déforme son nez.
Depuis, Véronique a récupéré son fils. Elle a travaillé dans le milieu pharmaceutique et essaie de diminuer progressivement le traitement de Valentin, avec l’appui du médecin de l’hôpital. Les boîtes s’alignent sur la nappe brodée. Minutieusement, Véronique sépare deux tas : un pour les neuroleptiques, un pour les antiépileptiques. Depuis sa sortie de l’hôpital, Valentin est passé de neuf médicaments à quatre. Elle pointe un anticonvulsivant : « Vous en prenez dix gouttes, vous dormez vingt-quatre heures d’affilée. Valentin en recevait soixante par jour. »
Après vingt ans de maltraitances, poussée à bout, Marie-José finit par pousser la porte d’un commissariat. Elle dépose plainte en avril 2017 pour « violence sur une personne vulnérable ».
Soudain, la porte d’entrée s’ouvre. Effectivement, quand Valentin déboule, « il n’y en a que pour lui ». Son mètre 95 et ses 90 kilos n’y sont pas pour rien. En nous voyant, il tonitrue d’une voix aiguë : « C’est qui ces gens-là ? » Derrière ses grosses lunettes, Valentin fixe sa mère qui lui explique notre présence. Il passe sa main dans ses cheveux châtains coupés à la militaire, puis fonce dans la cuisine. « J’ai soif ! » Voyant qu’il se jette sur la bouteille de soda, Véronique se lève pour l’aider à se servir. « Doucement, pas un si grand verre ! », le sermonne-t-elle en riant. Il se marre à son tour. On en oublierait presque la discussion qui vient de s’achever, si elle ne revenait inlassablement sur le tapis. « Ça, ça ne me va pas du tout. Ce sont les prémices du diabète », s’inquiète Véronique en tapotant l’abdomen de son fils, gonflé comme celui de l’ogre Didier.
Valentin s’installe à table et balade ses grands yeux bleus sur nous. Ceux de Véronique ne le quittent plus, s’accrochant à chacune de ses taches de rousseur. Pendant que nous discutons, son fils lui tient fermement la main, comme pour effacer ces mois passés loin d’elle à l’hôpital. Dès qu’on aborde le sujet, il s’agite.
« Qu’est-ce qui t’es arrivé là-bas ?
— J’ai… paf ! [Il crie et mime une explosion avec ses mains.]
— Et les infirmiers, ils ont fait quoi ?
— Chambre d’isolement. À l’hôpital, j’en ai bavé dans mon cœur. »
Parfois, pendant trois semaines d’affilée, Valentin reste enfermé, seul. « Vous, on vous y met une journée, vous devenez dingues », assène Véronique. Impossible de ne pas songer à Didier, dont une des seules occupations est d’écouter de la musique dans sa chambre – une heure chaque soir – via des enceintes encastrées dans un faux plafond.
L’entretien tire en longueur. Le grand gaillard s’impatiente : « Vous avez bientôt fini ? » Sa chaîne argentée, qui brille sur son sweat-shirt noir, bringuebale autour de son cou. Après un silence et sans qu’on lui pose la question, il conclut : « L’hôpital, c’était pas bien. Je ne veux pas y retourner, il y a des gens qui me tapent. Une horreur. »
Les Rambo du service intervention
Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler de coups portés par les soignants. Pierre nous le confirme : « Après un retour en chambre qu’il n’a pas accepté, un patient a tenté de mordre un infirmier. Il a été plaqué au sol par quatre personnes et a reçu trois coups de poing au visage. » Ce témoignage vise le service d’accueil et de garde infirmier, le Sagi. Ce service d’intervention a été créé pour aider le personnel confronté à un patient violent.
L’infirmier est passé en conseil de discipline et a écopé d’une mise à pied d’une quinzaine de jours. La CGT de l’hôpital a pris sa défense. Sur des tracts qu’ils ont distribués, un infirmier arrachait sa chemise, dévoilant un costume de Superman orné des lettres « TSA », du nom du pôle créé pour les patients aux « troubles du spectre autistique ». Un texte de soutien est publié en ligne en décembre 2016. Le syndicat va jusqu’à décerner aux membres du Sagi impliqués dans l’affaire des « médailles du mérite » virtuelles. « Franchement, vous pourriez retourner au travail chaque jour alors que vous savez que vous allez vous faire frapper, mordre ou griffer ? À la CGT, nous pensons qu’on ne le pourrait pas. »
Marie-José, la maman de Didier, s’énerve : « Ils déboulent comme des Rambo, à fond la caisse, ils font leur affaire, et ils repartent en courant. » Son fils lui a parlé de leurs coups, lui aussi. Après vingt ans de maltraitances, poussée à bout, Marie-José finit par pousser la porte d’un commissariat. Elle dépose plainte en avril 2017 pour « violence sur une personne vulnérable ».
« Didier m’a dit qu’il avait été frappé. Apparemment, il avait dû faire une crise. Les infirmiers du Sagi sont venus et ils l’ont tapé. Le problème, c’est qu’ils étaient trois ou quatre dessus. Quand je l’ai vu, Didier avait une marque sur le bras. Une autre fois, il m’a dit qu’un infirmier lui avait tapé la tête par terre. Il avait deux marques. » Pierre lâche : « J’ai déjà vu des marques sur son visage et ceux d’autres patients. » « Des patients rapportaient qu’ils se faisaient taper », affirme aussi Juliette.
Un texto de Marie-José : « Didier doit-il perdre la vie pour dénoncer cette maltraitance dans les hôpitaux psychiatriques où on engueule, on punit, on assomme de neuroleptiques, on attache, on isole les autistes ? »Suite à sa plainte, un gendarme est venu auditionner Didier qui n’a pas su répondre. Comprenait-il la raison de ses questions ?