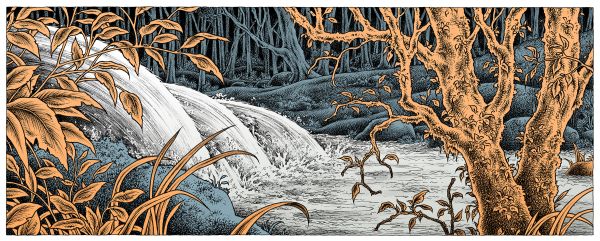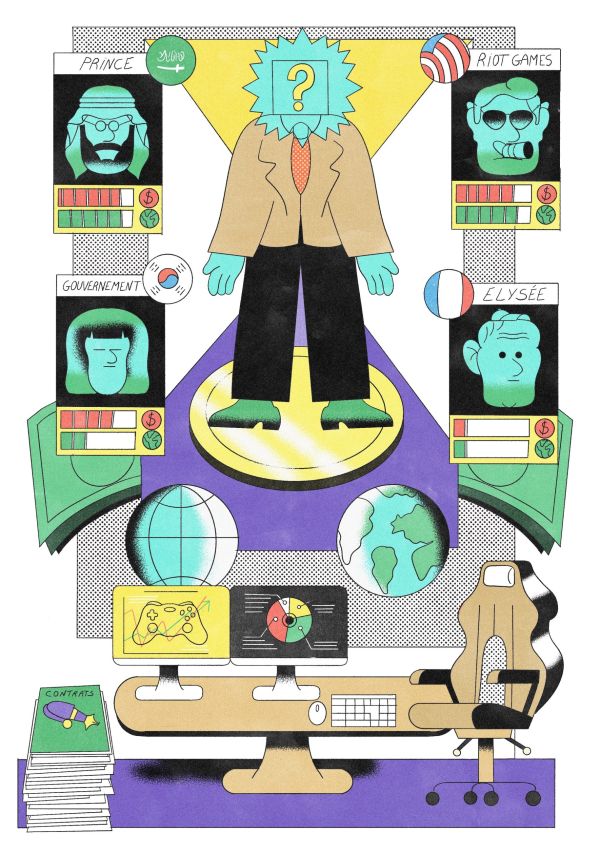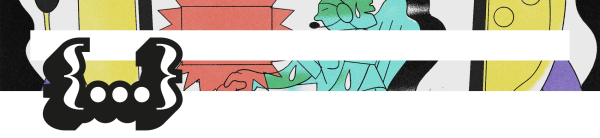Ce midi, c’est moules-frites. Il reste une place à la table d’Étienne, un grand brun qui se tient droit, cheveux coiffés bien plat sur les oreilles. Souvent, Étienne répète deux fois ce qu’il dit. « Je vais très bien. Je vais très très bien. Je vous souhaite un excellent appétit, un excellent appétit. » Courbés sur leur assiette, mes voisins de table mangent en silence. À ma gauche, Tony, un beau jeune homme au visage sombre, mutique. « Bonjour, ça va ? » Regard noir. Perrette, ébouriffée, murmure à toute vitesse des phrases incompréhensibles, pleines de « oh », de « ah », de petits rires.
Son voisin me regarde :
« Je vous rassure, je l’ai pas étranglé.
— Ah bon, pourquoi vous me dites ça ?
— Parce que vous me l’avez demandé.
— Non. »
Il réfléchit.
« Je vais vous expliquer. Un jour, un membre de ma famille – un idiot ! – m’a donné un médicament de forme rectangulaire. Depuis, j’entends des voix.
— Si je comprends bien, vous m’avez entendue dire une chose que je n’ai pas dite ?
— C’est ça. »
Il plonge dans son assiette. Moi aussi. Le saladier se remplit de coquilles de moules. Tic, tic, tic. Étienne : « Vous portez un bijou touareg. Votre collier, c’est un collier touareg. Dans le désert, il y a des Peuls, des Touareg, des Arabes. Ils vivent ensemble.
— Vous, Étienne, vous êtes ici depuis quand ? »
Il lève un index : « Je suis arrivé à La Chesnaie en 1981. Mon premier repas était un poulet-frites. » Il se lève. « Je vous souhaite un excellent appétit, un excellent appétit. » Un homme s’approche : « Mon père est allé au Japon en hélicoptère, il est ingénieur, mais il n’a pas pu prendre de photos. Ma mère est bipolaire, elle est insupportable. » Je suis de retour à La Chesnaie.
On rit beaucoup à La Chesnaie. Quand je flippe toute seule le soir dans mon lit, je me dis : c’est pas grave, demain, y a les autres.
Zoé
Le tilleul devant la maison est devenu gigantesque. Dans la cour du château, le séquoia qui servait d’arbre de Noël a disparu, abattu d’un coup de foudre. Les psychotiques, eux, sont restés comme dans mon souvenir. Raides, lents, distants, comme il y a quarante ans. Mon père a travaillé entre 1968 et 1987 dans cette clinique psychiatrique de Chailles, près de Blois. J’ai passé mon enfance au milieu des fous, avec mes parents et mes petites sœurs. J’ai habité jusqu’à l’âge de 12 ans dans la petite maison près des serres. Pour nous joindre, on appelait le standard de la clinique. Un patient décrochait et vous passait le 37. Il s’y pratique une psychiatrie différente. Pas de mur d’enceinte. Pas de blouses blanches. Parfois je prenais un soignant pour un patient. Depuis les chambres de malades en face de chez nous, on entendait souvent des cris. Ça faisait partie du lieu. Comme le hou-hououou de la tourterelle turque, le bruit des avions de chasse de la base de Tours, les cèdres du parc, l’odeur de cigarette froide qui imprégnait tout, jusqu’aux habits de mon père. L’odeur de cigarette a disparu. Pas les avions de chasse, pas les cris.
Mon père, Foad, est arrivé à La Chesnaie en stop, un jour de l’été 1968. Médecin iranien de 27 ans, il venait de l’hôpital de Montbéliard. Son prof de psychiatrie lui avait conseillé La Chesnaie et la psychanalyse. Les deux allaient ensemble. Il a d’abord été ébloui par le château. Ensuite, « fasciné » par la polyvalence des soignants non médecins, qu’on appelle ici les moniteurs. Ils s’occupaient du château comme des malades, et les éducateurs, les psychologues, les infirmiers devenaient tour à tour lingère, barman, cuistot, plongeur, faisaient le ménage, tenaient la buanderie, la salle à manger ou la pharmacie. Cette polyvalence « signifiait que le destin des individus n’était pas scellé pour la vie, raconte mon père, qui exerce désormais en ville. Quand l’infirmier fait le cuisinier, il ne te parle plus de la même façon, et tu ne t’adresses plus à lui pareil. Si les soignants ne sont pas éternellement à la même place, alors les malades aussi peuvent se réinventer. »
Un article vous donne envie de partager un témoignage, une précision ou une information sur le sujet ? Vous voulez nous soumettre une histoire ? Écrivez-nous.
Il y a eu jusqu’à une dizaine d’enfants de soignants en même temps à La Chesnaie, sans compter les enfants de passage, nos copains et nos cousins. Les allées, l’immense pelouse et ses cèdres, et surtout la forêt, désordonnée et parfumée, n’avaient l’air d’exister que pour abriter nos cabanes. En juin, une grande fête s’emparait de la cour et du parc. Des artistes de rue, des gens sur échasses, un fakir, des merguez, de quoi se faire maquiller pour un franc. Des concerts sur la pelouse, Jacques Higelin, Graeme Allwright. Et toute l’année, du jazz, Michel Portal, Stéphane Grappelli. Les gens du dehors venaient croiser nos fous. À l’école de Chailles, quelques garçons nous avaient traitées de « folles de La Chesnaie ». Ça n’avait pas eu d’effet, on était ravies d’en être. C’était un monde en plus.
« Si elle t’emmène, je viens avec toi »
En arrivant par la route, c’est la première chose qu’on remarque. Comme sorti d’un rêve, un bâtiment biscornu, de bois et de récup, un dôme jaune à la manière des clochers bulbes d’Europe de l’Est, des colonnes en jantes de roues de voiture, une tête d’éléphant grandeur nature, trompe levée. Le Boissier a d’abord été une grange. Il a brûlé un soir, sous nos yeux. Puis il a été reconstruit au début des années 1970 par des patients, des soignants, des étudiants en architecture et leur professeur de 30 ans, Chilpéric de Boiscuillé, que tout le monde appelait Chil. Aujourd’hui, le dôme fuit, la peinture s’écaille par endroits, mais la bâtisse tient debout. Il y a un bar, une scène. Des fenêtres en portes de 2CV. Pour les ouvrir, on les claque vers le haut, d’un coup sec de l’avant-bras. Les plaques de cuivre de la façade viennent des rebuts d’une imprimerie. Sur l’envers du métal, des pages des magazines Nous deux et Intimité. On vient s’asseoir, jouer au ping-pong, boire des cafés. Le public vient pour les concerts. Nous, les mômes, on ne payait pas. On s’installait dans les escaliers, on passait notre tête à travers les balustres. L’odeur du tabac piquait. On partait dessiner dans un coin, on revenait.
J’aimais bien Marie-Jeanne. Je la trouvais rigolote. Elle était revenue enceinte d’une fugue. Elle ne se souvenait de rien. Elle tapait sur son ventre avec ses bras maigres : « Je suis pas la Vierge Marie, docteur ! C’est de l’air ! » Dans sa robe d’été orange, la ceinture au-dessus de son ventre, elle dansait les yeux fermés, bras en l’air, à la fête de juin. Un jour le ventre s’est aplati. J’ai demandé comment s’appelait l’enfant, où il était. « Adopté », avait dit mon père. C’était soudain devenu triste. Ania, elle, se baladait en gueulant. Je la revois de dos, immense, marchant vers la cuisine sous le séquoia, son pantalon laisse voir le haut de ses fesses. Elle crie partout qu’elle kidnappera ma petite sœur de 2 ans, Mariam. Elle hurle que c’est sa fille, qu’il faut lui rendre cet enfant. On reste à distance, c’est comme voir passer un fauve. Un jour, ma sœur Shirine, 5 ans, se penche vers Mariam : « T’inquiète pas, si elle t’emmène, je viens avec toi. » Et puis Ania est partie. Je n’ai plus jamais eu peur à La Chesnaie.
Je sais que c’est irréel, mais dans ma tête, c’est mon oncle François qui me parle.
Roland
La fille nue, on n’a jamais su son prénom. Les fesses sales parfois, elle s’asseyait près de nous, sur les tabourets de la cour, sans parler. Je faisais attention à ne pas rire, mon père aurait froncé les sourcils. Elle entrait chez nous, s’asseyait sur le canapé. Ma mère se précipitait pour poser un drap dès qu’elle poussait la porte. Il y avait aussi Lisette. Une pianiste. Elle avait donné des cours à ma sœur Délara. J’ai le souvenir d’une dame timide et bien élevée, avec son sac à anses, très vieille France, très douce. Lisette était juive. Elle avait une vingtaine d’années pendant la guerre et craignait encore peur des nazis. Elle disait « ces messieurs ». Quand elle délirait, elle pensait qu’elle se cachait à La Chesnaie. « Les hitlériens arrivaient, il fallait la prendre dans nos bras »,se souvient mon père. Elle répétait dans la petite chapelle du château, à l’entrée de la forêt. Ou dans sa chambre, sur un piano muet. Elle refusait d’être prise en photo, de peur que « ces messieurs » ne la reconnaissent. Avant la guerre, Lisette avait donné des concerts au Théâtre Sarah-Bernhardt et à la Gaîté lyrique. En 1938, un article du Petit Parisien avait salué cette « remarquable interprète ».

Le « grillon » et le « grillé du soir »
Le château de La Chesnaie est un domaine immense, plein de jolis noms : la Haute Pièce, une ancienne closerie et son verger, l’Orangerie avec vue sur le parc, la Régie, la « Villa Fleurie », à l’époque couverte de bignones rouges. Claude Jeangirard, un jeune neuropsychiatre qui arrivait de la clinique de La Borde, pas très loin, a acheté le château en 1956 au vicomte de Lestrange, un officier de marine retraité, « pas très commode, versatile et coléreux », raconte-t-il dans un livre d’entretien. Claude Jeangirard était attaché à la beauté des lieux. Il piquait des colères quand des voitures se garaient devant le château. Il disait qu’on devait voir le château depuis le parc, et l’horizon depuis le château.
La Chesnaie aujourd’hui, c’est 101 lits et 30 places dans l’hôpital de jour, ouvert en 1994. Jean-Louis Place, le médecin directeur, me propose de commencer par un stage d’une semaine. « En salle à manger, vous croiserez tout le monde. » Je vais servir les plats, ranger la vaisselle, balayer la salle, nettoyer les tables, participer à la plonge avec les moniteurs et surtout, les malades. Les patients qui le souhaitent travaillent, payés quelques euros par jour, au maximum 50 euros par mois. On dit : « J’ai un contrat salle à manger », « un contrat standard », « un contrat comité menu »,pour suggérer des menus aux cuisiniers. Travailler fait partie de la thérapie. « Le travail, c’est un médiateur, explique Colette Suhard, éducatrice spécialisée, monitrice cuisine. Ça permet d’aborder des sujets qu’on ne peut pas évoquer en face à face avec un psychotique. Le “faire” est le tiers nécessaire. Ça dit au patient : “Vous n’êtes pas que malade, vous êtes une personne malade”. » Les moniteurs ont une formation d’infirmier, de psychologue, d’éducateur ou d’aide-soignant. À l’époque, ils pouvaient être aussi potier, plasticienne ou paysan.
Je loge dans une chambre du Train vert, de son vrai nom L’Orient-Express Hôtel. Ces wagons de première classe de l’entre-deux-guerres, posés entre la forêt et le parc, ont été transformés dans les années 1980 en wagon-restaurant et en chambres pour les stagiaires par des patients, des soignants et des étudiants, avec Chil, l’architecte. Ado, je rêvais d’y dormir. Entre les rames, on se croit sur un quai de gare. Le restaurant, ouvert au public, sert aujourd’hui des bo bun, des phat thai, des hamburgers maison, pour moins de 10 euros. Les cuisiniers et les serveurs sont patients et moniteurs. Il faut réserver, c’est pris d’assaut, à la fois par les Chesnéens, soignants ou patients, et par des gens de passage, qui le découvrent les soirs de concert au Boissier. Jack Lang y a mangé quand il était député du Loir-et-Cher. Le wagon-restaurant est surélevé, à la hauteur de la cime des arbres. « Un voyage immobile », résume Zoé, une patiente qui y a travaillé. Comme le Boissier, le bâtiment en récup qui sert de salle de concert, le Train est inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.
On empile les verres un par un sur les étagères. Ting, ting, ting. Charles est lent, éteint.
Premier matin. Voilà Gwenvaël Loarer en salle à manger, en tablier bleu de plongeur. Il est psychologue. Très vite, il m’explique que quand on ne comprend rien il faut regarder la « grille ». Sur cette feuille distribuée chaque jour, partout dans La Chesnaie, on trouve les noms de tous les travailleurs, et la liste des ateliers : poterie, jardin, tennis, improvisation théâtrale, atelier bois, golf, bibliothèque, musique... Celui qui crée la grille s’appelle « le grillon ». Quand on travaille tard, on dit qu’on est « grillé du soir ». Il arrive que le grillon soit mal informé, qu’un atelier annoncé n’ait pas lieu. « La grille, c’est comme la météo », rigole une patiente.
Je mets un tablier de cuisine ; je garde un petit sac en bandoulière pour mon carnet et mon stylo. Marcel, hirsute, gros sourcils noirs, mains en avant comme une mante religieuse, s’approche : « Gwenvaël, je vous demande pardon pour les grossièretés que j’ai dites tout à l’heure. » Il repart. Je range la vaisselle avec un patient. On empile les verres un par un sur les étagères. Ting, ting, ting. Charles est lent, éteint. Je n’entends pas le son de sa voix. Une fille passe en murmurant : « Je sers à rien. » Midi, je sers les plats. Amélie Aladenize, éducatrice spécialisée, me glisse, malicieuse : « On ne se précipite pas pour servir dès que les assiettes sont vides. On n’est pas là pour répondre tout de suite à l’envie de se remplir. »
« Je ne comprenais pas tous les mots au début »
Je cours à L’Oasis, un temps de parole, une demi-heure de discussion, chaque jour, entre ceux comme moi qui viennent du dehors et un moniteur. Aujourd’hui, c’est Réjane Paireau, psychologue à la buanderie, qui nous écoute et nous répond. « Vous avez l’impression de ne rien avoir à faire. Parler aux patients, dans le milieu hospitalier, c’est pas considéré comme du travail. C’est moins facile à évaluer qu’une prise de sang, c’est sûr. Mais c’est essentiel. La maladie attaque en premier le lien à soi, à l’autre. » À La Chesnaie, tout est fait pour retisser le lien : « C’est pénible d’aller chercher du tabac, de demander une autorisation pour aller à Auchan, mais ça oblige à aller vers les autres. Sortir des hallucinations, du délire, c’est ça le truc. Les voix que les malades entendent, elles sont humiliantes, insultantes. Ils doivent coexister avec des symptômes qui jamais ne leur foutront la paix. Dominique, depuis quinze jours, elle est en difficulté. L’autre jour, parce qu’on l’a attendue, elle est venue à la braderie. C’est pas rien de se savoir attendu. Si quelqu’un me dit : “Aujourd’hui, je peux pas faire le bar”, je réponds : “OK, mais vous pouvez prévenir l’équipe ? Vous pouvez trouver un remplaçant ?” »
Ici, tout est ouvert, éclaté, « ça donne l’impression d’un énorme bazar », dit Réjane, mais c’est « hyperorganisé. C’est juste qu’on n’est pas caché derrière un burlingue ou une blouse ».Exemple, le service V, comme vigilance, compte les malades cinq fois par jour. À 8 heures quand on les réveille, à 12 heures pour le repas, à 15 heures au goûter, à 18 heures avant dîner et à 22 heures. Et ceux qu’on ne trouve pas, on les cherche partout. Dans le parc, dans la forêt, au bistrot du village. Les malades installés depuis plus de quinze jours ont le droit d’aller et venir, sauf contre-indication. Étienne, l’homme qui répète tout en double, va tous les jours chercher son goûter à Intermarché.
La chauffe, c’est le taxi, version Chesnaie. Elle permet aux patients de se rendre à leurs rendez-vous ou de faire des sorties. Jusque dans les années 2000, les chauffes étaient conduites par les patients. Il nous arrivait d’aller à l’école ou chez le dentiste en chauffe, une 2CV imprégnée de tabac. Celle que j’emprunte aujourd’hui emmène comme tous les matins Hafida au Winston, le bar de Chailles, à trois kilomètres de là. Elle achète des paquets de tabac, de feuilles et de cigarettes pour les patients de La Chesnaie avec l’argent qu’ils lui ont confié. Il faut compter, ne pas se tromper. « Il y a un fond de caisse, mais c’est pas pour les erreurs. »
Tout le monde sait qui crie, sauf moi : c’est Marcel. « Une fois il se tapait la tête contre les murs. On a appelé le 404, il fallait qu’on l’arrête », dit Lara.
Hafida a les mains qui tremblent un peu. Face à elle, une vingtaine de patients. Total du jour : 411 euros. La première fois que je l’ai vue, elle chantait « Honky Tonk Blues » dans un groupe à la Fête de l’été, dans le parc de La Chesnaie. Elle avait la classe, une belle voix. J’ai pensé, en la voyant au micro, que c’était son métier. Elle a vécu dans la rue, dans des hôtels pour sans-abri, chanté dans le métro, été choriste, a connu une petite carrière solo, est passée chez Foulquier sur France Inter.
Une petite bande de dépressifs, plutôt joyeuse, bavarde, un peu rebelle, me prend sous son aile. « Je ne comprenais pas tous les mots au début,dit Zoé, infirmière à la retraite, hospitalisée en janvier 2019 pour quelques mois. La Haute Pièce, la “pièce haute” ? Le Train vert, le “travers” ? C’est quoi la grille ? Le service V, je croyais que c’était le service “5”, en chiffre romain… » Zoé, c’est un peu la mère du groupe, certains l’appellent « Maman ». On est dehors sur la terrasse de la salle à manger, avec Lara, jeune mécanicienne auto dans l’armée de l’air, Félicien, qui vient d’arriver, ancien élève de prépa en lycée militaire, Thalia, ancienne étudiante en psycho. C’est la canicule de juin. Un hurlement du côté de la régie. Zoé regarde sa montre : « Ah, 20 h 45, c’est un peu tôt. » Tout le monde sait qui crie, sauf moi : c’est Marcel. « Une fois il se tapait la tête contre les murs. On a appelé le 404, il fallait qu’on l’arrête », dit Lara. C’est le numéro d’urgence, utilisable par tous. Si quelqu’un va mal, on décroche. Ça s’appelle la « fonction cosoignante »,encore un truc de La Chesnaie.
Marcel, le type qui hurle, aime le foot, les chansons, Les Brigades du tigre, Les Chiffres et les Lettres. Au Boissier, souvent, le nez collé à la télé, il commente les matchs. Le regard sombre, il se plante devant les femmes : « Toujours aussi belle ? » Lara, la mécanicienne de l’armée de l’air : « Il est pas agressif. C’est un gentil. Des fois, il se fout des claques, il s’engueule, parce qu’il est en colère contre lui-même. » Thalia, l’étudiante en psycho : « Attachant comme un petit garçon. » Un samedi d’août, les joyeux dépressifs lancent un vent de révolte. Ils réclament une plus forte présence des moniteurs. Ça donne naissance aux « forums du samedi », entre soignés et soignants. Matthieu : « On veut créer de l’échange, du lien. Que les moniteurs viennent avec nous ne rien faire. Qu’on n’ait pas l’impression d’être tout en bas de la société entre quatre murs bien ouverts. Comment faire en sorte que ça change ? »

« Est-ce que le café rend féerique ? »
On entre en général à La Chesnaie après un premier séjour ailleurs, souvent à l’hôpital psychiatrique public. Les urgences sont pleines de patients en crise qui débarquent là, livrés à eux-mêmes, faute d’avoir pu trouver un thérapeute en ville. Quelqu’un : « J’ai fait quatre ans en clinique psychiatrique universitaire. Aux urgences ils sont désensibilisés, ils m’ont attaché. » Un autre : « À l’hôpital psychiatrique où j’étais, à côté de Montargis, il fallait sortir accompagné rien que pour aller dans le reste de l’hôpital. Ils ont tous des blouses. Tout est fermé un peu comme une prison. » Lui s’appelle Francisc, il vit à La Chesnaie depuis deux ans. C’est un ergothérapeute qui lui a parlé du lieu. « Il m’a dit : “Je vous y verrais bien, c’est un château”. » Il a fallu se faire recommander par un médecin, faire une « visite avant admission ». « J’ai été accueilli par Florian et Marie-Pierre. On a mangé du poulet et des haricots verts, c’était très bon. » Après la visite, on écrit une sorte de lettre de motivation. Ensuite, c’est La Chesnaie qui vous choisit. Elle évite les patients très violents, mais aussi les alcooliques, les toxicomanes, difficiles à contenir dans une maison sans murs.
C’est le jour de l’assemblée plénière. Dans les années 1970, elle était obligatoire pour tout le monde, médecins comme ouvriers de maintenance. Elle pouvait être présidée par un patient. Désormais, le médecin directeur tient le micro. Elle ne dure qu’une demi-heure. Sujet du jour, le café.
— Vous connaissez la chanson
“Faut pas faire chier mémé” ?
Ma mère aussi, faut pas la faire chier !
— On peut vous faire chier,
vous, Claire ?
— Oh oui, si vous voulez.
Le directeur, Jean-Louis Place : « Le café, c’est un excitant. Si on boit du café en milieu d’après-midi, c’est le meilleur moyen de ne pas dormir. Prendre des médicaments pour dormir et boire du café, ça ne sert à rien. Si certains se sentent flagada à cause du traitement, il faut aller voir le médecin pour le modifier, plutôt que de prendre du café. »
Un patient : « J’ai connu quelqu’un qui s’intoxiquait au café, c’était terrible. »
Un autre : « Est-ce que le café rend féerique ? »
Un moniteur : « À combien s’élève le cours du stick de café sur le marché parallèle de la clinique ? »
Une voix : « 90 centimes ! »
Le moniteur : « Un euro à gauche ! »
Une monitrice : « Trop de café, ça majore l’angoisse. »
Une patiente : « Ça fait des aigreurs d’estomac. »
Zoé : « On pourrait faire des tisanes. »
Le directeur : « Du pisse-mémé, ça s’appelle. C’est pas nocif. »
Zoé : « ça dépend de ce qu’on fait comme décoction… »
Le directeur : « Vous m’inquiétez, là. »
Rigolade générale.
Je pousse la porte du local du Club, une pièce à l’étage du Boissier. Depuis soixante ans qu’elle existe, cette association de patients et de soignants veut « soigner La Chesnaie ». Ici, on part du principe que l’institution est par définition aliénante, et qu’elle rend malade si on n’y prend garde. Il faut donc la réveiller, la soigner, la questionner avec ce type de club « thérapeutique ». Dans les faits, le Club est plutôt devenu une association qui organise des concerts, des voyages, tient le bar de La Chesnaie et possède des appartements thérapeutiques pour les patients soignés à l’hôpital de jour. La secrétaire, une monitrice, m’attend. « Cathy, tu as des archives ici ? Je me souviens de comptes rendus de réunions entre soignants et soignés quand j’étais gamine. Il y avait du débat… » Elle montre un sac en plastique rempli de papiers ronéotypés, déposé par un moniteur à la retraite. « On a reçu ça, tu nous diras ce qu’il y a dedans. » Des journaux internes, écrits par des moniteurs et des patients. Le grain du papier est épais, les agrafes rouillées se détachent.
Dans le numéro de juin 1968, le dessin d’un cocktail Molotov, et la recette qui va avec. « Si vous balancez le tout sur la gueule des moniteurs, ça risque de faire boum. » Dans un exemplaire de 1974, une caricature de mon père, sous le titre « Les grandes gueules de La Chesnaie » et cette légende : « Il était une Foad dans l’Ouest. » Des poèmes. Des comptes rendus de réunions plénières. Les sujets : l’argent, le système pileux, la réalité, le snobisme. Un extrait du 26 août 1974 : « G : Le sujet d’aujourd’hui, les relations sexuelles à La Chesnaie. B : Il n’y en a pas ! D : C’est dramatique ! F : Si c’est interdit, ça n’est pas pour jouer au flic, c’est parce que souvent, les gens s’impliquent dans les relations sexuelles avec ce qu’ils ont de plus névrotique et de plus tordu… Il ne faut pas oublier que pour faire l’amour il faut être deux, et ce qui peut être bénéfique pour l’un ne l’est pas forcément pour l’autre. (A se casse la gueule en essayant sur une table la position du lotus.) G : Je préfère que ce soit bénéfique pour la femme plutôt que pour l’homme. F : Même à l’extérieur, l’amour ne naît pas comme ça, c’est un conflit permanent ! Th : les relations sexuelles, c’est le voyage des corps dans leur étrangeté. Y : Aïe, il faut méditer ! Une minute de silence ! »
« C’était plus militant avant »
Devant le tilleul de mon ancienne maison, je demande à Damien de me raconter ce qui a changé à La Chesnaie depuis les années 1970. Il se balade en parka en pleine canicule et râle quand je lui demande s’il n’a pas trop chaud. Arrivé à La Chesnaie en 1976, il fréquente désormais l’hôpital de jour. « À l’époque, certains patients devenaient moniteurs. J’ai fait ça une année. Je travaillais plus de cinquante heures par semaine. On assurait les chauffes, les trajets en voiture. J’en ai fait, des tartines de chauffe, j’ai même conduit des gens à un concert de Brassens à Paris. C’était plus militant aussi. J’étais membre de la Convergence autogestionnaire. J’avais fait venir des gens à la fête de La Chesnaie pour le boycott des oranges Outspan d’Afrique du Sud, sans rien demander à personne. » Je sursaute. Les oranges Outspan ! Je me souviens soudain du stand près du séquoia et de ses tracts terrifiants, la tête d’un homme pressée comme une orange.
L’insuline a disparu dans les années 1990. La technique consistait à plonger un patient dans le coma puis à l’alimenter en sucre pour le réveiller en douceur. Elle est désormais interdite. Elle améliorait l’état de certains psychotiques, mais présentait des inconvénients : provoquer le coma est une opération risquée, et le recours au sucre pouvait engendrer accoutumance et surpoids. « Je n’ai jamais voulu la pratiquer,explique Jean-Louis Place, l’actuel directeur. Ç’a été une condition pour venir travailler à La Chesnaie. Je suis convaincu du travail qui peut se faire au réveil, après un choc. Mais on peut créer un choc beaucoup moins toxique. »
Fini les électrochocs, aussi. Ces chocs électriques, qui provoquent une crise d’épilepsie artificielle bénéfique chez certains schizophrènes, sont encore pratiqués à l’hôpital, et l’objet de nombreuses critiques, certains patients se plaignant de pertes de mémoire. Ils sont devenus rarissimes pour les patients de La Chesnaie, un ou deux par an. Fini, aussi, la polyvalence absolue. Depuis les années 2000, on ne peut plus faire une piqûre ou distribuer des médicaments si on n’est pas infirmier. La plus ancienne monitrice du château, Sylvie Delagrange, embauchée au début des années 1980, n’est ni infirmière ni pharmacienne, mais elle a été à deux reprises responsable de la pharmacie de La Chesnaie. « Plus jamais je n’y travaillerai. J’ai été forcée d’arrêter. J’avais appris à piquer, à prendre la tension, à faire des prises de sang, des intramusculaires, des intraveineuses. Ça m’a blessée de ne plus être autorisée à le faire. C’est comme si tu étais déqualifiée. Qu’est-ce qu’il reste aux non-infirmiers ? Les ateliers. »
Aujourd’hui, les cinq médecins de La Chesnaie sont actionnaires et touchent des honoraires proportionnels à leur mise. Ça met certains mal à l’aise.
Pendant les années 1970, un moniteur travaillait cinquante-deux heures par semaine. Avec les trente-cinq heures, tout le monde travaille moins. Il y a aussi des tâches supprimées, puisque l’insuline et les électrochocs, mobilisant plusieurs soignants par patient, ont disparu. D’autres tâches, tout aussi chronophages, les ont remplacées : le temps passé à remplir des papiers, l’administration exigeant une « traçabilité » des soins, a explosé. La gouvernance, elle aussi, a changé. Avant, il y avait un unique actionnaire, Claude Jeangirard, le fondateur. Les psychiatres étaient salariés. Aujourd’hui, les cinq médecins de La Chesnaie sont actionnaires et touchent des honoraires proportionnels à leur mise. Ça met certains mal à l’aise. L’une des psychiatres, Margot Kressmann, est sur le départ, elle va travailler dans une association de soins aux sans-abri. Plein de raisons se mélangent. À son embauche il y a quinze ans, émerveillée par La Chesnaie, elle avait accepté d’emprunter 138 000 euros pour devenir actionnaire. Elle s’était promis de partir après avoir tout remboursé. Elle a touché 12 000 euros d’honoraires par mois – 6 000 euros de revenus après impôt –, et reconnaît qu’elle n’a jamais été en phase avec ce système « capitaliste ».
Des patients ont organisé un pot de départ. Elle sort une cigarette. « Je croyais que tu avais arrêté », lui dit un moniteur. « Oui, mais là c’est trop d’émotion. » Après la fête, les patients de Margot traînent, perdus, orphelins. Léonardo : « Pour moi, c’est deux ans et demi de boulot. » Jo : « Ça me fait chier, je lui avais tout dit, vraiment tout. » Léonardo soupire : « Quand elle avait une consultation qui sautait, elle venait servir les boissons au goûter. C’est comme ça, c’est Margot. »
Les « assises » aussi ont disparu. Tous les dix ans, le personnel de La Chesnaie partait deux jours en séminaire s’interroger sur sa pratique. Il confiait les clés aux patients et aux anciens, qui revenaient bénévolement. On ne manquait jamais de monde, il y avait toujours assez de bénévoles, ravis de retrouver les malades et les copains. Les dernières assises ont eu lieu à l’époque de Jeangirard, il y a quinze ans. Jean-Louis Place refuse que la clinique soit « un lieu de vie » : « C’est un lieu de soins »,insiste-t-il.
Pendant que La Chesnaie s’assagissait, la psychiatrie en France évoluait. Moins d’enfermement, moins de violence – certains asiles étaient quasi concentrationnaires. Mais une nouvelle forme de maltraitance émerge : moins de lits, moins de soignants, des établissements suroccupés, des fous à la rue et en prison. Selon une étude du ministère de la Santé et du ministère de la Justice parue en 2006, près de 24 % des détenus présentent un trouble psychotique. Pour ceux qui restent à l’hôpital, les soignants se plaignent de ne plus être assez nombreux pour faire leur travail. En 2018, des infirmiers ont mené une grève de la faim de dix-huit jours à l’hôpital psychiatrique du Rouvray, à Rouen, pour obtenir des embauches. Ils étaient à nouveau en lutte à l’automne 2019.
« Je m’appelle Sabéran. » Elle se retourne. Voix douce, traînante, familière. « Oooooh, le docteur Sabéran, qu’est-ce qu’il devient ? Je l’aimais bien ! »
Angélique est de mauvais poil à chaque fois que je la croise. « Nan mais j’ai pas l’temps, là. » Même avec quarante ans de plus, ce visage m’est familier. Je reconnais cet air boudeur, ces épaules rentrées, cette voix. Je n’ose pas l’aborder. Angélique est entrée à La Chesnaie comme patiente en 1976, comme Damien. Puis elle est devenue monitrice, puis à nouveau patiente. Enfant, je parlais avec elle, assise dans l’herbe. Disons plutôt que j’écoutais et Angélique parlait. C’est elle qui m’a appris à goûter la partie sucrée des herbes. On tire doucement sur une graminée, et on grignote le bout tendre. Je pense à elle à chaque fois que je fais ça. Je la croise alors que je marche vers la caisse des dépôts, la « banque » de La Chesnaie où les malades viennent chercher leur argent. Je lui cours après. Elle marmonne et s’en va.
« Je m’appelle Sabéran. » Elle se retourne. Voix douce, traînante, familière. « Oooooh, le docteur Sabéran, qu’est-ce qu’il devient ? Je l’aimais bien !
— Il va bien. Il travaille à mi-temps. Je suis Haydée.
— Oh, Haydée ! Il y avait Délara aussi, non ? »
Je n’en reviens pas. Je tire sur une herbe, et en grignote le bout : « C’est toi qui m’as appris ça, Angélique. » Elle lève un bras : « Oh, c’est des vieilles histoires… » Elle rentre la tête dans les épaules et me plante là. Plus tard, je raconte cette rencontre à une monitrice. Elle m’avertit qu’Angélique part le lendemain pour quelques jours. Si je ne vais pas tout de suite dans sa chambre, je ne la reverrai peut-être pas. Entrer dans la chambre d’un malade est un interdit absolu, je sais ça depuis toujours. « Tu as mon autorisation .» Ça m’intimide. Et si Angélique était à nouveau de mauvaise humeur ? Toc toc... Voix boudeuse :
« C’est qui ?
— Haydée.
— Entre, entre ! »
Angélique est allongée dans son lit. Une autre patiente est sur celui d’à côté. Elles fument. Au mur, une affiche du Baiser de Klimt. La voix familière d’Angélique : « Qu’est-ce que tu deviens, Haydée ? » Elle réclame des nouvelles de mes trois sœurs. Elle se souvient de chacun des prénoms. « Je pense à vous tous les jours. Tu te souviens quand on jouait au sable fin ? » Oui, le tas de sable dans la cour, bien sûr. « Ton papa vous disait : “Soyez gentilles avec Angélique, les enfants”. » Puis Angélique me congédie. « Ça m’a fait plaisir de te revoir, Haydée… » On s’embrasse comme du bon pain.
« J’ai cassé la Yougoslavie »
L’histoire du pendu, c’est un jour de printemps, dans l’allée de la chapelle. Je dois avoir 9 ans, Délara bientôt 8. Il est là, les pieds dans le vide, à contrejour, au bout d’un chemin qui mène vers le parc. On ne s’approche pas. On rentre à la maison, anesthésiées. Je ne me souviens pas si on a couru ou marché. Ma mère est occupée à couper du lilas dehors, sur un tabouret.
« On pense qu’on a vu un pendu. On n’est pas sûres.
— Un pendu ? Comment ça, pas sûres ?
— On a peut-être rêvé. »
Elle range son sécateur. « Vous allez me montrer. » On prend les vélos. Ma mère découvre en silence dans le chemin le mort immobile. « Quelle horreur… » Ses mots m’ont réveillée, comme un claquement de doigts. Le soir, mon père nous demande de ne pas en parler à l’école. On n’a rien dit à personne jusque très tard, adultes.
Aux sports d’hiver, on skiait avec les fous, on mangeait avec eux, on vivait dans la même maison. Une proximité inédite. Un jour, un patient casse une pancarte en bois dans la boutique de location de skis. Pierre est un colosse sympa. Il chausse du 47, on trouve ça extraordinaire. Il y a au mur des pancartes, avec les noms des pays d’Europe. Pierre attrape celle de la Yougoslavie et la jette au sol. Puis il se calme. Bien sûr, il est désolé. « J’ai cassé la Yougoslavie. » Les jours suivants, il répète de sa grosse voix lente : « J’ai cassé la Yougoslavie. » Nous, les filles, on se marre, on imite sa voix, on prend un air assoupi, les yeux mi-clos : « J’ai cassé la Yougoslavie. » Il était la mascotte. Il n’aimait pas les virages, dévalait les pistes tout droit, on devait s’écarter. Pour s’arrêter, il se laissait tomber et ne bougeait plus. Des gens s’approchaient : « Ça va, monsieur ? » Il levait la tête : « J’ai faim. » Il y avait toujours quelqu’un pour lui passer un biscuit. Il se levait, repartait tout schuss.
« Docteur, j’arrive pas à dormir ! » L’homme était entré dans la cuisine, avait grimpé l’escalier jusqu’à la chambre.
Un après-midi, dans la file d’attente, en bas du télésiège, mon père me le confie. « Emmène-le rejoindre les autres en haut. Tu feras ça très bien. » Mon père part. J’ai 13 ans. Je ne sais pas bien quoi dire à Pierre. Comme ça ne va pas assez vite, il se met à gueuler. « J’vais tous vous tueeeeeer ! » Je n’ai pas vraiment peur, juste un peu honte. Je me dis : il fait son Chesnéen devant tout le monde. « Pierre, tu sais, je crois qu’il faut être patient… Regarde, ça avance… Bientôt c’est notre tour… » Aujourd’hui, quelqu’un aurait appelé un vigile. Pierre ne dit plus rien. Je regarde le bout de mes skis. On monte en silence sur le télésiège, on rabat le garde-corps, ça grimpe haut. Il se tourne vers moi et dit vite : « J’ai bronzé ? » À l’école, ça m’a fait un nouveau truc à raconter, en plus de la fille nue. Mon père n’a aucun souvenir de cette histoire.
La Chesnaie entrait chez nous. Une nuit, alors que mes parents dorment dans leur chambre, mon père est réveillé par une main qui le secoue. « Docteur, j’arrive pas à dormir ! » L’homme était entré dans la cuisine, avait grimpé l’escalier jusqu’à la chambre. Personne n’avait l’idée de fermer la porte d’entrée à clé. Est-ce que ç’a changé après cet épisode ? « Je ne me souviens pas. Ça m’étonnerait », répond mon père. Certains soignants appelaient les patients les « pensionnaires ». Je le percevais comme un mot ronflant. À la maison, on disait juste « les malades ». Mes parents, iraniens, le disaient en persan : « mariz-ha ». Cette langue nous enveloppait d’un cocon d’intimité à l’intérieur de La Chesnaie. « Pose ta tête sur mon épaule et dors »,me dit un jour mon père, alors que je suis dans ses bras. En persan, « épaule » et « peigne » se disent de la même manière. J’ai longtemps cru que mon père rangeait des peignes dans les épaulettes de ses vestes. Le persan a laissé la place au français après notre départ de La Chesnaie. Peut-être parce que, dans la nouvelle maison, cette bulle que nous offrait la langue était devenue inutile.
David dessinait. Il saluait mon père de sa voix nasillarde : « Bonjour Sabéran. » À l’époque, à La Chesnaie, on utilisait parfois les noms de famille comme des prénoms. Je l’imitais, en me bouchant le nez : « Bonjour Sabéran. » On regardait ses dessins sans se lasser. Un jour, David a voulu visiter New York. À l’ambassade des États-Unis, ils lui refusaient le visa à moins d’être accompagné d’un psychiatre. Il est parti avec mon père. David a mangé du bon riz iranien pendant son séjour : ils n’ont pas passé une seule nuit à l’hôtel, mais chez les cousins de la famille, à New York et en Californie. Ils dormaient dans la même chambre. Mon père lui avait dit qu’ils étaient compagnons de voyage, David l’appelait « compagnon ». Il s’est dessiné de dos, regardant Manhattan, le bras de mon père enserrant son épaule. On adorait. À leur retour, David tendait la main à mon père en disant : « Bonjour compagnon. »
« Je suis contente de vous avoir connue »
Enfant, j’ignorais l’existence de La Kalo, mais elle était déjà là, avec ses miroirs, ses fauteuils de barbier, au premier étage du château, où nous n’allions jamais. En grec, kalos veut dire beau. La Kalo est un salon de beauté tenu par des monitrices. Le masque du visage est à 30 centimes, le gommage, le modelage des mains, la manucure aussi. Calixte, un blond ébouriffé, ferme les yeux la bouche ouverte, la tête dans le bassin de lavage. « Ça va, la température ? » Marcel se fait raser la barbe. Il parle fort devant le miroir. « Ça, c’était du football en 1974 ! Des passes de 40 mètres ! Boum ! » Léa, monitrice : « Marcel, on essaie de se détendre. » Marcel, penaud : « Oui, je sais. » Et aussitôt : « 1974 ! Ça, c’étaient des matchs ! » Il chante : « Hier encore, j’avais 20 ans… » Calixte : « Vous pouvez me faire comme les grands barbiers, une serviette très très chaude ? » Léa : « Un peu de crème ? » Marcel : « Hier encore, j’avais 20 ans... » Calixte : « Dans quelques jours, j’aurai 30 ans. » Léa à Marcel : « Il y a des petites coupures, je vais te mettre un peu d’after-shave » « Nan ! J’aime pas les parfums ! Aucun parfum ! » Elle pose quelques pansements, lui montre le résultat au miroir : « Ça te plaît ? » « Nan ! J’aime pas les pansements ! » Il se regarde. S’apaise. Réfléchit. « Je crois que je suis attiré par les femmes. » Léa : « Tu crois ? » « Je crois. »
Quelqu’un annonce qu’un orage se prépare, « avec des éclairs ». Il pouffe : « Au café ou au chocolat ? »
Je retourne à La Chesnaie à l’automne. Il fait encore doux. Devant l’Orangerie, une monitrice remet à Laura ses papiers et sa carte bleue : elle part dans son appartement pour trois jours. Ça l’angoisse un peu. « Mais j’ai pas envie d’en parler. » Je voulais manger au Train vert, il est fermé. « Il faut que tu reviennes, meuf »,dit Laura. Devant le Boissier, Hafida fait ses comptes après la distribution quotidienne de tabac. Fred est assis, les yeux fermés, au soleil. Des petits chats sont nés. Félicien les nourrit, il a toujours des croquettes dans la poche. Une nouvelle patiente : « Je comprends rien. » Une voix : « Un jour ça viendra. » Félicien m’annonce que Thalia est partie. Les cheveux de Claire ont poussé. Elle revient de « vacances adaptées » en Vendée, avec un groupe qu’elle ne connaissait pas. « La plage, la mer bleue, 10 euros le paquet de clopes, qu’est-ce que c’est cher ! J’étais folle amoureuse d’un moniteur, c’était chaud. » Elle voudrait partir en maison d’accueil spécialisée, un hébergement pour « adulte handicapé gravement dépendant » mais elle ne trouve pas de place. À l’atelier poterie, Charles, celui qui empilait les verres en silence, est méconnaissable. Il s’est redressé, il parle. Quelqu’un annonce qu’un orage se prépare, « avec des éclairs ». Il pouffe : « Au café ou au chocolat ? »
Dans l’allée de la Haute Pièce, voilà Claire, celle qui revient de Vendée. Je lui dis au revoir. « Je suis contente de vous avoir connue,me dit-elle. On a bien rigolé. On se prend pas la tête. » Une Lettre à Élise s’échappe du Boissier, c’est Gaspard au piano, un nouveau venu au visage poupin. Un demi-queue est arrivé. Il était rangé dans un coin, quelqu’un a eu l’idée de le sortir. Gaspard a un monde dans la tête. « Quand Renaud sera mort et que j’aurai fini mes études, je serai le président des années 1980. J’ai découvert des choses sur de Gaulle et Napoléon, personne n’a voulu me croire, comme dans “La Belle et la Bête”. » Sur le piano, il a déposé un sablier de la taille d’une petite bouteille d’eau et laisse s’écouler le sable. Il joue « Voi che sapete », l’air de Chérubin des Noces de Figaro. Mozart envahit le Boissier. Voilà Étienne.
« Vous ne portez pas votre collier touareg…
— Non, pas aujourd’hui.
— Qu’est-ce que vous ressentez quand vous le portez ? »
Hafida m’offre un café. C’est Boris derrière le bar, un patient que je ne connais pas. Il pose mon café sur le comptoir et me regarde : « Vous êtes en visite avant admission ? »