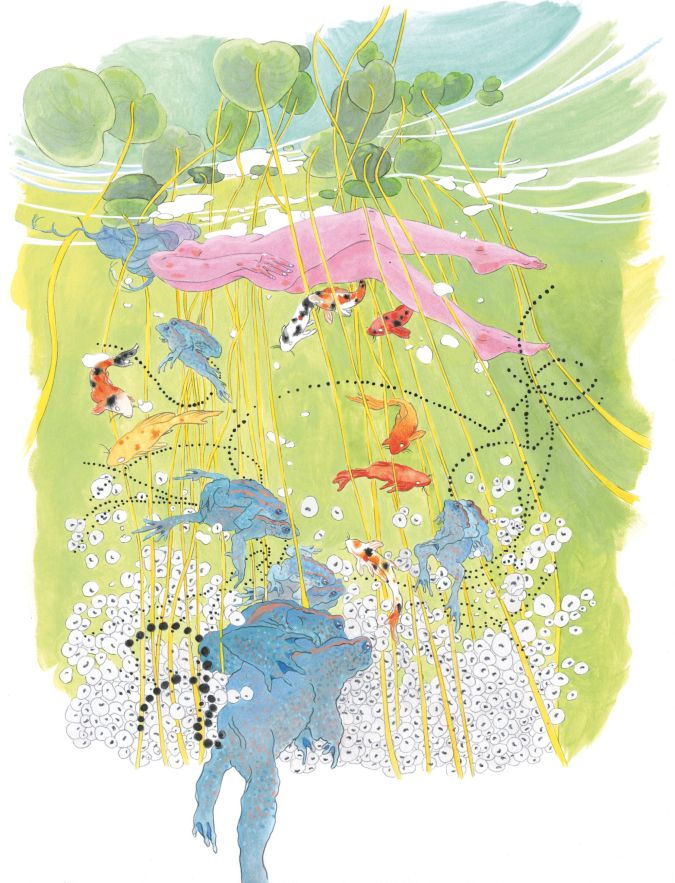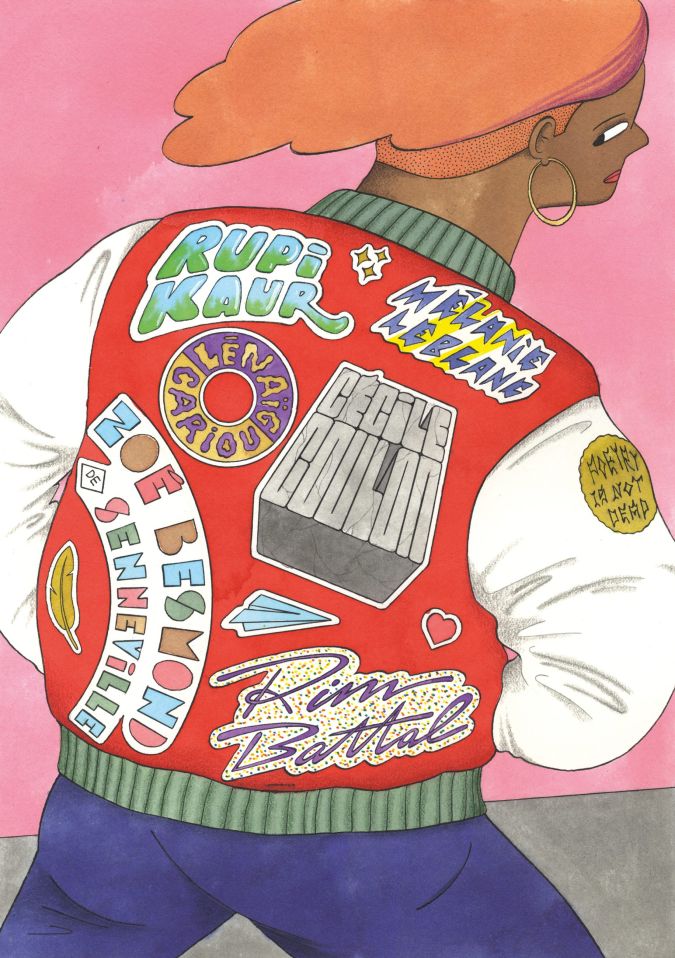Elle n’est bien sûr pas aussi âpre qu’une piste afghane ou yéménite. Mais « the long road », qui traverse l’île écossaise de Jura du sud au nord, n’est pas pour autant de tout repos. Étroite, interminable, faite de voltes et de virevoltes, cabossée, fissurée, creusée d’ornières, elle s’arrête au bout d’Ardlussa, le dernier des hameaux. Après, il faut marcher au milieu des biches et des cerfs, à travers une lande déserte, pour atteindre Barnhill, un ermitage où vécut celui qui imagina Big Brother, prédit l’avènement de la société de contrôle, dénonça l’ère de la postvérité et des fake news, et qui, près de soixante-dix ans après sa mort, revient au panthéon des écrivains à la mode. Non seulement George Orwell, de son vrai nom Eric Blair, a vécu dans ce paradis des brumes à la toute fin de sa vie, mais il y écrivit 1984, son livre prophétique sur l’enfer de la transparence.
L’Écosse aime les écrivains. Édimbourg, la ville du docteur Jekyll et de Mr Hyde, est leur capitale. Depuis longtemps, le « Stevenson tour » emmène les touristes visiter les lieux fréquentés par l’auteur de L’Île au trésor. On y rencontre aussi Sherlock Holmes, déguisé en statue. Il y a également le Writer’s Museum et la tour de 61 mètres en l’honneur de Walter Scott, le père d’Ivanhoé. Dernier itinéraire en date, le « Rebus tour » conduit les lecteurs de Ian Rankin, célèbre auteur de polars, sur les traces de son inspecteur fétiche qu’ils mitraillent jusque dans son pub. Alors, on se dit que Jura, elle aussi, doit être fière d’Orwell, qui eut l’audace folle de venir y écrire son dernier chef-d’œuvre. Un peu comme Victor Hugo pour Jersey et Guernesey. On s’attend même à y trouver un petit musée.
Orwell y a vécu d’avril 1947 à janvier 1949. Lors d’une première visite sur Jura, en avril 2018, je n’avais pu gagner son Finistère, les facétieux ferries ayant annulé une traversée et raccourci mon voyage. De retour en France, le printemps et l’été se révélaient furieusement orwelliens : nouvelle traduction de 1984 chez Gallimard, suivie de plusieurs livres sur son auteur et d’une nuée d’articles sur « le penseur le plus utile pour aujourd’hui », selon Le Point. On parlait aussi de lui dans les pages internationales, Pékin mettant en place des caméras de surveillance couplées d’un programme d’intelligence artificielle capable de scanner dès 2020 l’ensemble des 1,37 milliard de Chinois en « une seconde », ainsi qu’un système de notations susceptible de punir un citoyen à la moindre incartade, comme traverser la rue plus de deux fois hors les clous. Les nouvelles technologies « contribuent immanquablement à transformer le pouvoir chinois en une sorte de Big Brother orwellien digne de 1984 », écrivit le sinologue Jean-Pierre Cabestan.
Orwell à Jura, c’est comme une enquête policière. Pas de crime, mais tout de même mort d’homme : la sienne.
Mais ce que j’étais venu chercher au bout du monde, ce n’était pas tant le prophète du XXIe siècle que l’aventurier engagé, l’écrivain combattant blessé à la guerre d’Espagne, l’humaniste qui avait partagé la détresse des mineurs anglais et « la dèche » avec les miséreux de Paris et Londres. Un nouveau voyage s’imposait. Orwell à Jura, c’est comme une enquête policière. Pas de crime, mais tout de même mort d’homme : la sienne. Avec, dans le rôle de l’assassin, le terrible hiver 1948-1949. Ce dernier segment de sa vie a peu intéressé ses biographes. Quels souvenirs a-t-il laissés aux insulaires ? Existe-t-il des indices permettant de retracer ce moment où il peut encore sauver sa peau en suspendant l’écriture de 1984 ?
5 800 cerfs et biches, 200 habitants
Située dans l’archipel des Hébrides intérieures, l’île est l’une des plus désertiques d’Europe, « un néant fabuleux », selon l’écrivaine Kathleen Jamie. Sublime quand le soleil presse son nez contre la vitre des nuages, violente quand les vents s’en mêlent, sinistre quand le ciel s’absente, mystérieuse quand elle trempe dans les gris sombres, couleurs des ardoises dont les îliens font leurs toits. Isolée, elle l’est aussi : trois heures de voiture depuis Glasgow avant d’arriver au premier ferry, qui permet de rejoindre l’île d’Islay, moins rude, mythique à cause de ses distilleries de whisky. Second ferry, celui-là beaucoup plus petit, qui vous dépose sur le débarcadère désolé. Commence le petit monde de Jura : 5 800 cerfs et biches, selon le dernier recensement (Jura signifie « l’île aux cerfs » en langage norrois) et 200 habitants.
Certains jours, on se croirait au cap Horn. Des rafales à briser les bois des grands cerfs. Les habitants se calfeutrent chez eux ou dans le seul pub de la seule rue du seul village, la « capitale » de l’île, une miniature nommée Craighouse : un alignement de maisons le long de l’Atlantique, une distillerie célèbre, un magasin général, un petit hôtel, un clocher, une classe d’école primaire, une jetée et quelques bateaux de pêche. Aucun policier sur l’île. Pas même un garde champêtre. Aucune vidéosurveillance. On baigne dans une odeur étrange portée par les embruns, une mêlée de tourbe et d’effluves de whisky.
À l’hôtel Jura, une peinture représente Orwell assis derrière sa machine à écrire, son éternelle cigarette vissée aux lèvres. Mais le serveur avoue n’avoir jamais poussé jusqu’au cottage de Barnhill, comme si l’endroit était déjà une terre étrangère, située pourtant à une quarantaine de kilomètres. L’hôtel vend une petite brochure sur le romancier, écrite en 1983 alors que l’île s’attendait pour l’année suivante à une invasion de fidèles. Mais seule une équipe de cinéma vint tourner un film : les Land Rover se renversaient ou s’enlisaient du côté d’Ardlussa, au grand ravissement des habitants. Puis surgirent du monde entier des volées de journalistes pour consacrer l’an 1984. « Une jeune dame de Corée pouvait difficilement placer un mot d’anglais. C’était difficile d’être sûr qu’elle relatait les faits correctement. Elle avait l’habitude de mettre un zéro supplémentaire derrière chaque chiffre, ce qui fit grimper la population de Jura de 200 à 2 000 », raconte Gordon Wright, l’auteur de la brochure.

Aucune autre trace d’Orwell à Craighouse. Aucun de ses livres dans le seul magasin de l’île où l’on trouve à peu près tout alors que 1984 s’est vendu à plus de 30 millions d’exemplaires dans le monde et s’est retrouvé en tête des ventes sur Amazon après l’élection de Donald Trump. Personne non plus qui soit en âge de se souvenir de lui.
Trois copines
En suivant « the long road » pour gagner Barnhill, on cherche quelle part de l’île se retrouve dans 1984. Lorsque Winston, le héros désespéré du roman, retrouve Julia pour leurs dangereuses et clandestines étreintes au cœur de la forêt, il évoque « les tapis de jacinthes » et l’air comme « un baiser sur la peau », mais la description vaut pour mille autres lieux. Rien qui évoque précisément Jura.
La route arrive à Inverlussa et Ardlussa, les tout derniers hameaux. C’est ici que trois copines, dont aucune n’est écossaise, se sont installées avec compagnon et enfants. Alicia MacInness, 40 ans, a été serveuse dans le pub avant d’y rencontrer l’âme sœur : « Je venais de Perth en Australie et je voulais être architecte. Mais quand on est à Jura, qu’importe le boulot qu’on y fait. » Claire Fletcher, 50 ans, Londonienne, productrice musicale pour BBC Radio 1, est arrivée à Jura par hasard en suivant un groupe de rock. « Je sais que Jura était la pièce manquante dans mon puzzle personnel. Je veux être en prise avec la nature, faire partie d’une communauté robuste et que ma vie soit différente. Avant nous, le seul boulot des femmes, ici, c’était le ménage et la cuisine. Il fallait changer ça. » Quant à Georgina Kitching, 45 ans, c’est son passé de professeur de sciences qui a permis l’initiation de la petite équipe à la distillation.
Je n’avais rien compris à 1984. Maintenant que je vis ici, je le saisis beaucoup mieux.
Claire Fletcher, productrice musicale
Si Orwell voulait vivre en autarcie, c’était pour mener à bien son œuvre littéraire loin des téléphones, et par peur d’un conflit nucléaire, une angoisse fréquente à cette époque du fait que l’URSS s’avançait sur le chemin de la bombe. Mais c’était aussi pour donner à son fils adoptif, le petit Richard, une éducation libertaire, au plus près de la nature. Avec eux étaient venus vivre à Barnhill la sœur d’Orwell, ainsi qu’un fermier, Bill Dunn, et un ami, Richard Rees. Ils formaient un petit phalanstère. À leur manière, les trois copines en constituent un aussi, soudé par une passion pour la liberté. Un beau jour de l’été 2015, elles ont décidé de monter une distillerie et de fabriquer du gin. Elles achètent alors un vieil alambic au Portugal qu’elles installent dans les petites écuries du hameau, au-dessus duquel flotte un grand drapeau écossais. Le gin Lussa, du nom de la rivière en contrebas, est fait de genièvre, de thym, de coriandre, de pétales de rose, de citronnelle et de fleurs de tilleul.
« Nous ne sommes pas que des amoureuses du gin. Nous sommes des aventurières », écrivent-elles crânement, faisant référence à la difficulté de vivre dans la wilderness (les « terres sauvages »). Comme argument publicitaire, les filles citent Orwell, qui lui-même distillait de la mélasse noire qu’il faisait fermenter et bouillir pour obtenir du… rhum. Le « gin de la victoire », un breuvage prolétarien, décrit comme « une gnôle au goût de pétrole », traverse tout 1984. Mais à peine parle-t-on de l’écrivain aux trois copines qu’elles restent coites. Alicia et Georgina ne l’ont jamais lu. « Il faudra que je m’y mette un jour », dit négligemment la seconde. Claire, l’ex-productrice musicale de la BBC, l’a étudié, ado, en classe d’anglais. « Mais je n’avais jamais rien compris. Maintenant que je vis ici, je le saisis beaucoup mieux. »
Un petit carnet intime
Dans le hameau voisin d’Inverlussa habite Kate Fletcher, qui a les clés de Barnhill, le cottage où vécut Orwell. Son jardin, situé devant une ancienne école fermée depuis belle lurette, est protégé comme Fort Alamo pour prévenir une invasion de lapins. Elle n’aime pas les importuns mais accepte d’ouvrir sa porte. Kate Fletcher a une âme de trappeur. Orwell tirait les cerfs au fusil et les lapins au Luger – il avait toujours un pistolet, convaincu que les staliniens cherchaient à l’éliminer depuis la guerre d’Espagne. Elle s’occupe d’évider les cervidés, dont huit têtes sèchent sur un mur.
Vêtue de laine polaire, d’un jean et chaussée de baskets, faisant beaucoup plus jeune que ses 60 ans, avec un regard qui va droit dans les yeux et un corps solidement charpenté, elle écorche une neuvième tête qui gît sur le chevalet destiné à couper du bois. Elle la saisit par un cor et la retourne d’un tour de poignet en ronchonnant contre le chasseur venu du main land qui lui a apporté son trophée trop tard et le voudrait « prêt » avant le soir.
La famille Fletcher est d’Aberdeen, l’une des villes les plus riches du Royaume-Uni, sur la mer du Nord. Le grand-père maternel de Kate a acheté le nord de Jura, dont la vieille ferme de Barnhill. Kate n’a quitté l’île que pour ses années universitaires, ce qui ne l’a pas empêchée de voyager et d’élever trois filles, toutes des bourlingueuses. Elle est trop jeune pour avoir connu l’écrivain mais son frère, Jamie, un peu plus âgé, en conserve un vague souvenir. Elle a lu 1984 quand elle avait 16 ans, s’inquiète de la nouvelle traduction en français. « Est-ce que l’éditeur au moins a demandé la permission ? »
Il travaillait allongé sur un lit métallique qui n’était vraiment pas confortable.
Kate Fletcher, habitante de l’île
Kate appelle George Orwell par son vrai prénom, Eric, comme s’il allait débouler d’une minute à l’autre pour prendre le thé, qu’elle sert dans un mug décoré de son livre-phare. Quand « Eric » n’était pas le nez au vent, sa machine à écrire, qu’il qualifie dans une lettre de « déplorable » et qui lui donne un mal de chien, crépitait du matin au soir. « Il travaillait allongé sur un lit métallique qui n’était vraiment pas confortable. Et il se chauffait avec un poêle à la paraffine qui a contribué à ruiner sa santé », raconte-t-elle. Il n’avait pas renoncé au tabac, du gros noir, épais, puissant, alors que ses poumons étaient en loques, déchiquetés par la tuberculose.
Rien à faire pour que Kate prête les clés du cottage, même le temps d’une visite. « Il n’y a plus rien dans la ferme qui date de l’époque d’Eric. Sa sœur Avril a enlevé tous les meubles et sa machine à écrire. » Mais, de bonne grâce, elle révèle cacher une pépite dans sa maison : le petit carnet intime que sa mère, Margaret, a tenu dans les années 1940 et qui parle de lui. Elle accepte d’en montrer quelques pages.
« Les enfants avaient très peur de lui »
En avril 1947, lorsqu’il arrive à Ardlussa, l’écrivain a l’apparence d’un spectre, long, maigre et pâle, avec une moustache drue et sévère, et des cheveux en ailes de corbeau. Il vit dans le chagrin de la mort de sa mère, de sa femme Eileen d’une opération de l’appendicite, et de celle, toute récente, de sa sœur. Il a déjà la maladie aux trousses, même si la tuberculose n’a pas encore été diagnostiquée. Il sait que les années lui sont comptées. D’où les hésitations de Margaret Fletcher, la mère de Kate, à l’idée que ce frêle gentleman, issu comme son mari de l’école ultraélitiste d’Eton, s’installe dans ce coin rincé par les tempêtes.
« J’étais très sceptique à l’idée qu’il puisse vivre ici avec un petit enfant, mais il était déterminé à venir », écrit-elle dans son journal. Elle ajoute : « Je me souviens très bien de son arrivée, un soir, par le bateau du courrier. Il paraissait décharné et malade. Le lendemain, Robin et moi l’avons emmené à Barnhill avec notre vieux camion dans lequel nous avons chargé quelques meubles que nous avions en trop, et nous l’avons laissé là-bas avec comme provisions de quoi tenir quelques jours. N’ayant pas lu Dans la dèche à Paris ou Hommage à la Catalogne où il décrit les conditions tout à fait horribles qui furent les siennes, j’étais extrêmement inquiète de savoir comment cette silhouette fragile allait pouvoir survivre dans cet avant-poste isolé, où la rusticité et l’autosuffisance atteignaient un tel niveau. »
Dès le lendemain, Orwell se met au travail. Il veut à la fois écrire et vivre en autarcie. Mais la terre est dure, peu encline à être apprivoisée. Il lui faut consacrer beaucoup de temps et d’efforts avant qu’elle apporte quelques légumes. Une fois par semaine, nous apprennent les carnets de Margaret, il se rend à pied à Ardlussa, pour chercher son courrier et passer commande à la lointaine épicerie. La guerre s’est achevée mais le rationnement continue, les denrées sont rares. Jusqu’à ce que son jardin soit prêt, il va chercher légumes, œufs et lait à Kinuachdrachd, la ferme la plus septentrionale de l’île, à 3 kilomètres de Barnhill. Un autre recoin désolé où vivent les Rozga, de misérables métayers d’origine polonaise. « Il y allait à bicyclette, marchant aussi quand la piste était trop dure pour pouvoir pédaler, et souvent, il arrivait à leur porte vêtu d’un ciré et d’un suroît. Les enfants avaient très peur de lui », écrit Margaret. Aujourd’hui, l’endroit est plus ou moins abandonné. Sa dernière locataire était une « vieille sorcière » qui s’est réfugiée à Craighouse. Elle a laissé une oie triste qui erre dans le jardin.
L’herbe n’a pas commencé à pousser, les oiseaux dans les arbres ne sont pas vraiment visibles.
Journal intime de George Orwell
Orwell vit une main sur la machine à écrire, une autre sur le fusil, la herse, la brouette, la rame ou la canne à pêche. Il est aussi éleveur – il a des vaches et un bon gros cochon, qui finira en saucisson –, menuisier, mécanicien sur une vieille moto qui tombe en panne. Et même rebouteux, préconisant de guérir les morsures de vipères – elles abondent dans l’île – en écrasant… un cigare allumé autour de la plaie. C’est dans ces conditions qu’il écrit 1984. Une première fois, puis une seconde, car la version originale est à peu près illisible à cause des ratures et des rajouts. Il lui faut retaper entièrement les 360 pages de son manuscrit. Il cherche à contacter des dactylos mais aucune ne veut se risquer jusqu’à Jura. Chaque jour, il note les aléas de la terre dans ses diaries, son journal intime. « L’herbe n’a pas commencé à pousser, idem pour les ajoncs, les oiseaux dans les arbres ne sont pas vraiment visibles », écrit-il le 4 décembre 1947, de retour de Glasgow où il a été hospitalisé. C’est cet enracinement, lié à son individualisme viscéral, sa volonté de privilégier les faits avant l’idéologie, qui, conjugué à sa détestation du totalitarisme – en particulier soviétique –, fait que certains intellectuels le classent aujourd’hui parmi les écrivains de droite. D’autres, pourtant, soulignent que sa volonté de rester toujours proche des gens ordinaires, son hostilité à l’égard du nationalisme et du colonialisme le rangent à gauche.

Dans plusieurs de ses livres, Orwell incarne le portrait du vrai aventurier, audacieux et généreux. À Barnhill, il ne l’est pas moins. Avec son canot, auquel il a ajouté un moteur, il se balade près du golfe de Corryvreckan, un goulet dangereux à cause d’un maelström, le troisième tourbillon du monde par sa puissance et la seule zone maritime que la Royal Navy ait interdite à toute navigation. Le naufrage intervient en août 1947. Ayant mal calculé les horaires des marées, il perd le contrôle du canot où ont pris place son neveu et sa nièce, âgés d’une vingtaine d’années, en vacances chez lui, et son fils adoptif, le petit Richard. Le moteur est arraché. Bientôt, le canot se retourne, l’enfant tombe dans l’eau glacée, passe sous la barque, manque de se noyer et est sauvé par son père. Réfugiés sur l’îlot rocheux d’Eilean Mòr au milieu du détroit, ils n’ont pour provisions qu’une seule pomme de terre qu’ils feront cuire avec de l’herbe sèche et donneront à Richard. « […] Nous aurions pu rester en rade un jour ou deux, mais, à notre grande chance, des pêcheurs de langoustes ont aperçu le feu que nous avions allumé en guise de signal et nous ont tirés d’affaire », racontera sobrement Orwell dans une lettre. Kate, qui tient l’histoire de sa mère, ajoute qu’Eric « se comporta comme un vrai gentleman », s’attachant à la sécurité de chaque passager avant de songer à la sienne.
Apprenant que je compte gagner Barnhill le lendemain, Kate insiste pour me voir partir sur-le-champ : « Surtout n’y allez pas demain. Ce sera un jour de grande pluie avec des vents furieux. Et vous n’y arriverez pas. » J’ai beau faire valoir que l’après-midi est déjà bien avancé et que le retour risque de se faire de nuit, « ça sera toujours mieux comme ça », répond-elle.
Mourir sur « l’île sauvage »
Après un dernier raidillon, le cottage blanc au toit d’ardoises surgit en contrebas. Avant la pluie, la fée du beau temps perce les nuées avec magie : un vallon sauvage tapissé de fougères, l’océan d’un bleu mystique, avec un chapelet d’îlots, un ciel imaginé par Turner ou Monet et, au loin, la péninsule de Kintyre dont les collines ruissellent d’ombre et de lumière. C’est donc ici qu’Orwell a voulu finir sa vie. Même sans Sonia, la femme qu’il aimait et épousera à l’hôpital quelques semaines avant de mourir. Au cours de ses séjours au sanatorium, il ne cessait d’envisager son retour dans « l’île sauvage ».
Dans Hommage à la Catalogne, autre grand chef-d’œuvre, celui-ci autobiographique, l’écrivain se reconnaît frileux et se plaint beaucoup du froid sur le front d’Aragon, en Espagne. Alors, en imaginant la pluie qui tabasse, les brouillards dans leurs épais et humides manteaux, on se dit qu’il a dû geler corps et âme dans ce cottage aux murs noirs de suie et à l’éclairage parcimonieux, qui, lorsqu’il s’y est installé, n’était plus habité depuis… dix-sept ans. Quelles pulsions intimes, quelle quête de l’intériorité, quelle volonté d’établir une distance entre sa vie et la société l’ont entraîné, au plus fort de sa célébrité, dans cet ermitage, lui qui n’avait pas toujours dédaigné les pubs bruyants de Portobello Road, à Londres ? « Il fallait avoir fait la guerre pour pouvoir vivre à Barnhill, m’a dit Kate. Seuls les vrais amis d’Eric venaient jusqu’ici pour le voir. »
Le corps principal repeint en blanc a été en partie remodelé. Kate et son frère Jamie ont dû tout faire eux-mêmes, peinture, plomberie, car il n’y a pas d’artisans à Jura. Kate a même remplacé le toit, charriant pas moins de sept palettes d’ardoises. L’électricité n’étant jamais arrivée jusqu’ici, un générateur a été installé. Aucun projet de musée ni de plaque commémorative. Mais à l’été et au printemps, on peut louer ce bout du monde. Si Orwell l’occupait pour trois sous, à présent c’est 1 000 livres la semaine ! Surtout, ne pas oublier les provisions pour la durée du séjour. Selon Kate, « un locataire sur dix est intéressé par Orwell. Cela dit, les autres viennent pour les mêmes raisons que lui : s’isoler du monde ».
À la fin de l’été 1948, l’écrivain a usé ses dernières forces. Sa sœur Avril n’a jamais oublié le moment où 1984 fut terminé : « Je le revois descendre de la chambre où il écrivait. Il a ouvert la dernière bouteille de vin que nous avions à la maison et nous avons bu […] pour fêter le nouveau livre. » Mais en janvier 1949, la tuberculose a gagné la bataille. Le trajet vers l’hôpital est terrible. « La route était pleine de fondrières de la taille à peu près d’une table et impossible à éviter. On est tombé dans l’une d’elles et on n’arrivait plus à sortir la voiture », indiquera sa sœur. Pendant qu’elle va chercher, avec un ami, du secours à 7 kilomètres, Orwell lit un poème à Richard, ce fils adoré, alors âgé de 5 ans. Il s’éteint l’année suivante, le 21 janvier 1950. À 46 ans.
Avec la tombée de la nuit, les cerfs commencent à bramer de façon interminable. À proximité d’Ardlussa, un grand panonceau évoque un peu d’histoire locale et s’attarde sur un barde gaélique que personne ne connaît plus, excepté peut-être Big Brother. Orwell, lui, n’a droit qu’à deux lignes qui rappellent qu’il manqua de se noyer dans le golfe et qu’ayant survécu il écrivit 1984. À l’évidence, les insulaires ne l’ont pas adopté. À la distillerie de Jura, on se moque aussi de lui mais on a compris que sa célébrité pouvait rapporter. D’où la cuvée spéciale « 1984 » consistant en 1 984 bouteilles, chacune vendue… 945 euros.
Est-ce parce qu’il a superbement ignoré les Jurassiens dans ses écrits que ceux-ci le lui rendent bien ? Est-ce parce que 1984 ne doit rien à la force inouïe des grands ouragans, aux vents si violents qu’ils terrassent les arbres, et à la beauté de chaque éclaircie ? Peut-être. Cette odyssée orwellienne, Kate Fletcher la résume d’une seule phrase : « Eric a apporté avec lui à Barnhill son côté obscur sans même tenir compte des merveilleux paysages. »