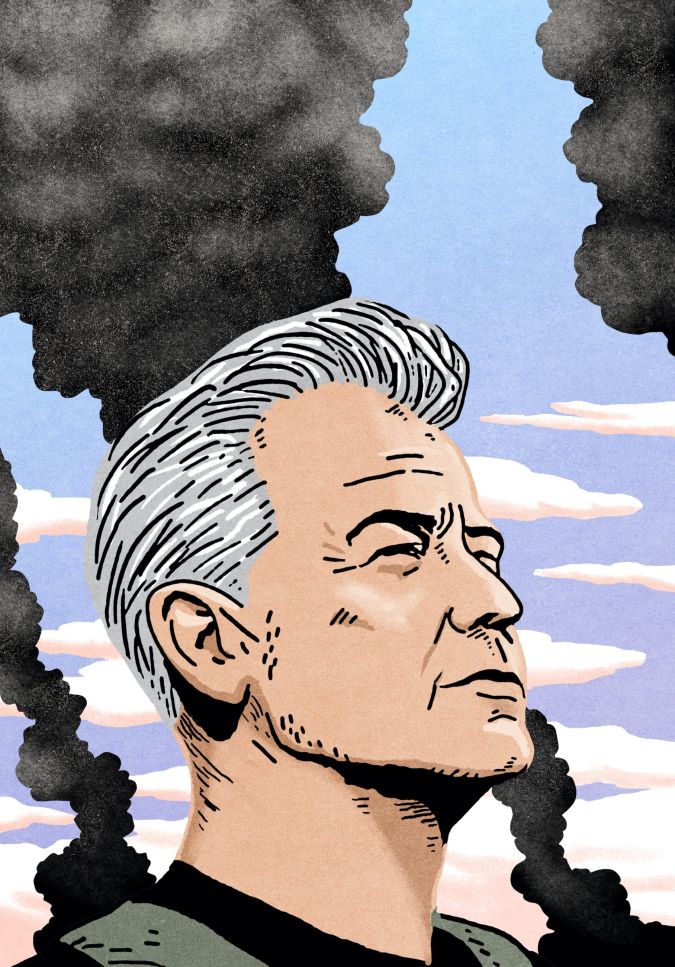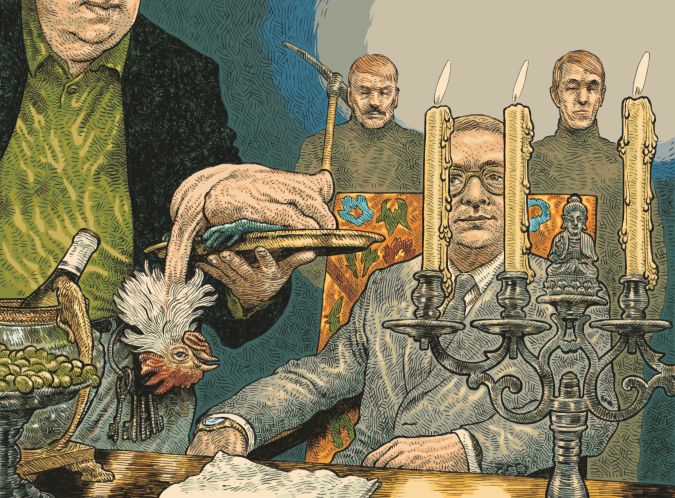L’invasion de l’Ukraine en 2022 a fait redécouvrir, dans la brutalité de la guerre cinétique, une idée que beaucoup croyaient disparue en 1991 : l’Empire russe. À en croire Thorniké Gordadzé, chercheur en sciences politiques et ancien ministre chargé de l’intégration européenne de la Géorgie, l’État russe et ses relais dans les anciens pays de l’URSS n’ont pourtant jamais renoncé à l’idéologie impérialiste.
Du point de vue de Gordadzé, la guerre en Ukraine n’est pas un événement isolé, mais la forme la plus spectaculaire d’une vision qu’entretient la Russie d’elle-même et de son environnement : les pays qui l’entourent sont ses provinces naturelles et doivent mécaniquement revenir sous son autorité. C’est en ce sens qu’il faut comprendre Vladimir Poutine lorsqu’il disait en 2005, dans son adresse annuelle à la nation russe, que « la chute de l’URSS a été la plus grande catastrophe géopolitique du siècle ». À lui, maintenant, de réparer l’histoire.
Cri d’alerte
Derrière ce rêve d’empire, il y a un mode d’emploi. Thorniké Gordadzé le connaît intimement. Nommé à l’intégration européenne après la guerre qui a opposé son pays à la Russie en 2008, il avait une mission à accomplir en urgence : signer un accord suffisamment engageant avec l’Otan, le Membership Action Plan, afin de placer la Géorgie sous la protection d’un autre parrain.
Quinze ans plus tard, force est de constater l’échec de son camp : le pouvoir géorgien, qui bascule dans l’autoritarisme, est entièrement sous influence russe. Pendant toutes ces années, en tant que haut responsable politique puis chercheur, Thorniké Gordadzé a vu aux premières loges l’arsenal de techniques par lequel l’impérialisme russe avance dans ses anciens territoires.
Certaines méthodes remontent aux tsars. D’autres sont héritées de l’ère soviétique. D’autres encore sont des innovations récentes issues de la guerre hybride. Ces procédés influencent aujourd’hui les élections à Tbilissi, Bucarest ou Chisinau. Tout juste rentré d’une tournée en Ukraine puis en Moldavie, le professeur à Sciences-Po Paris les décortique, cliniquement. Il relaie aussi le cri d’alerte de ceux qui, en Ukraine et dans le Caucase, de la Moldavie aux pays baltes, entendent y résister.
Une nouvelle vague d’arrestations de responsables politiques a eu lieu en Géorgie, en juin 2025. Que s’est-il passé ?
Thorniké Gordadzé : Plusieurs représentants de l’opposition au parti au pouvoir, Rêve géorgien, ont été incarcérés. Ce sont des gens que je connais, avec qui, pour certains, j’ai été au gouvernement entre 2010 et 2012. Je crains qu’ils ne sortent jamais de prison. Le gouvernement géorgien vient de franchir un point de non-retour, il est en train de renoncer à tout ce qui ressemblait, de près ou de loin, à une société pluraliste. Une commission parlementaire géorgienne s’est donné pour objectif de réécrire tout ce qu’il s’est passé depuis la révolution des Roses, en 2003, lorsqu’un mouvement populaire a renversé un gouvernement corrompu. Cet acte de naissance de l’État de droit en Géorgie est désormais présenté comme un complot de la CIA et ceux qui s’en étaient réjouis sont considérés comme des agents de l’étranger.
Mais le révisionnisme ne s’arrête pas là : la commission parlementaire accuse les dirigeants de l’époque d’être responsables de la guerre de 2008 avec la Russie, qui a coûté à la Géorgie 20 % de son territoire. Les responsables d’alors auraient déclenché le conflit à la demande des Occidentaux pour affaiblir la Russie. C’est la reprise terme à terme du discours du Kremlin. Le leader informel du pays, l’oligarque Bidzina Ivanishvili, a même déclaré en septembre 2024 que la Géorgie devrait présenter des excuses pour 2008.
Cette réécriture de l’histoire est très importante pour Vladimir Poutine. Du coup, tous ceux qui veulent se rapprocher de l’Union européenne sont désormais présentés comme appartenant au « parti global de la guerre ». Aux dernières élections, le parti Rêve géorgien a placardé partout des images des ruines ukrainiennes. « Voilà ce qui arrive aux ennemis de la Russie », avertissaient les affiches.
En Géorgie, Ivanishvili contrôle tout le service public, complètement purgé des éléments jugés non loyaux.
Comment les Russes exercent-ils leur influence sur la politique géorgienne ?
Bidzina Ivanishvili est leur obligé. Même s’il n’a officiellement aucune responsabilité politique, autre que président d’honneur du parti au pouvoir, il est le dirigeant de facto du pays. Il a un contrôle total à la fois sur le parti et sur le gouvernement, qui est constitué de ses anciens employés : son ancien garde du corps a été ministre de l’intérieur et chef des renseignements, son avocat ministre de la justice, le dentiste de son épouse ministre de la santé… Il faut savoir qu’Ivanishvili est immensément riche, sa fortune personnelle représente 40 % du PIB annuel de la Géorgie, et il doit cette richesse en grande partie aux Russes. Il possède des radios et des chaînes de télévision qui diffusent leur propagande. Surtout, il contrôle entièrement tout le service public, qui est complètement purgé des éléments jugés non loyaux.
Passer par un oligarque soumis à ses intérêts est un classique de l’impérialisme russe. En Arménie, où le gouvernement de Nikol Pashinyan a opéré un revirement stratégique favorable à l’Occident, la Russie a récemment activé le même type de personnage. Un oligarque russe d’origine arménienne, Samvel Karapetyan, essaie en ce moment de séduire l’opinion publique et la classe politique avec son argent. Soutenu par l’Église et une partie de la classe politique, il lance des idées d’insurrection, accuse le gouvernement d’être illégitime et il a appelé au coup d’État, ce qui lui a valu d’être arrêté le 18 juin 2025.
À l’été 2026, il y aura des élections parlementaires cruciales en Arménie et le gouvernement actuel se prépare à devoir contrecarrer des manœuvres de déstabilisation et d’achat de votes. Un scénario similaire se dessine en Moldavie avec l’oligarque Ilan Shor, qui finance toutes les activités anti-européennes et qui est le relais direct de Moscou.
Justement, vous revenez de Moldavie, où s’affrontent les camps pro-russe et pro-européen aux élections. Qu’y faisiez-vous ?
J’y étais invité pour raconter l’expérience géorgienne. Je veux que ce qui est arrivé à la Géorgie soit utile aux Moldaves, car leur pays est actuellement sur la ligne de front. L’élection présidentielle de novembre 2024 a été gagnée de justesse par Maia Sandu, contre Alexandr Stoianoglo, pro-russe. Tout comme le référendum sur l’inscription dans la Constitution de l’intégration européenne comme objectif du pays. On a vu la force de la propagande russe et des techniques de mobilisation : l’achat de votes, le transport d’individus de différentes régions de Russie, la propagande à haute intensité. Comme en Géorgie, les affiches et les discours agitent la peur de la guerre avec la Russie. Ils diabolisent l’Europe qui voudrait dissoudre les traditions orthodoxes, la famille ou la distinction entre hommes et femmes.
Le candidat pro-russe a été contré l’année dernière, mais les élections législatives du mois de septembre 2025 vont être décisives. La Géorgie, c’est ce qui attend les Moldaves si les pro-russes gagnent : la fin de la démocratie, la répression, l’adieu à l’intégration européenne. Ce sera la dernière élection digne de ce nom qu’ils autoriseront. Ce serait une erreur de penser qu’ils partiront un jour par la voie des urnes, nous le voyons clairement en Géorgie.
Les khans de Crimée ont gagné la guerre contre la Russie au XVIIe siècle. Dirait-on que Moscou revient aux Tatars ?
Que répondez-vous à l’argument selon lequel ce sont les Occidentaux qui ont provoqué la Russie en voulant s’étendre aussi loin ?
Après la première invasion de l’Ukraine, en 2014, j’ai été auditionné par la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale française. Quand je suis sorti de cette réunion, j’ai réalisé que 90 % des questions des députés français cherchaient à justifier l’agression russe. La première idée reçue est qu’un territoire comme l’Ukraine appartient historiquement à la Russie et que donc, après tout, elle a un droit naturel à le revendiquer. Il était très difficile de faire comprendre aux députés, de tous les partis politiques d’ailleurs, que les Ukrainiens formaient une nation à part entière, qui avait le droit à l’indépendance et à l’intégrité territoriale.
Le fait de dire, par exemple, que la Crimée a toujours été russe est une ineptie. La Crimée a été russe à un moment donné, comme elle a été ottomane, comme elle a été grecque, comme elle a été indépendante aussi – le khanat de Crimée, par exemple, a gagné la guerre contre la Russie au XVIIe siècle. Les khans de Crimée ont même pris Moscou. Dirait-on que Moscou est un territoire qui revient aux Tatars ?
Une autre justification consiste à dire que la Russie aurait été humiliée par l’élargissement de l’Otan et la reconnaissance de l’indépendance des pays issus de l’URSS, et qu’elle se défend.
La Russie n’a pas été humiliée, bien au contraire. Permettez-moi de rappeler un fait historique simple. Contrairement à ce que dit Vladimir Poutine, ce n’est pas l’Occident qui a détruit l’Union soviétique avec la complicité de « traîtres » comme Gorbatchev et Eltsine. L’Union soviétique s’est effondrée toute seule, de l’intérieur, épuisée économiquement et politiquement.
Mais ce n’est pas tout. Dans les années 1990, la Russie était très affaiblie et des tendances centrifuges très fortes, menaçant l’unité du pays, se sont manifestées au sein de la Fédération – non seulement dans le Caucase du Nord, avec la guerre en Tchétchénie, mais aussi en Russie centrale, le Tatarstan disposant alors d’une représentation quasi diplomatique à Paris, ou encore dans l’Oural. L’Occident a alors soutenu l’unité russe, effrayé par l’idée qu’une puissance nucléaire puisse se diviser en plusieurs petits États qui seraient chacun dotés de leur propre arsenal.
C’est pour cela qu’en 1994, dans le mémorandum de Budapest, l’Ukraine a été forcée par la Russie et les États-Unis d’abandonner sa part de l’arsenal nucléaire soviétique, en échange de la promesse que sa grande voisine garantisse son intégrité territoriale. Pendant tout ce temps-là, dans les années 1990 et au début des années 2000, la Russie recevait des milliards d’euros de la Banque mondiale et du FMI, qui soutenaient sa transition vers l’économie de marché. Et, à l’époque, pour justement ne pas humilier la Russie, la porte du G7, devenue G8, lui a été ouverte. Le pays ne remplissait pourtant pas les deux conditions principales requises : être une démocratie et posséder une économie très développée. Le PIB russe équivalait à celui des Pays-Bas, pour un pays dix fois plus peuplé et quatre cents fois plus vaste.
Nous sommes chez nous partout où un soldat russe a posé le pied !
Vladimir Poutine, au forum économique de Saint-Pétersbourg
Alors d’où la Russie tire-t-elle cette logique de revanche ?
Si une erreur a été commise, c’est lors de l’effondrement de l’Union soviétique : rien n’a été fait pour sortir la Russie de la problématique impériale. Il faut dire que cette notion lui est quasiment consubstantielle. Depuis le début de son histoire, la Russie moderne n’a jamais existé sous forme d’État-nation. Elle apparaît à la fin du XVe siècle avec le déclin de l’empire tataro-mongol et, immédiatement, elle se lance dans des conquêtes territoriales. La Russie s’élargit très vite, conquiert la capitale du Tatarstan, Kazan, et, en allant sur la Caspienne, le long de la Volga, Astrakhan. Ensuite, les Russes traversent la Volga, vont jusqu’à l’Oural puis, de l’Oural, au Pacifique. Ils ne rencontrent chez les peuples sibériens que très peu de résistance.
La grande différence avec les nations européennes qui avaient des empires coloniaux, c’est que ces pays étaient déjà des États-nations quand ils ont constitué des empires. Il y avait une rupture possible avec la métropole, puisqu’elle était antérieure. La Russie n’a jamais eu de phase d’État-nation préexistant à la conquête impériale. La Russie n’a pas un empire colonial, la Russie est l’empire colonial. Si elle est séparée de ce qu’elle juge être sa province, comme cela a été le cas au moment de la chute de l’URSS, elle se sent menacée dans son existence.
Il y a une quinzaine d’années, dans le cadre d’une émission de télévision, le président russe a rencontré des enfants dans une école. Devant une grande carte au tableau, un écolier a demandé : « Mais Vladimir Vladimirovitch, où s’arrêtent les frontières de la Russie ? » « Elles ne s’arrêtent nulle part », a répondu Poutine. Cet été, il a même dit au forum économique de Saint-Pétersbourg : « Nous sommes chez nous partout où un soldat russe a posé le pied ! » Pour que la guerre s’arrête à l’est de l’Europe, il faudra un changement tectonique et radical de ce mode de pensée.
Pour vous, c’est cette même idéologie qui sous-tend les tactiques d’influence et les conflits en Europe de l’Est ?
Ce qui se passe en Géorgie, comme en Moldavie et en Roumanie, relève exactement du même principe que la guerre livrée aux Ukrainiens : la volonté de Vladimir Poutine de restaurer son empire. L’invasion de l’Ukraine de février 2022, c’est la continuité de la guerre de Crimée et du Donbass en 2014-2015, de la guerre avec la Géorgie en 2008 et de celles de Tchétchénie des années 1990 et du début des années 2000. Cet impérialisme prend parfois une forme militaire, comme en Ukraine aujourd’hui, mais il faut faire un effort conceptuel pour le comprendre comme une continuité d’actes, qui constituent ce qu’on appelle désormais la « guerre hybride », et qui va de l’influence à l’usage des armes.
En Géorgie, les Russes ont développé des techniques employées désormais partout ailleurs et dont on ne peut que constater l’efficacité. La Géorgie était pourtant le plus hostile des anciens membres de l’URSS à l’influence de Moscou. Aujourd’hui, et malgré la guerre de 2008 qui a traumatisé beaucoup d’habitants, la Russie a réussi à mettre la main sur le pays.
Comment s’y est-elle prise ?
Revenons quelques années en arrière. Lorsqu’en 2008, les pays occidentaux reconnaissent l’indépendance du Kosovo, Vladimir Poutine est furieux. Il veut prendre sa revanche. Il rencontre Mikheïl Saakashvili, le dirigeant géorgien d’alors, et lui dit : « Je vais faire de ton pays la Chypre du Nord », autrement dit un pays scindé en deux, dont une partie est contrôlée par une puissance étrangère. Mais, déclare-t-il à la télévision russe à l’attention de ses ennemis à l’Ouest, « nous n’allons pas vous singer ». Il ajoute une phrase dont je me souviens encore : « Nous avons notre recette maison. » Son premier ingrédient est aussi vieux que les tsars : se servir des minorités ethniques pour déstabiliser des États souverains.
Déjà au XIXe siècle, quand la Russie voulait établir son contrôle sur le Caucase et ouvrir un chemin vers le Moyen-Orient, elle avait justifié son avancée par la défense des Arméniens et de certaines populations chrétiennes au sein de l’Empire ottoman. C’est un argument qui a été aussi beaucoup employé pour justifier l’intervention de l’armée russe aux côtés de Bachar al-Assad. Mais c’est à l’époque soviétique que la technique a été raffinée.
L’URSS avait effectivement une politique de reconnaissance des minorités ethniques. Était-ce une manière de contrôler son territoire ?
Tout à fait. Moscou voulait conserver un levier sur des républiques trop rebelles et les affaiblir en créant des contre-pouvoirs internes. Par exemple, la Géorgie avec sa forte histoire nationaliste était vue comme un danger, et le pouvoir central soviétique a mis en place des politiques en faveur des Ossètes et des Abkhazes. De la discrimination positive, dirait-on aujourd’hui. Le petit peuple abkhaze, 80 000 habitants tout au plus, avait la garantie de conserver sa majorité au parlement local. Lui étaient aussi réservés le poste de premier secrétaire du Parti communiste local ainsi que des rôles stratégiques comme le chef du renseignement.
Au fil des décennies, les Russes ont acquis auprès de cette minorité une loyauté absolue que la chute de l’Union soviétique n’a pas effacée. À partir du début des années 2000, lorsque les Russes sont revenus en Abkhazie et en Ossétie du Sud, ils ont distribué des passeports aux représentants de ces minorités en Géorgie qui, subitement, sont devenus des citoyens russes. Comme la Russie les protège, elle a un prétexte pour intervenir si elle estime qu’ils sont menacés. C’est comme ça que la Russie a justifié la guerre avec la Géorgie en 2008.
Comment parvient-elle à donner l’impression que les minorités sous sa protection sont menacées ?
Il faut préparer le terrain idéologique. Avant la guerre de 2008, les médias russes comme Russia Today ont commencé à produire des récits selon lesquels le gouvernement géorgien serait fasciste. Il maltraiterait les minorités ossète et abkhaze et risquerait de commettre un génocide. Les télévisions gouvernementales produisent alors énormément de black PR – pour public relation –, de la « communication noire ». On y découvre que le président géorgien Mikheïl Saakashvili serait un déséquilibré mental. Puisqu’il était coutumier de discours enflammés, ils ont juxtaposé des extraits de ses prises de parole avec des images d’Adolf Hitler.
Faire de leurs ennemis des nazis pour convaincre la population de la nécessité de les combattre est un classique de la propagande russe, une référence à l’héritage de la victoire de l’URSS contre le IIIe Reich, qui inscrit la guerre contemporaine dans une histoire glorieuse. Elle tourne à plein régime en Ukraine aujourd’hui, contre Volodymyr Zelensky et l’armée ukrainienne. La menace d’un génocide a été brandie exactement de la même façon avec les populations russophones dans le Donbass.
La guerre est le meilleur moyen que Poutine ait trouvé pour justifier à la population russe la privation de ses droits politiques.
Si elle parvenait à atteindre des objectifs limités, par exemple des portions du territoire ukrainien, la Russie pourrait-elle choisir une autre voie que la guerre ?
Non, car le régime de Vladimir Poutine a besoin de ce climat d’affrontement généralisé pour se maintenir. La guerre est depuis le début le meilleur moyen qu’il ait trouvé pour justifier à la population russe la privation de ses droits politiques. Car, dit-il sans cesse, la démocratie est faible, les années Boris Eltsine et leur lot de corruption anarchique l’ont prouvé. Or, poursuit-il, la Russie est menacée de toutes parts et ne survivra que si elle est forte, c’est-à-dire autoritaire.
C’est une conviction qu’il a acquise très tôt. Dès qu’il est arrivé au pouvoir, il a envahi la Tchétchénie, en 1999. Selon lui, si la Russie a perdu la première guerre en Tchétchénie cinq ans plus tôt, c’est à cause des médias libres qui, du matin au soir, sur les chaînes privées, retransmettaient ce qui se passait véritablement sur le front. Des journalistes russes embarqués avec les forces armées indépendantistes filmaient les tueries. Toute la population voyait des dizaines de milliers de soldats russes qui mouraient et ces images ont rendu la guerre totalement impopulaire.
Lorsque Vladimir Poutine a déclenché la deuxième guerre de Tchétchénie, il a verrouillé la presse libre et couvert la guerre comme il a voulu. Il est parvenu à montrer les indépendantistes tchétchènes comme des agents de l’islamisme, du terrorisme international lui-même pantin des intérêts occidentaux. Cela a marché.
La guerre a pourtant été une incomparable boucherie puisque les Russes ont tué 150 000 personnes, sur une population de 1,2 million de Tchétchènes. Mais, grâce à la victoire militaire et aux médias sous contrôle, la guerre est devenue populaire. Poutine a trouvé la justification de son autorité : « Sans moi, vous perdrez des guerres. » C’est pourquoi je pense que la Russie de Vladimir Poutine ne s’arrêtera pas : ce n’est pas un régime qui fait la guerre, c’est un régime qui est fait pour la guerre.