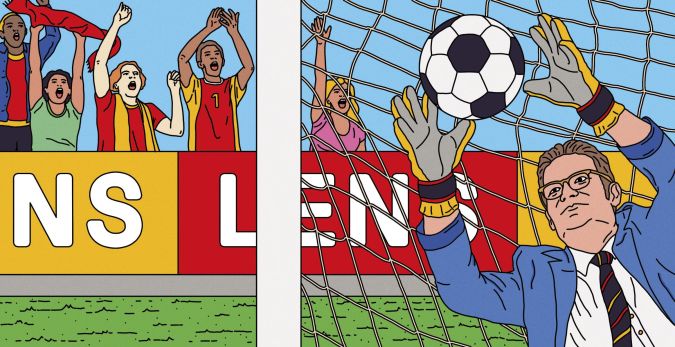Un homme lit. Enfoncé sur siège pliant, insensible au tumulte qui dérange le petit matin. « La vue d’un homme jeune et bien habillé courant comme un fou est peut-être un spectacle banal dans certaines grandes villes, mais pas à Memphis. Mitch ne passa pas inaperçu. »
Tout à l’heure, le lecteur courra lui aussi. Pour l’instant, il est penché sur un Grisham, La Firme, page 402. « Je l’ouvre à n’importe quelle page, je le connais par cœur, c’est toujours le livre que j’emporte quand je pars pour une longue course. C’est un livre de plage, pas compliqué. »
L’homme qui lit et ne court pas encore s’appelle Fred Miollany, il travaille en Suisse et attend le son d’un cor qui annoncera le départ d’une course à pied, baptisée « Chartreuse Terminorum ». Il est immobilisé au centre d’un éphémère camping planté une fois l’an. Quarante toiles vertes au creux d’une clairière égarée dans les montagnes de la Chartreuse, au-dessus de Grenoble. Son dossard est prêt, le 35. Une maxime latine est calligraphiée sous le numéro : « Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit. » Du Cicéron dans le texte : « Personne n’aime la douleur en elle-même, ne la recherche et ne la souhaite, tout simplement parce qu’il s’agit de la douleur. » Tout à l’heure, Fred emmènera Cicéron en travaux pratiques. Il sera alors temps de se poser des questions, de lire en soi après avoir lu les autres.
Moins une heure. Une casquette tournicote dans la clairière, pas loin du lecteur. Elle est siglée d’une question : « Why running? » Le « Why » est en majuscules. On pense au cercle de fer qui enserre la tête du fou soumis à l’électrochoc. Les scientifiques prétendent que courir sublime la pensée. On détaille l’homme impatient sous la casquette : boucles d’oreilles noires, tatouages tribaux, Lycra, gourdes, barres énergétiques, cartes, couverture de survie, chaussettes hautes, dossard 27. Il s’appelle Cédric Gonçalvès. Il meuble en s’interrogeant : « Ça me turlupine, l’idée de courir à l’infini… » Il ne lit pas maintenant, mais il a lu. Christopher McDougall, Born to Run (Né pour courir, dans son édition française). La bible des runners. À la recherche des Tarahumaras, le peuple de la Sierra Madre mexicaine qui court sans fatigue et sans chaussure. « Oh oui, j’aimerais bien être un Tarahumara. À part le short… » Les Tarahumaras se vêtissent de bermudas blancs et de tissus colorés, comme des acteurs de carnaval.
Cédric Gonçalvès évolue dans une drôle de géométrie. Il est carré, vit sur ce plat pays qu’est le Berry, ses aplats boisés, ses lignes droites. Il gère les cheminots qui entretiennent les voies à la SNCF. Il est très organisé. Il a installé un auvent devant sa tente. Il était de la première édition, l’année dernière : « Je n’avais jamais autant souffert. Mais au bout de six ou sept heures, la souffrance peut se transformer en plénitude… Et je sais maintenant que je suis capable de tout. » Cédric cherche, se cherche. Les nourritures terrestres. Il se repaît de porridge. S’essaie au régime « low carb » (sans glucides), aux aliments cétogènes (que du gras). Il s’interpelle. « Est-ce qu’on fait que des choses utiles ? » Pourquoi s’engager pour 300 kilomètres de hauts et de bas, 25 000 mètres de dénivelés positifs ? Pourquoi s’investir dans une épopée que personne n’a su terminer ?
Partir arracher des mots
La France court par millions, les pelotons refusent du monde, étouffent de regards obsessionnels sur la montre chrono, de désirs intenses d’enfiler la veste marquée « Finisher ». « Normalement, dans une course, la seule chose que tu ne connais pas, c’est ton classement, résume Cédric. Là, tu sais juste que tu ne vas pas finir… » Crapahuter, glisser, ramper, tomber et toujours se relever. En autonomie totale, sans balisage. S’orienter avec une carte. Jour et nuit. Un redoublant raconte le sommeil qui s’abat en plein effort, le corps qui s’affale dans les orties. Car il ne faut pas traîner : cinq tours de 60 bornes, seize heures maximum par tour. Le temps élimine, assassine. La Chartreuse Terminorum est une torture volontaire. Cédric sait l’inéluctable. Il subira le cérémonial officiel, à l’heure du renoncement. Les notes lugubres de la sonnerie aux morts.
Ils sont quarante, choisis par les organisateurs après une étrange sélection. Dans une lettre de motivation en forme de court essai, chacun a dû répondre à une question fondamentale : « Pourquoi devrais-je être retenu pour participer à la Chartreuse Terminorum ? » La plupart ont gardé leurs mots secrets, bout de psychanalyse qui n’appartient qu’à l’intime. Les plus confiants me montreront leur lettre. Cédric a écrit ceci : « J’étais du genre nul en sport. La course est entrée dans ma vie. […] Rien n’a été facile et rien ne le sera jamais […] Je me sens libre en montagne, libre mais humble. J’aime courir seul. J’aime être responsable de mes choix, j’aime être autonome. Je veux savoir ce que j’ai au fond de moi !!! »
En autonomie totale, sans balisage. S’orienter avec une carte. Jour et nuit. Cinq tours de 60 bornes, seize heures maximum par tour. Le temps élimine, assassine. C’est une torture volontaire.
Ils se sont interrogés. Souvent au tréfonds. « Il n’y a que les mots qui rendent la vie supportable », glisse Bruno Poirier, dossard 79. Parler, lire, écrire. Ils partent arracher des mots, ça ne peut pas être bénin. Ils devront trouver des livres disséminés sur le parcours, preuves de leurs passages. Chacun sa page. Ils devront dénicher dix-sept livres et en déchirer un bout comme on ajoute une page à sa propre vie. Le dossard 79 rassemblera les pages 79, etc. Ceux de la première fois ont souvent conservé les pages. Encadrées ou rangées sous plastique.
Fred, le lecteur serein de Grisham, en a prélevé une pour son essai. Comme un acte sacrificiel. Il a réinterprété les dialogues d’un passage de Voyage en Transylvanie, de Dawn Stewardson. Extrait de son offrande de papier : « On me demande si je suis fier de moi, la réponse est NON. Le sanglier est fâché et un sanglier fâché est un sanglier qui revient. » Laurent Guéraud, lui, glanera les pages 29, et ça lui fait mal : « Chez moi, on n’abîme pas les livres. Mon fils ne comprend pas. Alors je lui ai promis de lui offrir un livre par page arrachée. »
Le son lugubre mais tant attendu du cor de chasse a résonné dans la clairière. Départ dans une heure. Il sera 11 h 11. Fred termine son paragraphe. Il fait presque soleil, un beau jour pour courir, s’en aller en voyage intérieur. La course et la lecture révéleraient l’homme à lui-même.
J’avais aussi fait ma lettre. Je voulais écrire que les cieux et les abysses sont inaccessibles, que la terre souffre d’une horizontalité déjà parcourue, qu’il ne reste plus que le voyage intérieur comme exploration ultime. Je n’avais pas trouvé les mots assez vite. « Le seul jour de l’année où il y a quatre chiffres identiques » est passé. Le 11/11, jour d’armistice, sonnait la date limite. Je n’ai donc pas été sélectionné. Je n’avais ni les mots ni les jambes. J’ai quand même voulu être eux. J’ai déplié ma Quechua au milieu de la clairière, préparé mon short et mes chaussures. Courir est naturel et universel. L’enfant rampe, marche puis court. Il manque une image sur la frise de l’évolution.

Première heure. Le son ténu d’une allumette craquée a lancé la course. « Lorsque le cierge s’allumera, détaille le roadbook, le livre de navigation. il ne vous restera plus que quatre-vingts heures pour parcourir cinq fois le chemin […]. Au bout de la verte esplanade, tournez à gauche… » Le premier livre est un fruit offert sur la branche basse d’un pin. Voyage dans la nuit verte, Jacques Bock. Le bouquin est corné, il a dû coûter 2 francs dans une solderie. Il intrigue.
Ils devront trouver des livres disséminés sur le parcours, preuves de leurs passages. Chacun sa page. Ils devront en déchirer un bout comme on ajoute une page à sa vie.
Lire les autres, lire en soi. La course n’attend pas. Un homme en catogan a oublié de déchirer sa page. La 79. Bruno Poirier fait demi-tour. Il chérit les mots, il est parfois journaliste, plus souvent encore perché au Népal, dans l’Himalaya. Il ne revendiquait pas une place au départ. Son essai s’immergeait dans la philo : « J’aime beaucoup Nietzsche qui a dit : “Seule la grande douleur libère vraiment l’esprit, car elle nous enseigne le grand doute… J’ignore si une telle douleur nous améliore mais je sais qu’elle nous rend plus profond” […] Beaucoup de gens parlent du phénomène de lâcher-prise dans l’effort, un terme bouddhiste. Le lâcher-prise peut conduire à l’illumination. Il m’est arrivé de l’atteindre dans l’effort physique. C’est ce que je recherche […]. C’est pour ça que j’envoie ma lettre de non-candidature à ma non-participation. »
J’ai suivi les coureurs, en serre-file, à l’écoute, en silence. J’ai suivi dans le souffle rauque de l’effort. Je me suis immiscé dans le qu’est-ce-que-je-fous-là collectif. J’ai doublé le dernier, un peu promeneur, chapeau de cow-boy sur la tête, qui bientôt s’égarera 30 kilomètres trop au nord.
Apprécier sa propre solitude
Deuxième heure. J’ai rejoint Sophie, dossard 1. Le 1 est attribué à celui qui est promis à un bref chemin. Sophie progresse. De temps en temps, brutalement, elle stoppe, figée, alignée comme les pins, mains sur les hanches, entre fatigue et indécision. Les bifurcations se ressemblent, les arbres se ressemblent. Très haut s’étire le filet blanc d’un avion qui sait où il atterrira. La forêt enserre l’homme. Les chemins n’en sont plus. L’histoire les a effacés ou mélangés. Les animaux ont d’autres logiques. C’est leur terrain. Il faut penser comme eux. Avancer, chercher.
Derrière un tronc, un homme éructe sur une couverture. Le deuxième livre. Chasses à l’homme par Christophe Guillaumot, prix du Quai des Orfèvres. Il pend à un fil. Une phrase au hasard : « Il avait l’habitude de gérer les fous, il n’avait jamais tenté de leur refaire prendre pied dans la réalité. » Les livres disséminés tout au long du parcours sont des récompenses, des digressions propices à l’introspection.
Troisième heure. Monter, longtemps. Basculer. Descendre n’est pas une récompense. Rester dans le tempo, ne pas choir en solitude. Essayer de profiter du paysage, mais revenir à ses pieds, éviter les racines, ne pas glisser. Et puis merde : tenter de couper les vertigineux lacets en dévalant sur les fesses. Mauvais calcul. Une chapelle, enfin, soudain. Un panneau : « Profitez de ce lieu pour apprécier votre propre solitude. » Le livre 3 attend un virage plus haut. Sur la couverture, un homme sur un prie-Dieu. Un pèlerin parmi les autres, de J.-M. Fumet. Manque déjà trente-huit pages. Je feuillette. « S’il réfléchit, s’il en a la force, il se dit qu’il a péché, il faut qu’il expie, il accepte de souffrir, bel exemple de courage… » Le sentier, là-bas, large, usité, qui descend encore, est une trop belle invitation à qui ne s’est rien promis. J’arrête. Je coupe. Déjà vaincu.
Sixième heure. L’usine est désaffectée. Parfois l’homme rate. La course traverse la cour. Derrière le portail cadenassé, une mère en imperméable et parapluie bleu nuit regarde dévaler son fils. « Pourquoi il s’inflige ça ? Pour exister ? Pour nous plaire ? Il court tout le temps, il mange des plâtrées de pâtes et de riz. Ils sont tous célibataires, non ? » Non, pas forcément. Le ciel dégorge, le torrent rue. Ils vont maintenant monter encore et encore. 1 200 mètres de dénivelé continu. Que la montagne est haute.
Septième heure. La nuit s’est emparée de la forêt. L’orage s’est invité. Biblique. La Chartreuse est parsemée de monastères et d’oratoires. Bruno, en quête d’illuminations, est dardé par les éclairs. « N’oubliez pas le livre 7 dans une souche à 25 mètres à droite du petit col », indique le roadbook. Le livre 7 n’est pas un évangile. Au mauvais endroit, au mauvais moment, par Aurore Bruno, collection « Nous deux suspense ». La quatrième de couv raconte Suzanne, coiffeuse, prise dans-un-tourbillon-qui-pourrait-changer-sa-vie. Il se planque où, ce putain de bouquin ? Il y a trente souches, quarante souches, cinquante souches. Grappiller des secondes à la douleur de ses muscles. Décrypter la carte sous la frontale, la pluie, sous le ciel bruyant et énervé. Compter et surtout écouter. Comprendre que l’éclair et le tonnerre font fusion. Et tout d’un coup, jeter ses bâtons métalliques. « J’étais les bras en croix sur le sol, contera Bruno, j’avais une main mouillée, j’ai senti l’électricité passer dedans. »
Un article vous donne envie de partager un témoignage, une précision ou une information sur le sujet ? Vous voulez nous soumettre une histoire ? Écrivez-nous.
Sophie Guidal, le dossard 1, essaie de se faire petite, elle disparaît en elle-même. Sous l’orage, elle se replie en position fœtale, rétrécit. Véronique Forget, dossard 13, l’autre femme, mise sur le petit poussin en plastique serré contre son cœur. Véro n’avait rien demandé. C’est son amoureux qui l’a inscrite. Véro avait instantanément ouvert son ordi et, en un quart d’heure de sincérité, avait livré son essai : « Malgré mes 29 petites années sur le monde, j’ai l’envie indéchiffrable de me poster sur cette ligne de départ […]. Parce que je veux faire cette course ni pour la gloire ni pour mon voisin. Parce que je veux affronter mes peurs, apprivoiser la faim et la soif, défier mon mental, narguer les difficultés, et rentrer dans un monde parallèle. Parce que je ne sais pas ce que me réserve demain et qu’il faut vivre tant qu’on peut. » Elle ajoutera : « Peut-être qu’il nous manque une ou deux lumières dans les étages. » Peut-être qu’elle a beaucoup d’étages.
Pas de médaille ni d’arche d’honneur
Bruno Poirier, l’homme au catogan, qui se présente comme le « chevalier du vent » a échappé à la foudre, mais sera terrassé par la pluie, la boue, le noir, la fatigue. Le programme prévoit trois nuits. Bruno, dossard 79, n’a pas vaincu la première. Il renonce avant le livre 9, Les Désorientés, d’Amin Maalouf, sans avoir frayé avec ses amis Nietzsche et Bouddha. « J’étais venu pour souffrir, j’en avais besoin… Je n’ai pas pu, je n’ai pas eu le temps. » La Chartreuse est une course intérieure où il faut maîtriser l’extérieur. « Un moment, j’ai eu des hallucinations, je n’étais plus dans le réel. » Revenu à la clairière, il retrouve sa tente tendue par des fils où flottent des drapeaux tibétains. Il repartira bientôt « sur l’échine de l’Himalaya » courir plus près du ciel encore.
Des absents, des inaptes peut-être, des ineptes pourquoi pas, castagnent la Chartreuse Terminorum, parce qu’elle ne promet pas une arche d’honneur ni une médaille dorée. L’époque admet mal l’échec apparent. Cette course sans fin regarde les hommes tomber. Mais grandir. Voir plus loin. J’avais échangé, sans plus, la veille, avec Peter Comoglio, dossard 45. « Ma mentalité, c’est de toujours finir les choses, même si je dois ramper… C’est ancré dans la famille, aller au bout. Mon père était commando para. C’est une façon de vivre. Je suis de la plaine, de Bourgogne, mais je me suis engagé dans les chasseurs alpins à 17 ans. Qu’est-ce que j’ai encaissé comme douleur ! C’est en moi, je ne me force pas à me faire mal, c’est une façon de vivre. » Juste avant le départ, une question de politesse lui avait soudain tiré un flot de larmes d’adulte. J’étais gêné, j’ai gardé les yeux sur mon carnet. « Je pense beaucoup à mon petit frère qui nous a quittés le 2 mai, il était malade. Je ne sais pas ce qui m’attend là, mais il va m’aider. Je vais m’en vouloir si je ne me fais pas mal. » Peter a souffert mais ses adducteurs, trop tôt, lui ont sifflé la fin du jeu.
Treizième heure. Les illusions ne durent parfois qu’un bout de nuit. Frédéric Aragon, dossard 47, a lui aussi flanché précocement. « J’ai ramassé, ramassé, ramassé, je ne voyais plus, j’étais tout le temps par terre. » Il est entré dans la nuit sans en sortir. Ça lui va bien, il est d’abord spéléo. « Je ne me sens bien que dessous, je suis tranquille, j’aime aller où personne n’a mis les pieds. J’aime être dans l’eau, dans les siphons. » Un jour, l’intrépide insouciant s’est retrouvé coincé par une crue. Quarante-cinq heures. « J’avais 15 ans. Tout le monde nous a cru morts. L’eau est descendue, fallait avancer pour s’en sortir, je ne pouvais pas, je m’endormais tous les dix mètres, mes copains me réveillaient, on était dans un état bizarre. C’était tragique mais c’était bien. Depuis je cherche à retrouver ces sensations. Il ne faut pas juger. » Huit fois, Fred a passé le concours de pompier pro. « C’est la dictée qui va pas. » Il est resté pompier amateur. Il gagne le minimum comme éducateur d’enfants handicapés. Fred Aragon a du mal avec l’orthographe, mais il a réussi une courte lettre qui se terminait en latin : « In Manus Tuas. » Entre tes mains. « Je veux aller jusqu’au moment où je vais prendre la décision de renoncer, de dire oui ou non. » Il a pu dire non.
Changer au moins les chaussures
Bertrand Lellouche, dossard 33, manie les chiffres en expert. Il est directeur financier de start-up qui inventent les médocs de l’avenir. Il arbore un t-shirt floqué « Oublie que t’as aucune chance, fonce. » J’avais joggé, un mois plus tôt, avec Bertrand à Paris dans le parc de Saint-Cloud. « Je cours pour ralentir, m’avait-il annoncé, on ne s’arrête jamais avec nos vies de fous. » À l’entame de la première grimpette, il avait choisi de marcher. On avait parlé déconnexion, d’ouverture des sens, de sa détestation initiale du footing, de sa femme, adepte de médecine chinoise, qui ne consent à le laisser partir qu’à condition qu’il soit en forme, et qui lit ça sur sa langue. Et puis, en passant devant des statues de muses, il avait évoqué les deux préceptes gravés sur le temple de Delphes et attribués à Socrate. Colonne de droite : « Connais-toi toi-même. » Colonne de gauche : « Rien de trop. »
Bertrand a été le premier à me confier son essai. Extrait : « Plus d’une fois, j’ai pensé atteindre mes limites. Je pourrais en parler des heures, y compris de ces apprentissages sur moi-même, de cet équilibre, de cette façon animale de vivre avec la nature… Mais comme dans ma vie professionnelle, j’ai simplement un sens aigu des défis, un goût avéré pour l’aventure. La facilité ne m’intéresse pas et j’adore relever des missions impossibles […] La seule chose qui me motive est de découvrir, me surpasser et me surprendre… même si je suis hautement conscient des difficultés qui m’attendent. » Bertrand pointera trop tard pour avoir droit à l’introspection supplémentaire d’un second tour. Comme l’année d’avant. « Est-ce qu’il faut se résigner ? Est-ce que c’est important ? »
Quatorzième heure. Une nuit peinte par Soulages accueille les finishers de cette première nuit, lampe frontale en position, lucioles sortant d’un ailleurs. Ils touchent une grosse pierre, valident leur premier tour. Mais même l’arrivée victorieuse dans la clairière après les premiers 60 kilomètres est une épreuve. Le retour à la raison, à la tentation. Le fumet des saucisses locales. L’appel du confort. La tente et son matelas. Le temps du ravitaillement est pris sur la course. Manger. Féculents, spiruline, jus de betterave. Se doucher peut-être. « Je vais me laver le cul dans la rivière », lâche l’un. Se soigner. Arnica, doxy, nox. Changer au moins les chaussures. Délacer et voir ses pieds déjà parcheminés, contempler l’entame inexorable de sa propre déchéance.
Même l’arrivée victorieuse dans la clairière après les premiers 60 kilomètres est une épreuve. Le retour à la raison, à la tentation. Le fumet des saucisses locales. L’appel du confort.
Benoît Bachelet a toujours fait don de son corps. Il était un Brûleur de loups. C’est ainsi qu’on baptise les hockeyeurs du prestigieux club de Grenoble. Il était aussi un pilier de l’équipe de France. Un combattant. Calme, posé, réfléchi, en civil. Pugnace, roué, implacable en maillot. Il s’est élevé au rang de magistrat, il explique parfois aux mômes des quartiers tendus que la bagarre, il connaît. Se bagarrer avec les autres, se bagarrer avec soi-même. « Quand tu es pro, que tu partages le même langage avec vingt équipiers, qu’il y a du répondant en face, ça fait vite des étincelles. Tu es capable d’aller loin dans la douleur et la connerie, de mettre la tête là où ça fait mal, là où tu risques beaucoup. »
Benoît chemine avec son frère Romain, ancien hockeyeur pro aussi. Ils passent le cap du premier tour. Benoît portait le maillot 46 aux Brûleurs de loups. Sur les pentes de la Chartreuse, il crapahute avec le dossard 67 : « Je pars de zéro. Je viens d’un sport qui développe des qualités aux antipodes de ce qu’il faut en trail. Je sais que je n’ai aucune chance. J’essaie d’aller le plus loin. » Il sait qu’il n’ira jamais aussi loin qu’au hockey.

« Il se passe quelque chose de brut, ici »
Quinzième heure. Ils sont plusieurs à être passés dans les temps, mais à en avoir assez. Quatre renonceront à leur droit au deuxième tour. Le « connais-toi » du temple de Delphes ? Jean-David Javegny, dossard 69, est dans le secret des corps. Il est kiné. Il connaît aussi les âmes. Les propriétaires de corps meurtris échangent beaucoup avec les kinés. Il a pointé en septième position. « Pourquoi me mettre en danger ? Parfois, le courage c’est dire qu’on en a assez. » C’est un non, non négociable avec lui-même. Jean-David a la peau mate, le débit posé, l’élégance d’un seigneur. Il a complété le chemin de Compostelle. Il a tenté un bout du chemin de la Chartreuse.
« Il se passe quelque chose de brut, ici, qui remet l’homme dans son contexte. On s’inflige une violence pour se rencontrer… C’est beau, l’inaccessible, c’est comme quand on convoite une femme et qu’il y a concurrence. Tenter, essayer, ces verbes amènent à la non-réussite. Faut dire : je fais. On met du temps à devenir l’être qu’on désire être… » Son essai annonçait une communion solennelle : « Sentir le sol sous mes semelles, les aspérités du terrain et toutes les irradiations musculaires induites par la pose des pieds, apprécier ou détester toutes les sensations qu’une course, une randonnée, une nage ou une escalade peuvent procurer, mais avoir l’intime conviction que l’action est pourvoyeuse d’émotions et d’introspection. […] Il y a un temps pour tout, un temps pour chacun d’entre nous de s’inscrire dans un projet totalement irrationnel et irréalisable. C’est parce que c’est impossible que nous nous acharnons à le réaliser. »
Seizième heure. Au creux de la nuit, le 57, Mickaël Berthon, et le 35, Fred Miollany, le lecteur, oscillent vers l’abandon. C’est si bon de s’arrêter. Il leur reste moins d’une demi-heure pour changer d’avis, pour se refaire un sac et un moral. Ils sont presque côte contre côte dans une nuit carcérale nimbée de quelques halos. Leurs entourages exhument des arguments, tonitruants ou subtils. Les phrases s’entremêlent. Celles d’un dialogue, d’abord :
Mickaël, mezzo voce : « Ça sert à rien. »
Sa sœur, contralto : « T’es trop fort, continue. Tu m’avais dit que si tu parlais comme ça, fallait que je t’engueule.
— C’est pas toi qui en viens.
— Allez hop tu mets des chaussures propres.
— Fais voir la carte au cas où. »
À côté, un léger monologue.
Fred, voix étale : « Ça fait sept heures que je suis sans lumière, j’ai des jambes de feu mais le reste ne fonctionne plus très bien… Rien ne me fait envie… Je veux juste me reposer. » Sa femme, douce, présente sans l’être, opte pour le silence. « Je le pratique tous les jours, le mieux est de ne rien lui suggérer. » La bruyante incantation et la douce autosuggestion voisinent. Mickaël et Fred repartiront, ensemble. C’est ainsi que les hommes ne meurent pas. Ils étaient quarante. Ils sont encore onze.
Vingt-deuxième heure. Fred gagnera un lever de soleil, là-bas, là-haut. Il a vainement essayé de nous le dépeindre, assis à nouveau dans son pliant, en picorant des cerises. C’était pas aussi beau, c’était en noir et blanc, comme si cette aube n’avait été que pour lui. S’il avait persévéré, un peu plus loin, un autre Grisham l’attendait sur son chemin, Le Testament. Mais l’heure était à lire en lui. Je l’ai écouté : « J’aime bien quand tu n’es plus lucide et que tu bascules dans le mysticisme. J’aime ces zones inconnues. Le ticket d’entrée est élevé, mais c’est chouette, primal. Tu parles à tes organes. Ça appelle à des schémas qu’on ne peut pas comprendre. » Fred Miollany est cadre informatique pour le canton de Genève. Grosse pression. Objectif zéro faute. Seule l’erreur se voit. « On est beaucoup sur ce type de course à avoir des jobs très prenants, il nous faut en face un loisir qui puisse occuper autant l’espace, nous équilibrer. » Fred pense, s’évade, cherche, passe d’un sujet à un autre. « Dans des tas de courses, tu paies, cher, ton inscription, pour être un des objets du spectacle. Ici, c’est 3 euros, un centime du kilomètre, ce n’est pas toi qui choisis si tu es au départ, il n’y a pas un seul spectateur. » Ou alors des fantômes : « Des fois, j’ai des hallucinations et je vois mon fils, assis, sur des marches, qui me regarde. » Il rentre le voir en vrai.
Dans des tas de courses, tu paies, cher, ton inscription, pour être un des objets du spectacle. Ici, c’est 3 euros, un centime du kilomètre.
Fred
Vingt-cinquième heure. Eux savaient plus que d’autres. Gaëtan Janssens, dossard 3, et Maxime Gauduin, dossard 5, ont dominé la première édition. Ou fait le moins pire. Janssens avait mêm entamé le troisième tour. Ils avaient acquis le statut de « vétérans ». À 30 piges, l’outrage du temps n’en faisant pas encore des croulants, on dira plutôt « revenants ». Gaëtan et Maxime ont montré le rythme aux novices les plus véloces, un tour durant, puis le début du suivant, avant de se résoudre, l’un puis l’autre, à l’abandon. L’an passé, Janssens était pressé de filer à un mariage, cette année Maxime Gauduin doit récupérer son petit môme. La vie a ses priorités, qui contraignent la performance.
Au monastère de Currière, sur le chemin, s’ouvre une chapelle blanche, avec des pétales de roses parsemés sur le sol. Les moniales ont aussi laissé la clé d’une cellule, au cas où, avec grenadine et viennoiseries. Ils n’y ont pas fait étape. Ils sont revenus méditer leur renoncement dans la clairière où pépient les oiseaux. Gaëtan et Maxime sont circonspects, taraudés, battus. Ils se regardent. Ils n’ont pas renoncé à trouver la solution un jour. Maxime : « On était moins fort que la course. » Gaëtan : « C’est dur de te lancer sur un truc dont tu connais déjà la pénibilité, de savoir où tu vas repasser.
— C’étaient des champs de boue.
— Est-ce que cette course est plus forte que nous aujourd’hui ou dans l’absolu ?
— Forcément on a pris un coup sur la tête… le côté “défi insoluble” ça me titille depuis un an, on avait un plan sur les cinq boucles, mais difficile d’aligner les planètes, même sur le ravitaillement, j’ai fait n’importe quoi… » Ses potes lui avaient commandé une pizza aux olives. Il déteste les olives.
Gaëtan et Maxime savaient pourquoi ils voulaient revenir. Et pourquoi ils reviendront. J’exhume leurs lettres de candidature. Ils ne souhaitent pas trop en révéler. On fera a minima. Maxime Gauduin : « Je fuis les courses où l’affluence est importante, j’ai passé bien plus de temps en montagne qu’avec un dossard […]. Je n’aime pas particulièrement me comparer aux autres. Ici, on n’est pas contre mais avec. Ce défi est insensé, il vire à l’obsession. » Gaëtan Janssens : « Je me confronte aux éléments pour me prouver que j’en fais partie […]. Le hululement du hibou en remontant le vallon sous les étoiles, la boucle des poissons bleus, le champ d’orties… […] l’authentique nature, brute et chargée d’histoire […] Je sais échouer, échouer est la seule façon d’apprendre et de s’élever. »
« Un an de repos et je repars »
Trentième heure. Ils ne sont plus que quatre là-haut dans les épicéas, les hêtres et les êtres rares, les invisibles lynx et les hypothétiques dahus, les pénibles tiques et les moines taiseux. Ils sont deux et deux. L’homme est peut-être solitaire. Dans la difficulté, il s’unit, il va souvent par paires. Et fusionne. Les cerveaux concoctent une pensée unique. Domnin Erard et David Barranger ont bouclé les deux tours en tête, en avance de deux heures. L’humour en bouclier pour dire non à l’abandon. David : « Un an de repos et je repars. » Domnin : « On vient de passer à la Fnac, on a récupéré quelques pages. » Du Marc Lévy, du Robert Louis Stevenson, du Amélie Nothomb. Ils ne s’étaient jamais vus, ils ont fait alliance. L’épreuve commande de lire le terrain, de trouver la direction, d’imprimer un rythme. C’est plus que de mettre un pied devant l’autre. Il convient de reposer parfois un peu sur le compagnon de cordée. Domnin et David sont devant ensemble et vont abandonner ensemble. C’est leur histoire, leur choix. Domnin : « J’ai la cheville en vrac, les montées ça va encore, faudrait que des montées, de toute façon on fera jamais trois tours. » David : « Ça ne sert à rien, le terrain est trop défoncé. » Ils refusent la folie et l’exubérance. Ils sont secrets, ils sont dans leur monde. Domnin laissera un numéro auquel il ne répondra jamais. Il bosserait dans le nucléaire. Internet affine la vérité : polytechnicien, ingénieur aéronautique concepteur de système de séparation d’étages.
Vite, ils se sont échappés. Personne n’est obligé de s’épancher sur le pourquoi. David, lui, décrochera. Il crèche là-haut sur une montagne, à Saint-Hilaire du Touvet, haut lieu des parapentistes, des base jumpers et des gens qui volent. Il a écrit une lettre de candidature « humble et modeste », il a « envie de toucher les limites sans mettre en danger son intégrité », il aime « cette euphorie où on a l’impression de pouvoir aligner les kilomètres sans dormir, sans manger, sans s’arrêter ».Une fois, sur un raid aventure, il a terminé inconscient, dans les vapes, perfusé, et il n’a pas aimé : « Y a moyen de se dégoûter. » Il ne tente donc pas d’aller plus loin. « Je crois qu’on avait décroché mentalement. »
Trente-deuxième heure. D’abord les pieds. Vérifier qu’ils peuvent toujours. 120 kilomètres à pied, ça use. Laurent Guéraud défait ses chaussettes et raconte l’expérience d’un trailer suédois, la plante des arpions en charpie, qui s’obstinait à faire tenir ses lambeaux ensemble en les enveloppant de bandes médicalisées. « On n’a pas encore dormi », remarque Valéry Caussarieu. Pas le temps. Ils ont pointé une demi-heure avant le délai. Le père de Valéry a fait chauffer les pâtes. « Valéry est joueur, il est redoutable au poker, il va aller jusqu’au bout. »
J’ai jamais abandonné une course. Ça me hante d’abandonner, c’est un challenge perso. J’ai provoqué dans ma lettre, dit que j’étais là pour terminer, mais je savais que c’était impossible à 99 %.
Laurent
Ils ne vont pas en rester là. Le ventre, le moral. Ils se regardent, complices, ils veulent partager encore. La nuit s’approche, la fatigue s’est installée, le parcours est souillé, ils ne se font pas d’illusions sur l’épilogue. Au moins feindre d’avoir essayé. Aller plus loin que personne, défricher, ouvrir le chemin des possibles. J’avais rencontré Valéry Caussarieu bien avant, à Paris, à l’ombre de la tour Montparnasse. J’avais failli tourner avec lui sur sa boucle secrète, autour d’une cascade dans la vallée de Chevreuse, 500 mètres de tour, 57 mètres de dénivelés où il fait, dit-il, le « hamster », où il monte et descend des heures durant pour se forger des cuisses et un cœur. J’ai gardé le point GPS. Valéry est actuaire. Boulot chronophage et chronométrique. Il calcule et étudie les risques pour un banquier qui s’est aussi fait assureur. « C’est plus gratifiant de tenter des trucs impossibles que des trucs que tu es quasiment sûr de finir, non ? » Oui, non, sans opinion. « Ce que j’aime bien là-dedans, c’est la gestion, plus il y a de facteurs, plus c’est marrant. »
Il prend des kilos, il en perd. Il revendique une appétence pour le saucisson-vin rouge. Régulièrement, il s’empare d’un projet. Il a collectionné les classiques, l’UTMB autour du Mont-Blanc, la Diagonale des fous à La Réunion, la Transpyrenea entre Le Perthus et Hendaye, la Barkley au Tennessee. Il qualifie sa lettre de motivation de « délicate et personnelle » et donc de confidentielle. Il confie seulement ceci : « Quand j’étais jeune, chaque soir, au lit, je me demandais : qu’est-ce que tu as fait de ta journée ? C’était regarder derrière mais aussi être prospectif. Avec le boulot, c’est fini, tu bosses, tu t’effondres, c’est tout. Quand je cours longtemps, je me retrouve avec moi-même, mon esprit se balade, c’est comme si je me voyais du dessus. La nature est propice à ça. »
Les nouveaux dossards sont prêts. Leur troisième. Il faut bien changer de numéros puisqu’ils ont arraché des pages correspondant aux numéros d’avant. Ils ont déjà bien dépouillé le livre 10, vers la mi-parcours, Immortelle randonnée de Jean-Christophe Rufin. Peut-être pourront-ils pousser jusque-là, et aller plus loin que ce simple paragraphe : « Quiconque marche sur le Chemin finit tôt ou tard par penser qu’il y a été condamné. Que ce soit par lui n’y change rien […]. Je commençais à percevoir en moi la présence d’un délicieux compagnon : le vide. » Valéry et Laurent se sont enfoncés entre les arbres. Les résistants repartent. Ils aiment cheminer ensemble. Valéry : « Laurent a toujours un truc intéressant à raconter. » Valéry encore : « J’aime être à une allure suffisamment confortable pour se dire des choses. » Ils se racontent quoi ? Des mots entre eux.
Envie de saucisse, de douche, de dormir
Trente-sixième heure. La nuit les a enveloppés. Un livre de plus, deux livres de plus… Laurent Guéraud est un passager des forêts. Il est vosgien. Il s’est coltiné 100 000 mètres de dénivelé pour s’affûter. « J’ai jamais abandonné une course, nous narrera-t-il, ça me hante d’abandonner, c’est un challenge perso. J’ai provoqué dans ma lettre, dit que j’étais là pour terminer, mais je savais que c’était impossible à 99 %. » Il est formateur de cadres sportifs. Là-haut sur la montagne, là-haut sous les arbres, Laurent a été traversé par un cri étrange et pénétrant. « Comme si un animal se faisait bouffer par un autre. » Là-haut… « Avec la grosse lampe qui déforme beaucoup, tous les rochers étaient des têtes, les souches cachaient des lutins, les grosses feuilles étaient des trognes de sangliers, les cailloux étaient translucides… » Alors, après leur troisième page du livre 3, après quarante heures de course, Laurent et Valéry se sont allongés sur ce qui semblait être un lit divin, une dalle de calcaire, oasis blanche au milieu du vert. « On s’est couché par terre, en se disant qu’on avait mal partout », relate Laurent. Ils ont dormi ou somnolé quelques minutes, une vingtaine, jusqu’à ce que le froid leur enjoigne de repartir. Ils ont finalement poussé jusqu’au livre 5, Tout est fatal de Stephen King qui écrit ceci : « Je fis un rêve, sans doute fut-il agréable parce que je me suis réveillé avec un grand sourire étalé sur la figure : une vraie banane de bonheur. » Ensuite ils ont trouvé du goudron et sont rentrés au camp de base, autonomes jusqu’au bout.
Quarantième heure. La voix a entonné la phrase fatidique : « Vous avez lamentablement échoué. » Le verdict est sans appel, le cérémonial appliqué. Nous sommes dix autour d’une grosse pierre qui fait office d’autel. Il est 3 heures du mat, dans une nuit sans lueur, la pierre sera philosophale plus tard. Le saxo joue sa lugubre sonnerie. « Aux morts. » Ce qui leur reste de souffle éteint le cierge. Valéry Caussarieu : « On en a bien chié mais c’était bien. » Laurent Guéraud : « Deux paires de cuisses neuves et je repars. » Envie de saucisse, de bière, de douche, envie de dormir. Pas encore envie de l’année prochaine.
Après quarante heures de course, Laurent et Valéry se sont allongés sur ce qui semblait être un lit divin, une dalle de calcaire. « On s’est couché par terre, en se disant qu’on avait mal partout. »
Plus d’heure. Le soleil a dépassé le zénith. Valéry Caussarieu hésite encore à déplanter sa minitente. C’est la dernière. Bientôt la clairière ne sera plus qu’herbe. Laurent Guéraud émerge d’un sommeil presque sans fin, il est lémurien, il semble avoir peur de secouer son corps abîmé. « Je m’étais préparé à aller beaucoup plus loin, soupire-t-il, c’est peut-être pas pour moi cette course. Si c’est faisable, ce sera par des gens qui ont un plus gros moteur que nous… » Peut-être des professionnels, des stars adulées des cimes. Mais les coureurs sponsorisés prendraient-ils le risque d’être battus par la nature ? Lui aura défriché un bon bout du chemin. Je lui propose d’oser se regarder dans une petite glace. « Je suis gonflé, j’ai un peu de cernes. Je sais aussi que demain j’aurai des boutons partout, je réagis comme ça, c’est le contrecoup. » Il a les yeux qui semblent vouloir quitter son corps, comme s’ils en avaient assez vu, les ongles gris-jaune. « Ma femme me dit toujours de mettre de la crème, je le fais pour lui faire plaisir, ça sert pas à grand-chose. » Le voilà au pied de sa croix, martyrisé. « Tout va bien dans ma vie. J’ai une famille, des amis, un boulot qui m’éclate, mais j’ai besoin de ce type de challenge, des émotions qui vont avec. » On doit être un samedi, reprise du quotidien lundi.
Heures d’après. Fred, Cédric, Véro, Jean-David, Bruno, Gaëtan, Laurent… Ces quarante-là sont allés au bout d’eux-mêmes, pas de la course. Il faudra d’autres jambes, d’autres tronches pour aller plus loin. J’ouvre le porte-document où je conserve une demi-douzaine de lettres arrachées à des candidats recalés. Glenn Kasper, alias Glenn Dell, se camoufle sous un nom de fantôme. Kasper était son nom de code dans l’aviation américaine. J’étais chargé de lui trouver un toubib pour le certif médical obligatoire. De Californie, il a écrit ceci : « Quand on est capable de poser un jet sur un porte-avion au plus loin des océans, au plus profond des nuits, on est capable de beaucoup de choses… » Et puis il y a les pages de Phil Bert. Il voulait tellement être choisi. Il avait étalé cœur et tripes. « Je veux me sortir d’une pression qui mise tout sur la réussite et surtout à tout prix. Je veux me confronter à ce mur qui t’oblige à capituler car à un moment donné face à la mort faudra, même si on se bat, abdiquer sur quelque chose. Je pense que cette course est le renoncement des acquis, du lâcher-prise vers autre chose et je veux savoir l’autre chose, cette magique inconnue. »
Why running? Pourquoi courir ? Phil Bert a peut-être été recalé parce qu’il savait. La Chartreuse Terminorum apprend-elle à renoncer aujourd’hui, à mourir demain ? Si les plus solides avaient insisté cinq tours, ils auraient atteint dimanche. Sous les murs du monastère de Currière, vers le livre 10, ils auraient croisé les moines dans leur escapade hebdomadaire,délivrés du silence. Coureurs et religieux auraient pu se rapprocher de la vérité. La plupart des moines marchent, certains courent aussi. En soutane blanche et sandales.