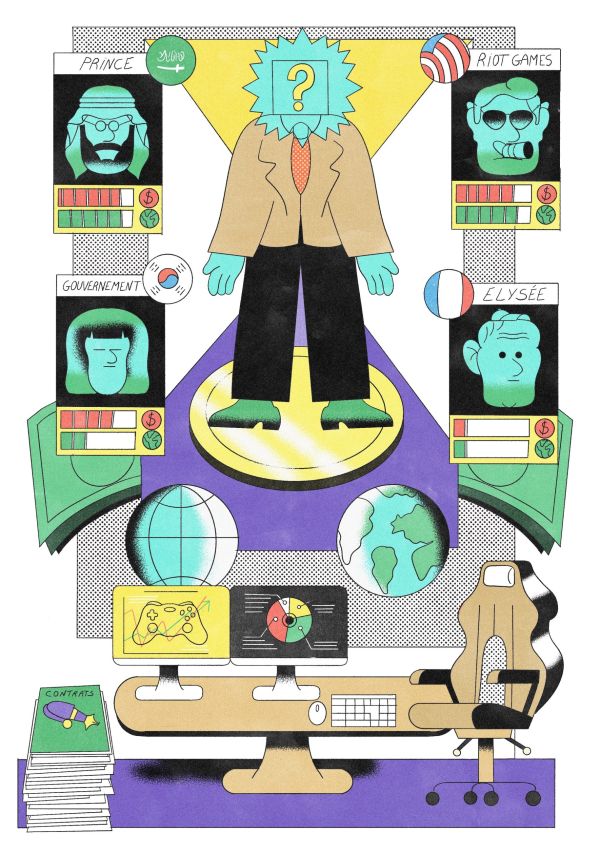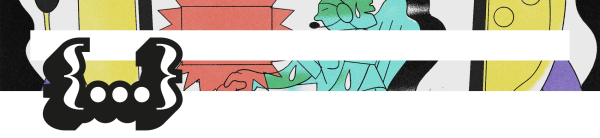« Tu es sûre que ça ne va pas la perturber ? » Juste avant de déposer son dossier en vue d’un changement de patronyme au service de l’état civil, c’est à notre fille aînée que Manu a pensé. Pour troquer le nom du père pour celui de la mère, il fallait jusqu’alors adresser une requête motivée au garde des Sceaux, replonger dans le passé, remuer des souvenirs enfouis et prendre le risque qu’à la fin celle-ci soit rejetée. L’an dernier, au détour d’un article auquel je travaillais sur la construction de la figure du père dans l’histoire, j’ai découvert l’existence d’une loi promulguée début mars 2022, entrée en vigueur au 1er juillet suivant, destinée à simplifier la démarche.
Désormais, nul besoin de se lancer dans d’interminables procédures ni de se justifier. Une simple demande en mairie suffit. Pour mon compagnon, qui sera bientôt délesté du poids de cet héritage paternel, c’est l’aboutissement d’un long cheminement… et de dix ans d’analyse ! Mais cette décision a des ramifications qui le dépassent, c’est aussi une affaire de famille qui concerne nos deux filles. Pas facile d’apprivoiser un nouveau nom, a fortiori quand on vient d’apprendre à écrire l’ancien, lequel avait l’avantage d’être court. Cinq lettres au lieu des onze que la plus jeune s’est entraînée à former pendant les vacances de la Toussaint, griffonnant frénétiquement des cœurs de toutes les couleurs sur ses brouillons. Elle n’avait aucune envie d’en changer jusqu’à ce que son père lui confie ses motivations. « Je veux prendre le nom de ma maman parce qu’elle n’a fait de mal à personne », lui explique-t-il calmement à la table du petit déjeuner.
Un « crime de propriétaire »
Une question nous taraude cependant. Pour nos enfants, qu’est-ce qui sera le plus encombrant : porter le nom d’un meurtrier ou celui d’une morte ? S’inscrire dans le sillage d’un auteur de féminicide ou faire vivre la mémoire de sa victime ? Le 20 mai 1983, G. a tué Michèle ainsi que l’homme avec qui elle s’apprêtait à refaire sa vie. Elle avait 35 ans, lui, 44. Le crime s’est déroulé autour de minuit dans le cabinet de ce père médecin de campagne, fasciné par les films de gangsters, qui ne se déplaçait jamais sans un 357 Magnum dans la boîte à gants de sa Samba quand il sillonnait les routes bordées de vignobles pour ses visites à domicile.
Il leur avait donné rendez-vous, prétendant vouloir mettre au point les termes du divorce. Un guet-apens savamment prémédité. La tante de Manu raconte qu’il avait embauché un détective privé, posé des micros dans les téléphones du domicile conjugal. Jusqu’à cesser de travailler les semaines précédentes pour prendre lui-même le couple en filature – extorquant des chèques à des patients crédules qui lui permettaient de maintenir à flot son compte en banque. Les notes retrouvées dans son véhicule prouvent qu’il a épié les faits et gestes de Michèle et son compagnon, avant de les abattre à l’aide d’un fusil à pompe calibre 12 emprunté à un patient.
G. a procédé avec méthode : il a entraîné ses victimes dans deux pièces différentes, lui dans le cabinet de radiologie qu’on a retrouvé fermé à clé et elle dans la bibliothèque. C’est la secrétaire qui, en arrivant au travail tôt le matin, a découvert le cadavre de Michèle. Les bouteilles vides d’essence de térébenthine et les traces noires sur la moquette laissent supposer qu’il a tenté d’y mettre le feu. Pour réduire le corps de sa femme en cendres ?

C’est son portrait à lui qui figure au centre de l’article que le journal Sud-Ouest Dimanche consacre au « drame » deux jours plus tard. Et c’est par l’explication du geste de ce médecin, « apprécié de tous » indique la légende de la photo, que le journaliste amorce son papier : « La perspective d’une séparation insupportable, une part de jalousie, des nerfs fatigués par une activité professionnelle intense »… Puis, un « moment de folie ». Des mots qui disculpent, se concentrent sur sa souffrance, le transforment en victime auréolée du romantisme d’un crime que l’article fait passer pour un acte d’amour. Des mots qui, en fin de compte, ne parlent que de G., que mon compagnon a choisi d’identifier par l’initiale de son prénom pour qu’il cesse d’occuper tout l’espace et pour redonner ainsi une place à Michèle, désensevelir sa mémoire, la faire revivre un peu.
En essayant de raconter son histoire, rendre son humanité à cette femme. Car d’elle, il ne reste rien à part quelques photos souvenirs, Michèle à la plage, Michèle à la montagne, Michèle au Maroc, deux ou trois cahiers d’exercices de dactylo et de physique-chimie, ainsi que son acte de décès en ligne parmi une liste de 22 autres, survenus la même année dans la commune. « La plupart des femmes victimes de féminicides sont des inconnues, des femmes banales, perdues dans l’anonymat du temps, du lieu, du fait divers vite parcouru et aussitôt oublié. Des prénoms parfois, un âge dans l’entrefilet d’une brève, la circonstance du meurtre relatée au conditionnel », écrivent deux historiens, Lydie Bodiou et Frédéric Chauvaud, dans Les crimes passionnels n’existent pas (éd. D’une rive à l’autre, 2021).
Les hommes tuent les femmes qui veulent partir parce qu’ils considèrent celles-ci comme des objets leur appartenant qu’ils ont le droit de contrôler, de surveiller et de punir.
Christelle Taraud, historienne
Un récent bilan du ministère de l’Intérieur comptabilise 118 femmes mortes sous les coups de leur (ex-)conjoint en 2022. Une tous les trois jours. « Ces mêmes statistiques montrent, de surcroît, que le moment le plus dangereux pour une victime de féminicide est souvent celui où elle se sépare du partenaire violent », relève l’historienne Christelle Taraud qui a dirigé un ouvrage collectif intitulé Féminicides, Une histoire mondiale (éd. La Découverte, 2022). « Les hommes tuent les femmes qui veulent partir parce qu’ils considèrent celles-ci comme des objets leur appartenant qu’ils ont le droit de contrôler, de surveiller et de punir », poursuit la chercheuse. En cela, il s’agit d’un « crime de propriétaire », pour reprendre l’expression de l’historienne féministe italienne Silvia Federici (Une guerre mondiale contre les femmes, éd. La Fabrique, 2021). On est bien loin du mythe du « crime passionnel » à la française forgé par la presse à la fin du XIXe siècle.
L’humiliation et la ceinture
Dans le cas qui nous intéresse, cette domination masculine prend place dans une histoire familiale de la violence qui recoupe un passé de domination coloniale. Fils de pied-noir, G. est lui-même né à Alger à la fin des années 1930. Son père était un Corrézien d’extraction pauvre, devenu militaire de profession au sein de l’armée française, qui revendiquera bien des années après, lors des repas de famille, les tortures infligées aux fellaghas. Sa mère, une femme violente et froide originaire d’Alsace, d’où sont partis au XIXe siècle les premiers colons à avoir émigré dans ce pays du Maghreb. Déterminé à défendre jusqu’au bout l’Algérie française, G. s’engage dans l’OAS (Organisation de l’armée secrète) au sein de la section Hussein-Dey, du nom d’une banlieue d’Alger. « Mauvaise section ! », lâche Christelle Taraud, qui précise que celle-ci était connue pour être un centre de torture.
Les pratiques de cette organisation terroriste sont documentées. Attentats aveugles, plastiquages, enlèvements, tortures, viols, ratonnades contre des Algériens… Cette matrice a certainement contribué à façonner la psyché de ce partisan non repenti qui, dix ans après la reconnaissance de l’indépendance, au moment d’officialiser la naissance de son fils, choisira de faire inscrire le prénom Raoul après celui d’Emmanuel à l’état civil, en hommage au général putschiste Raoul Salan, cofondateur de l’OAS. Il s’en est fallu de peu qu’il arrive en première position accolé au nom du père. Si Michèle n’avait pas bataillé, comme cela se raconte dans la famille de Manu, c’était la double peine !
Au quotidien, tout prétexte est bon pour traîner le garçon dans la souillarde et lui administrer une fessée déculottée à coups de ceinturon.
Comme chef de clan, G. manie l’humiliation devant les invités et la ceinture en privé. Sa violence physique se dirige en priorité vers les enfants. « Quand je l’entendais tourner la poignée de la porte d’entrée, j’étais terrorisé. Et en même temps, je faisais toutes les bêtises possibles pour attirer son attention et lui donner raison. J’étais ce qu’on appelait dans ma famille “un gamin caractériel” », se souvient aujourd’hui Manu. Au quotidien, tout prétexte est bon pour traîner le garçon dans la souillarde et lui administrer une fessée déculottée à coups de ceinturon avec tant de rage que les jours qui suivent, celui-ci ne peut s’asseoir sans grimacer. Sans compter la « laisse pour enfant » dans la rue, pour éviter qu’il s’échappe, et les claques qui pleuvent au moment du dîner. À quoi s’ajoutent de cuisantes vexations dont le père était coutumier. « Une fois, il a fait semblant de me gifler pour amuser ses invités, il a avancé sa main vers moi… avant de se recoiffer. Résultat, je me suis retrouvé contorsionné, mon bras devant mon visage pour me protéger par réflexe, ce qui a provoqué l’hilarité générale. »
Sur son épouse, il exerce une emprise psychologique qui se nourrit de leur différence d’âge et de position sociale. Michèle n’a pas le baccalauréat, juste un diplôme de secrétariat. Elle prépare une capacité en droit, laquelle donne la possibilité aux non-bacheliers de s’inscrire dans l’enseignement supérieur, quand elle rencontre cet homme dans une fête d’étudiants en médecine. Elle interrompt ses études avant même de les avoir vraiment commencées, il termine les siennes. Pour l’adolescente de 17 ans, le mariage est une porte de sortie. La promesse de s’extraire d’un foyer malheureux où la colère du père le dispute au ressentiment de la mère. « Son but, c’était de quitter la maison. Elle s’est très vite fiancée, complètement euphorique à l’idée d’épouser un médecin. Ça répondait chez elle à un rêve d’ascension sociale, mais quand on observe ses photos de fiançailles, je ne sais pas si tu as remarqué, elle est d’une tristesse infinie », observe la tante de Manu.
Elle est belle et se tait
L’union à l’église en robe blanche, la naissance du premier enfant à 20 ans en 1968, l’achat de la maison dans un bourg de province près des futurs grands-parents, puis la venue du fils. Les événements s’enchaînent sans qu’elle ait le temps de se poser de questions, si bien que peu à peu, Michèle se laisse enfermer dans ce statut de femme au foyer qui est la norme autour d’eux. Il rapporte l’argent, elle tient la maison. « Je reprochais à ma sœur de jouer les bourgeoises. Au début, elle était grisée par ce rôle, mais au fond, c’était surtout une gamine, elle était tellement jeune ! »
Le mercredi, elle prend la poudre d’escampette, en route vers la métropole bordelaise, pour emmener Manu à ses séances de rééducation chez l’orthopédiste. Elle en profite pour faire des emplettes, aller chez le coiffeur et déjeuner en tête-à-tête avec son fils dans un restaurant gastronomique de la ville. Les clichés de Michèle gardent la trace de son sourire solaire, de ses pommettes saillantes, de son élégance… Elle est belle et se tait. Quand, pour se donner une contenance devant les notables du coin, il lui arrive d’arranger la réalité, ça ne pardonne pas. Un jour qu’elle prétend avoir obtenu le baccalauréat lors d’un dîner entre voisins, G. démasque l’imposture et la voilà qui se retrouve rouge de honte, à essayer de cacher ses larmes.
Cet homme aux mâchoires serrées, dont la colère pouvait éclater à n’importe quel moment, d’une violence extrême et quasi permanente dans l’intimité, aurait été dans sa vie publique un médecin apprécié de certains patients, à en croire le message d’une ancienne camarade de classe de Manu reçu par l’intermédiaire du site internet Copains d’avant. Atteinte d’une malformation congénitale à l’origine d’un handicap moteur nécessitant des soins réguliers, celle-ci lui confiait combien son « docteur » avait compté pour elle. Jointe au téléphone, elle confirme : « Il était à l’écoute, toujours de bon conseil, très compétent dans son métier. »
À une époque où l’omerta régnait sur les crimes d’inceste, il était intervenu auprès de l’un des instituteurs de la petite ville dans laquelle il habitait, lorsqu’il avait appris dans le secret de son cabinet que cet homme abusait sexuellement de ses deux filles. Sans pour autant le dénoncer à la police, il lui avait intimé l’ordre de consulter un psychologue pour que ces faits inacceptables ne se reproduisent plus. Enfin, cet ancien membre d’une organisation qui avait attiré à elle une partie de l’extrême droite des années 1960 – mais comprenait déjà dans ses rangs d’ex-socialistes à côté des fascistes revendiqués – s’était mis à militer dans sa ville au sein de la section locale du PS, plusieurs années après son rapatriement d’Algérie.
C’est l’époque des affiches qu’il part coller à la nuit tombée contre l’affaire des diamants de Bokassa dans laquelle trempe Valéry Giscard d’Estaing, des discussions qui s’enveniment avec ses voisins de droite et des trajets vers leur villa balnéaire au son de Bob Marley et Otis Redding sur l’autoradio de l’Alfetta 2000 Turbo, modèle sportif d’Alfa Romeo. Ces jours-là, il bloque le compteur à 180 km/h sur l’autoroute et tient le volant avec les genoux dans les lignes droites.

Depuis que le cabinet de son mari a déménagé en centre-ville, Michèle est désœuvrée. Elle ne prend plus les patients au téléphone, ne traite plus les rendez-vous. Seule dans sa grande maison, moins indispensable auprès des enfants qui grandissent, elle rêve d’une autre vie. Alors elle tue l’ennui, devient antiquaire et sillonne à son tour les routes en fourgonnette pour récupérer du mobilier chez des particuliers. « J’adorais me rendre avec elle chez les Tonnerre, une famille de gitans qui lui revendaient des meubles. Ça fait partie des bons souvenirs que j’ai de mon enfance », se remémore Manu.
Dans sa boutique, un client, vigneron dans les environs, la courtise. Plusieurs mois passent avant qu’elle succombe à ses avances. « Elle était comme une gamine, amoureuse, elle se projetait dans sa prochaine vie, parlait même d’un nouvel enfant… », évoque la tante de Manu. À l’automne 1983, Michèle appelle sa sœur pour lui dire que ça ne va plus avec G., elle lui demande de l’héberger quelques jours à Paris où elle doit retrouver son amoureux. « Je lui ai servi de couverture. Si son mari téléphonait, il fallait que je trouve des excuses. Il a commencé à m’appeler chez moi, au travail, il me harcelait pour que je convainque ma sœur de ne pas divorcer. Il disait qu’il allait tuer tout le monde, que ce n’était pas possible qu’elle parte. »
Ne sachant pas comment annoncer à des enfants la tragédie, un collègue médecin inventa une histoire improbable : maman était morte dans un accident de voiture et papa avait disparu.
Manu, 11 ans, et sa sœur, 14 ans, sont des rescapés. Découverts le lendemain du meurtre par des policiers, en civil et pistolet au poing, ils s’étaient réfugiés dans la même chambre cette nuit-là. « Comme si ma sœur avait senti le danger, souffle mon compagnon. C’est elle qui m’a proposé qu’on dorme ensemble, ça nous a sans doute sauvés… Il aurait été plus facile de nous tuer si nous avions été dans des pièces séparées ». Ne sachant pas comment annoncer à des enfants la tragédie qui venait de se jouer, un collègue médecin inventa une histoire improbable : maman était morte dans un accident de voiture et papa avait disparu.
Il faut dire la vérité aux enfants, clamait pourtant Françoise Dolto qui s’était fait connaître grâce à ses émissions de radio sur France Inter. Il faut croire que sa voix n’avait pas porté jusqu’à ce bourg resté hermétique aux remous de Mai 68, coulant une vie respectable avec ses notables inscrits au Rotary Club, leurs maisons tapissées de papier peint et la télévision qui trônait au milieu du salon. Ce dont on ne se doutait pas, c’est que les deux enfants avaient eu le temps d’apercevoir par la fenêtre le corps inerte de leur père retrouvé pendu dans le chai au petit matin, après une nuit à remplir les cendriers de la maison. Quand « on a été réveillés par les ombres des policiers autour de nous, ma sœur a hurlé, elle a couru jusqu’à la salle de bains où elle s’est enfermée. Par les fenêtres, chacun de son côté, on a aperçu le brancard. Une main pendait. J’ai reconnu la montre à son poignet. Le confrère de mon père a mis beaucoup de temps à convaincre ma sœur d’ouvrir la porte. Elle ne parlait pas. J’ai pensé qu’elle s’était suicidée », confie Manu.
G. aurait-il fini son œuvre en achevant aussi les enfants si son arme ne s’était pas enrayée, à moins qu’il l’ait cassée, selon une autre version qui circule dans la famille ? Cette hypothèse continue aujourd’hui de hanter mon compagnon, dont l’intuition n’est pas infondée. « Il arrive que l’homme tue aussi ses enfants, et alors ce n’est pas pour ne pas partir tout seul, c’est une destruction totale qui s’apparente à un acte de vengeance supplémentaire contre sa femme », explique l’historien Frédéric Chauvaud. La vérité surgira pour Manu lors d’une balade en montagne, au cours de l’été qui a suivi la tragédie, grâce à sa tante qui lui raconte l’impensable. Celle-ci se dit encore choquée aujourd’hui par la manière dont il l’a alors interpelée : « Est-ce que papa, ce qu’il a fait, c’est héréditaire ? »
À l’époque, jeune mère de 28 ans, elle accepte de devenir sa tutrice. Accueilli dans le quartier de Belleville, à Paris, Manu y découvre un tout autre visage du pays. Le monde bruyant et cosmopolite de la rue du Faubourg-du-Temple avec ses cours d’immeuble en enfilade où les gamins côtoient les dealers qui planquent leur dope dans les failles des murs, le parc des Buttes-Chaumont et ses exhibitionnistes qu’une ribambelle de mômes du quartier font tourner en bourrique, les marches de l’église de Ménilmontant où il inhale du trichloréthylène avec les copains pour prendre le large en plein après-midi.
Avoir un fils, le cauchemar
Je me suis souvent demandé, dans mon cas personnel, comment ne pas tout reproduire, éviter de tomber dans certaines redites. Mais à cette interrogation se substitue ici une nécessité beaucoup plus radicale : rompre avec un héritage impossible à assumer, s’en défaire comme on extrairait un corps étranger, s’affranchir de toute ressemblance possible avec le pater familias, rejeter jusqu’à son nom sous peine de rester l’objet de sa domination.
Quand Manu et moi nous sommes rencontrés, j’entretenais des relations avec des petits copains aux histoires lourdes d’abandons ou de disparitions. Lasse de répéter le même schéma, je m’étais juré que le prochain aurait un père et une mère, une vie sage. Raté. Je n’avais pas eu le temps de m’attacher que Manu a tout déballé. C’était à prendre ou à laisser. Ça n’a pas suffi à me décourager ! Après, tout est allé très vite… sauf les enfants. Il n’en voulait pas. Dix ans de réflexion ont passé avant qu’il accepte l’idée, à une condition : que jamais je ne lève la main sur notre progéniture. À l’approche du terme, c’est devenu une obsession : il disait ne pas vouloir léguer son nom au bébé pour « effacer sa lignée ». Je m’en suis inquiétée, sans comprendre que cela cachait non pas le désir secret de fuir ses responsabilités, mais déjà la volonté de rompre, symboliquement, avec une histoire de la violence.
Coup de chance, nous avons donné naissance à deux filles. Une confusion entre clitoris et pénis à l’occasion d’une échographie de contrôle a semé chez Manu un vent de panique. La perspective d’avoir un fils relevait du cauchemar – probablement parce qu’être un mâle dans cette famille ne présage rien de bon. On ne sait pas où ça peut mener, ou plutôt on le sait trop bien. C’est un passeport pour la catastrophe, du grec « katastrophê » : la promesse d’un renversement tragique. De ce côté-là, Manu a bien assez à faire avec lui-même, écorché vif caché dans un grand corps costaud, déjà fort occupé à déconstruire le modèle de masculinité dévastateur que son père lui a légué.
« Comme mes Playmobil »
En sortant d’un restaurant, Manu, qui a plutôt le contact facile, avise un jour un groupe de « colleuses » qui égrainent sur les murs de la ville les prénoms de femmes assassinées. Alors qu’il s’approche pour les aborder, elles lui jettent un regard méfiant, habituées à attirer l’hostilité de certains passants, quand d’autres adoptent vis-à-vis d’elles une posture professorale. De loin, j’observe la scène. Il raconte son histoire. Elles semblent rassurées, acceptent qu’il vienne témoigner lors d’une réunion. « Si ça peut te faire du bien… », lui répète-t-on plusieurs fois au bout du fil. Il ne le fera pas. « Cette personne n’a pas saisi que ce n’était pas pour moi que je souhaitais parler. Ce qui me semblait intéressant, c’était la place d’où je m’exprimais, celle d’un homme victime, qui encore aujourd’hui a du mal à sortir de la tombe pour vivre dans la société… » Ce que Christelle Taraud analyse fort bien : « Les enfants ne sont certainement pas des victimes collatérales, cette expression me met hors de moi. Ce sont des covictimes. Quand un homme tue une femme, il tue aussi quelque chose de très profond chez ses parents, ses frères et sœurs, ses enfants… C’est un geste qui a des répercussions extrêmement pérennes sur leur existence. »
À défaut de partager son expérience, mon compagnon aurait aimé pouvoir coller une phrase en hommage à Michèle. Pour cela, il aurait fallu déroger au principe de non-mixité qui anime ce collectif. Je crois que sa demande a suscité un débat parmi les membres, mais il fut décidé de ne pas faire d’exception à la règle : aucun homme cisgenre, pas plus lui qu’un autre, ne serait autorisé à participer aux actions. « C’est dommage mais je comprends, nous, les hommes, on prend beaucoup de place… », sourit Manu. Un garçon hétérosexuel victime du patriarcat, ça ne rentre pas dans les cases, c’est un angle mort des luttes pour la reconnaissance des féminicides qui ont peut-être trop tendance à oublier l’entourage.
« Un enfant qui pose une question est prêt à entendre la réponse » : cette phrase d’une psy nous a confortés dans l’idée que le silence est toujours pire que la vérité.
Quand notre aînée a eu 2 ans, elle s’est mis en tête d’interroger son père sur ses ancêtres. « Pourquoi tes parents, ils sont morts ? » Eh bien, parce qu’on vit et puis un jour on meurt. Facile… Un peu trop. On savait qu’on l’arnaquait. Elle est revenue à la charge à 3 ans et, de guerre lasse, a changé de stratégie pour passer du « pourquoi » au « comment ». « Un enfant qui pose une question est prêt à entendre la réponse » : cette phrase prononcée par une psy nous a confortés dans l’idée que le silence est toujours pire que la vérité. Je me souviens de nous trois attablés dans le séjour, et Manu qui raconte sa mère qui veut partir et son père qui la tue « parce qu’il était fou dans sa tête », incapable d’accepter qu’elle reprenne sa liberté. L’essentiel, sans les détails. « Oui, mais comment il a fait ? » Elle veut tout savoir.
Alors il a parlé du fusil tandis que, les yeux écarquillés, elle mobilisait ses références enfantines : « Oh, comme mes Playmobil, tu veux dire ? » Encore lui fallait-il saisir la portée de l’information et, pour cela, tester la réaction de personnes extérieures. C’est comme ça que notre fille aînée s’est retrouvée à en parler au dîner devant sa meilleure copine et ses parents. Dès lors, les invitations se sont espacées, puis ont complètement cessé, sous des prétextes divers. Sans doute n’était-ce pas le seul motif, en tout cas pas le plus avouable, mais je reste persuadée que ça a joué dans l’éviction de notre fille. Mon cœur se serre encore au souvenir de ses larmes causées par un sentiment d’incompréhension et d’injustice. Sa petite sœur avait 5 ans quand elle a formulé à son tour LA question. Elle est mieux tombée : la mère d’élève à qui elle a livré son histoire l’a écoutée avec bienveillance. Quelque temps plus tard, sa maîtresse a annoncé à toute sa classe la mort du mari de Ruby, une Atsem (agent territorial spécialisé des écoles maternelles) qui travaillait depuis longtemps dans l’école. En rentrant à la maison, ma fille s’est tournée vers moi : « Qui est-ce qui l’a tué ? »
Pas un jour ne passe sans que mon compagnon, qui vient de fêter ses 51 ans, ne s’inquiète de perdre ces deux êtres qui lui sont si chers. Et pourtant, c’est lui qui m’a convaincue de les laisser prendre des risques, d’arrêter de leur répéter de faire attention quand elles grimpaient en haut de l’araignée ou dévalaient le toboggan la tête la première, d’obtempérer quand l’aînée n’a plus voulu qu’on l’accompagne jusqu’à son école primaire le matin, de résister à la tentation de lui fournir un téléphone pour pouvoir la joindre à tout moment, puis d’accepter au collège qu’elle parcoure le quartier avec ses amies à la nuit tombée. Disons que notre peur est le prix à payer pour leur liberté. Une page est en train de se tourner. Manu a récupéré à la mairie son passeport et sa carte d’identité modifiés. Nos filles, les leurs. Puisse ce nouveau nom de famille, ultime hommage à Michèle Carricaburu qui a eu le courage de briser le cercle de la domination masculine, leur donner des ailes.