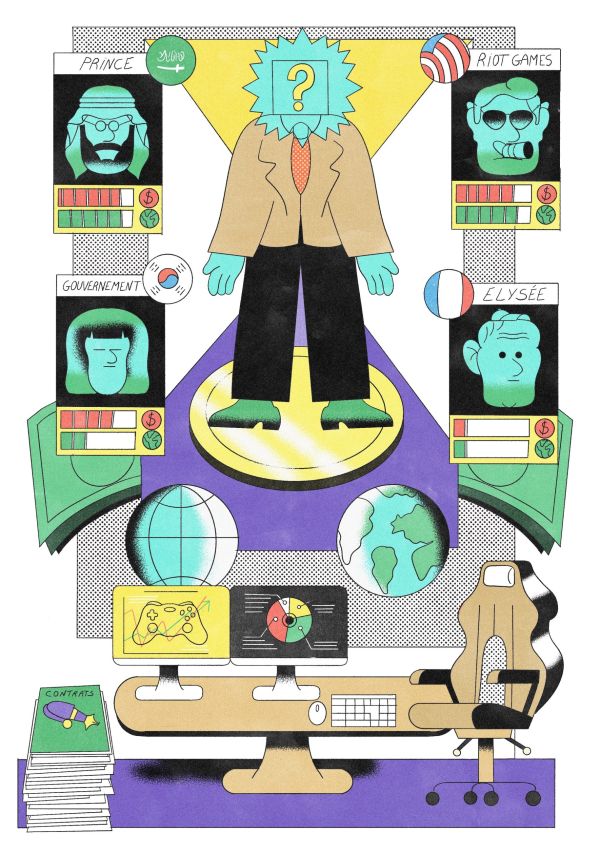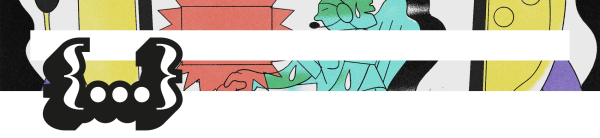Me voilà posé pour douze heures de vol, le travail en forêt assuré par deux jeunes que j’ai formés, les vaches confiées à ma mère. Makhnovchtchina a vêlé cette semaine, tout devrait bien se passer. N’empêche, je ne suis pas tranquille. Serai-je à la hauteur de ma première mission de journaliste ? Pour évacuer les vagues d’angoisse, je me remémore les chemins louvoyants dans la jungle jusqu’aux parcelles cultivées, les après-midis de discussions à l’ombre des manguiers et les volées d’enfants passant de maison en maison. La Mancolona, la communauté dans laquelle nous construisions notre sentier d’interprétation, était composée d’une quarantaine de familles du Chiapas voisin, regroupées dans un village en grande partie autoconstruit, avec des murs en planches et des toits de palme.
Malgré l’abandon total de l’État qui avait déplacé ces populations suite à la création de réserves de biosphère, les nouveaux venus avaient réussi à recréer un espace de vie au cœur de la végétation. Chacun avait droit d’usage sur une parcelle de cinquante hectares. L’agriculture traditionnelle pourvoyait aux besoins primaires de tous, et les chasseurs puisaient dans la forêt tout en veillant à son équilibre. Il n’y avait pas d’électricité, l’eau potable manquait, l’accès aux soins était très difficile, mais la communauté tenait bon. Les décisions étaient prises avec l’assentiment de tous sous l’aljibe, un grand préau muni d’une réserve servant à récupérer l’eau de pluie. Chacun, parfois au prix d’interminables palabres, savait se ranger ou plutôt s’additionner au collectif. Antonio, moteur discret mais infatigable du dynamisme communautaire, m’avait dit un jour : « si la communauté est heureuse, alors je peux être heureux ».
Au lieu de revenir tous les soirs au bureau de l’ONG, nous nous arrangions, Albert et moi, pour rester le plus souvent possible dormir chez ce père de famille intarissable, à débattre sous son avocatier des subtiles différences entre les langues mayas tzeltal et yucatèque, ou à deviner, en voyant des enfants passer, de quelle famille ils venaient. Antonio avait connu les prêtres rouges, qui avaient sillonné le Chiapas au tournant des années 1970 et 1980, préparant le terrain au futur soulèvement. Puisait-il là son engagement ? En tout cas, la vie à la Mancolona nous faisait sentir l’intelligence collective que proposait le zapatisme. Une forme d’organisation libertaire concrète, dans la simplicité et la patience du quotidien. Cela faisait écho en moi à une construction idéologique faite d’intuitions et de lectures. Pour Albert aussi. À une nuance près, de taille : sa culture maya le rattachait de manière plus profonde à cette histoire.
Le bar rock passait de la bachata
Albert m’a donné rendez-vous au terminal de l’ADO – la gare routière – de Mérida, la capitale d’État du Yucatan. Le timing est serré, Sara et Yamili m’attendent à la descente de mon bus. La dernière fois que je les ai vues, la compagne et la sœur d’Albert avaient 15 et 17 ans et ne se connaissaient pas. Aujourd’hui, ce sont deux femmes décidées et complices qui prennent en main notre commande dans un bruyant petit restaurant ouvert sur la rue. Nous voilà bien étonnés devant le plat de tacos, ne comprenant pas très bien le sens de nos retrouvailles, mais revenant vite et avec plaisir sur ces mois du printemps 2004 où nos vies se sont croisées. Trois quarts d’heure plus tard, elles me donnent les clés de la voiture familiale, et je les salue. Elles montent dans un autobus, pour San Cristóbal, au Chiapas, où elles vont suivre une formation d’une semaine à la gestion communautaire des conflits.
Dans la même minute, Albert descend de son bus à lui, en provenance de la capitale, Mexico. Je suis toujours aussi gauche pour donner les accolades qui ne se font pas chez moi – il m’est plus facile de signer mes e-mails en espagnol d’abrazos. Pour rendre la pareille de la gêne à Albert, je lui claque une bise, ce qui a encore aujourd’hui le don de le déstabiliser. « Que faire à Mérida ? me lance-t-il. Pas grand-chose à part aller aux cantinas ! Enfin, il y a bien des activités pour touristes, comme visiter les bâtiments construits sur les temples mayas, par exemple ! » Ce soir-là, nous n’arrivons même pas à trouver un de ces bars restaurants qui, avec les accordéons de corridos, font le ciment du Mexique. Nous finissons dans un café rock qui passe de la bachata.
On rit, on opine, on exagère
Passé le constat partagé que nous vivons dans une course permanente, loin de nos rêves de sages paysans, nous retrouvons, devant un burger, notre grammaire, faite de mon espagnol approximatif et de son humour mexicain. La seule évolution notable de nos échanges étant le langage inclusif, qui donne de nouvelles perspectives aux jeux de mots.
Nous poursuivons notre discussion pendant l’heure et demie de route qui nous mène de Mérida à Sanahcat. Puis autour de notre première caguama, bière à partager au nom de grosse tortue marine, nous nous remémorons celles et ceux que nous avons connus. On rit, on opine, on exagère. C’est bon, on n’a pas perdu nos 20 ans. Même si les cheveux d’Albert ont poussé, et nos ventres aussi. Surpris de m’en sortir parfaitement avec mon hamac, je m’endors la tête pleine d’images et d’interrogations.
Le réveil se fait au chant du coq, d’autant plus que celui d’Albert semble m’avoir pris en grippe et s’est posté à deux mètres de mon hamac. Ma chambre est ouverte sur le solar, la basse-cour traditionnelle plantée d’arbres fruitiers, parcourue de dindons, canards et poules. Ce matin, je vais enfin découvrir Sanahcat, le fief d’Albert et de ses aïeuls, où il a décidé de retourner vivre. Je savais bien qu’il venait d’une autre histoire que celle de la jungle de Calakmul. Ici, plus près de la mer, au cœur de la péninsule du Yucatan, pas d’ambiance tropicale, mais une impression de friche arbustive et épineuse infinie, que seuls interrompent des murets de pierres sèches calcaires plus ou moins effondrées. Le village, quadrillé de rues perpendiculaires, est composé de maisons de parpaings aux fondations apparentes et démesurées. Il ne reste plus que quelques bâtisses traditionnelles en terre rouge et bois, aux pignons joliment arrondis. Une église du XVIe siècle trône au centre, à proximité du terrain de basket couvert, de l’école et de la mairie. Ce paysage traumatisé tranche avec la tranquillité de ses habitants. Ici, tout semble en attente, comme l’extension des maisons.
L’heure des zébus et des grands-pères
Albert a terminé sa maîtrise de biologie. Il s’est marié avec Sara, a eu trois enfants et a travaillé dans des projets de développement de l’ONG grâce à laquelle nous nous sommes connus, avant de s’installer ici. Sa famille a maintenant sa parcelle au sein de l’ejido, comme les familles que nous avions accompagnées vingt ans plus tôt. La sienne se trouve à deux kilomètres de la maison, après le terrain de foot. Ce matin, je m’y rends à 6 heures pour profiter de la fraîcheur. C’est l’heure où l’on croise, sur la route de pierre blanche qui s’enfonce dans la savane arborée, des petits troupeaux de zébus, pas très épais en cette saison sèche, et les grands-pères, sac en bandoulière et machette à la main, qui partent préparer leurs cultures. Ils prennent le temps de s’arrêter pour me saluer : « Vous allez au chile feliz ? »
Le chile feliz, le « piment heureux », c’est le nom donné à la parcelle d’Albert par son père, qui y a cultivé la plante de manière intensive dans les années 1990. Jusqu’alors, les paysans produisaient le sisal, exporté pour ses fibres. Quand le marché du sisal s’est effondré, l’État et la Banque rurale ont mis en place des programmes pour financer d’autres cultures. Le paternel n’y a rien gagné, mais y a laissé sa santé et ses illusions : il a fini par travailler comme maçon à Mérida, partant avant le lever du jour et revenant de nuit. Cette période a été particulièrement marquante pour mon ami. L’argent manquait et il voyait son père beaucoup souffrir. C’est à ce moment-là qu’il a décidé d’étudier l’agronomie, pour trouver une issue et, pourquoi pas, relancer ce sisal qui finalement donnait plus de sécurité à ses parents.
Les fous du pich
Le retour à la terre d’Albert a été officialisé au pied du pich. C’est le nom maya pour le grand arbre aux fruits en forme d’oreilles, à l’entrée de sa parcelle. En 2013, avec sa sœur et son frère, ils y ont réuni leurs parents pour leur annoncer qu’ils voulaient reprendre le terrain et y développer un projet collectif. « Ils nous ont pris pour des fous, mais au fond de leur cœur ils étaient avec nous », se souvient Yamili, la sœur d’Albert. Elle aussi travaille ici, dans cette structure hybride entre centre de recherche et ONG : U Yich Lu’um, « Le Fruit de sa terre » en maya, regroupe des activités agricoles – pour faire revivre l’agriculture traditionnelle et gagner en autonomie alimentaire – mais aussi éducatives destinées aux enfants du village – sur la faune et la flore, la langue maya, les rapports de genre, les relations de violence, etc.
Les frères ont également demandé que le titre d’usage du terrain soit transmis à Yamili. Pour la première fois, une femme allait siéger à l’assemblée, socle de la communauté villageoise. Jusqu’alors « les hommes faisaient taire les femmes », dénonce Yamili avec une émotion tranchante et claire. Dorénavant, « en tant qu’ejidataria, ma parole vaut la leur. Pour mes frères, c’était normal. Pour certains voisins, c’était plus difficile à accepter ». Cette décision s’inscrit dans une réflexion plus globale encore : « Pour nous, Mayas, la notion de communauté s’étend à la nature. On ne peut pas défendre la nature sans s’opposer aux violences faites aux femmes. Les combats pour l’écologie ne peuvent être détachés des combats de genre. » Du haut de sa trentaine, la cadette des Chan Dzul est également représentante du Yucatan au sein du Conseil national indigène, entité liée au zapatisme, qui combat pour l’autonomie des peuples au Mexique, contre ce que ses membres nomment « le capitalisme patriarcal ». Yamili sourit : « C’est grâce à Albert, il m’a fait lire tellement de textes sur le zapatisme quand j’étais ado… J’ai voulu me former à une discipline qui me permette de ne plus avoir honte de ma famille, de nos noms mayas, de ce que nous sommes. J’ai étudié l’anthropologie, puis j’ai passé une maîtrise d’éducation populaire, pour travailler avec des enfants hors de leur temps scolaire et leur permettre d’avoir un espace pour s’épanouir en dehors de contextes familiaux souvent violents. »
Féministe au pays du macho
Il y a vingt ans, Albert me confiait déjà la difficulté d’être féministe au pays du macho mejicano. Peut-être que le changement le plus profond se situe là aujourd’hui : les femmes occupent une place centrale dans l’organisation, la pensée collective, les prises de décisions et les développements concrets des projets. Sara, la compagne de mon ami maya, est à la tête de U Yich Lu’um, qui compte maintenant neuf salariés. Quatre travaillent dans la partie productive, notamment de légumes, cinq se consacrent à l’administration de l’association et aux projets socio-éducatifs. Albert est chargé de dénicher les financements pour faire tourner la structure. « Ça fait trois ans que nous avons trouvé un équilibre économique. Avant, c’était très difficile », soupire mon ami.
Au pied du pich, le sol apparaît extrêmement âpre pour un paysan béarnais habitué aux vertes prairies et aux forêts. Des bandes argileuses rouges s’étalent entre les affleurements de roche calcaire sur lesquels pousse un maquis épineux dense et sec. Il est bien difficile d’imaginer cette terre offrir assez de ressources pour faire vivre les grandes cités mayas, qui ont abrité jusqu’au XIVe siècle des dizaines de milliers de personnes, voire des centaines de milliers pour les plus importantes. Mais si elle l’a fait, elle le peut encore. Albert entreprend de me faire la visite.
Le maïs n’était pas une simple céréale, comme on dit en Occident, c’est une force, une énergie, un souffle qui habite le grain.
Pedro Uc, poète maya contemporain
Un petit chemin monte à gauche jusqu’à un bâtiment en construction, aux extrémités arrondies, ressemblant aux maisons traditionnelles mayas en bien plus grand et qui abrite une salle de classe, bientôt terminée. Plus loin, une pépinière couve des dizaines de ramones, des arbres fourragers qui dynamiseront le maquis. Un verger tout proche accueille des ruches pour les abeilles mélipones, et des bacs pour les lombrics. Albert file et je suis son catogan – il faut que je pense à lui demander s’il s’est laissé pousser les cheveux pour affirmer sa « mayitude ».
Nous arrivons au jardin où travaillent Carlos, Ariel, German et Rodolfo, quatre voisins, anciens maçons à Mérida. Passé un portillon en grillage, la vie éclate. Les plants de tomates et d’aubergines ploient sous les fruits, les planches sont remplies de coriandre, salades et piments. La terre rouge et argileuse se fait plus douce. Derrière le muret de pierres commencent à se former de petits ananas au cœur de leurs cactus.
« Albert, tu ne m’avais pas dit que vous aviez des cochons ?
— Si, ils sont dans leur grange avec les moutons, derrière les deux hectares où on prépare le brûlis de la milpa. »
La milpa – kool en maya – est une technique d’association de cultures, à la base du système alimentaire de Mésoamérique, qui a nourri pendant près de trois mille ans la civilisation maya. Dans ces espaces de production annuelle, on sème à la main trois plantes sœurs ensemble : le maïs, la calebasse et le haricot rouge. Mais kool signifie aussi « notre âme » : la milpa est le lieu du maintien de la relation des vivants et non-vivants à leur territoire. La faire revivre, c’est retisser cette relation. Albert, avec un air grave que je lui ai rarement vu, me dit : « Nous sommes persuadés que nous avons un lien particulier avec l’environnement naturel, ce lien nous constitue. En revenant à la milpa, nous retournons à notre place. » Une interconnexion à la fois matérielle et spirituelle, dans laquelle le maïs joue un rôle sacré, comme l’écrit Pedro Uc, poète maya contemporain : « La culture du maïs, chair et sang de la femme et de l’homme mayas, nous a permis de rêver, de croire, de créer un langage et une langue singulière grâce auxquels nous communiquons avec l’âme – ool – de ce fruit. On a découvert que ce n’était pas une simple céréale, comme on dit en Occident, c’est une force, une énergie, un souffle qui habite le grain. Ce n’est pas pour rien que l’on appelle “inaj” la semence, ce qui signifie la maison du vent, de l’énergie, du ool. »
Dans un Mexique sans sombreros
Lors d’une veillée à Calakmul il y a vingt ans, Albert m’avait demandé : « ETA, ils tiennent combien d’hectares ? » À l’époque, sa question m’avait fait beaucoup rire. Je pensais qu’il réfléchissait selon un logiciel guévariste : groupe armé, territoire, Sierra Madre, expansion de la révolution… Je comprends aujourd’hui que le territoire revêt un sens plus profond pour mon ami : il représente à la fois l’espace de vie et de production où se recrée, dans l’apparente simplicité du travail de la terre, un mode de rêver ensemble. Sur la milpa, le ool, l’âme, l’énergie de vie, se maintient et se développe dans l’acte de semer. Lorsque ce travail est collectif, le ool devient un souffle où s’additionnent les aspirations et les forces. « Mon grand-père a connu l’époque où la milpa se travaillait de manière collective, les paysans regroupant leurs parcelles pour y travailler », m’explique, nostalgique, Albert quand nous terminons la visite par 35 degrés à 10 h 30 dans ce Mexique sans sombreros.
Mon ami lit le combat des zapatistes avec des yeux profondément mayas, je ne m’en rends compte que maintenant. Ici, lutter pour son territoire n’est pas une tactique révolutionnaire, c’est un combat ordinaire, vital. La propriété privée était étrangère à l’Amérique précoloniale. D’ailleurs, le « terre et liberté » scandé par Zapata en 1910, et qui a inspiré les zapatistes des années 1990, était un cri de révolte non pas pour demander un transfert de propriété des terres, mais pour que celles-ci reviennent à un usage collectif.
Pour aller plus loin